A quoi reconnaît-on un livre important ? Au nombre de commentaires qu’il suscite, aux critiques et aux soutiens qu’il provoque, aux études qui en sont issues. Le précédent ouvrage de T. Piketty[1] le fut, assurément. Capital et idéologie (Seuil, 2019), dès sa parution à la fin de l’année dernière a, lui aussi, été très médiatiquement couvert. Les études académiques suivront, à n’en pas douter. Contrairement à son (gros) ouvrage précédent, le présent (gros aussi) s’éloigne de l’économie et de l’Europe pour aborder d’autre continents, d’autres sciences sociales, en remontant le temps. Les critiques ne viendront pas seulement des économistes et des politiques, mais également sans doute des historiens !
L’approche de T. Piketty est toujours quantitative et, avant d’exposer les thèmes abordés, il est bon de se pencher dans un premier temps sur les données utilisées et la manière dont il les traite. On évoquera ensuite le voyage spatio-temporel qu’il propose avant de terminer par les mesures qu’il préconise.
Les données et comment les traiter
On ne peut être qu’admiratif devant l’étendue des recherches de statistiques réunies par l’auteur et, j’imagine, une armée d’étudiants. Des statistiques sont là, il faut les dénicher avant de les interpréter. A travers les âges et les lieux, l’auteur compulse des actes notariés, des sources pour estimer le nombre et le patrimoine des nobles et des prêtres, la scolarisation par tranche d’âge, par caste en Inde, le nombre d’esclaves et, bien entendu, la répartition des revenus et de la richesse. Il a aussi exploité les enquêtes post-électorales pour analyser le comportement des votants par niveau de diplôme, par pratique religieuse.
Un gros travail donc de fourmi pour dénicher et retraiter les données, lorsqu’elles existent : une première leçon de la lecture du livre est que les statistiques sont une construction sociale, jamais indépendantes des sociétés qui les fabriquent. Leur absence prouve le défaut d’infrastructure pour recenser les actes notariés, agréger les données fiscales, ou l’absence de besoin : par exemple, en raison de la non taxation du patrimoine, il n’est pas nécessaire d’évaluer le patrimoine… Un cas emblématique est celui de la Russie où les fortunes bâties sur les décombres du communisme ne sont pas calculées car l’impôt sur le patrimoine n’existe pas. Même les statistiques de revenus, taxés uniformément à 13 %, quel que soit leur montant, ne sont probablement pas fiables[2]. L’auteur déplore également les difficultés pour obtenir des informations fiables sur les grands patrimoines internationaux. La libre circulation des capitaux ne s’est pas accompagnée d’un échange d’informations entre pays (et pas seulement les paradis fiscaux) : il ne s’agit aucunement de problème technique (cf. l’obligation pour les établissements financiers mondiaux de fournir à l’administration fiscale américaine les revenus des citoyens américains). Et lorsque les informations existent, elles concernent les revenus et pas le patrimoine.
Sa recherche de données passe également par l’examen approfondi des sources gouvernementales : évolution des taux d’imposition et leur progressivité, impôts exceptionnels, montant des dettes publiques, montant des réparations (suite aux guerres) et indemnités), niveau scolaire de la population, coût de l’éducation, poids de l’Etat dans l’économie, etc. Les données et diverses études sont disponibles en accès libre sur https://wid.world/fr/accueil/.
Depuis longtemps, on sait que le concept de moyenne se révèle insuffisant pour analyser un phénomène. La médiane est de plus grande utilité mais la dispersion d’un critère apporte une information additionnelle[3]. Mais lorsqu’on s’intéresse aux inégalités, d’autres mesures sont nécessaires. T. Piketty critique sévèrement le rapport interdécile D9/D1 qui « oublie » le patrimoine des plus fortunés et ne se modifie pas lorsque les 10 % les plus riches doublent leur patrimoine; l’indice de Gini n’a pas plus ses faveurs car il est trop synthétique : sur les 40 dernières années, il est stable et pourtant « les inégalités ont fortement augmenté entre le milieu et le haut de la répartition mondiale des revenus depuis 1980, alors qu’elles diminuaient nettement entre le bas et le milieu de la distribution » (p. 767 se référant à la « courbe de l’éléphant»).
Sa préférence va, et il en use abondamment, au revenu (ou patrimoine) moyen des 10 % (ou des 1 % ou des 0,1 %) les plus élevés comparé au revenu des 50 % les plus faibles ou à celui des 40 % de la « classe moyenne ». Dans le même ordre d’idées, pour mesurer l’évolution du comportement électoral par niveau de diplôme, il calcule la différence des votes en faveur d’un candidat entre les plus diplômés et les moins diplômés sur toutes les consultations électorales dans divers pays. Ces notions ont le mérite indéniable d’être simples et parlantes.
Les histoires des inégalités à travers les âges et les lieux
Comme l’indique T. Piketty, il est possible de ne lire que l’introduction de Capital et idéologie, puis de sauter à la quatrième partie de l’ouvrage, en évitant ainsi quelques centaines de pages. On aurait tort de suivre cette recommandation. En effet, les parties historiques sont passionnantes, même si elles donnent l’impression de temps en temps que l’auteur veut montrer toutes les recherches historiques qu’il a faites.
On voyage ainsi à travers plusieurs sociétés trifonctionnelles (la noblesse, le clergé, et tous les autres, soit plus de 90 % de la population) en Europe, en Inde, en Chine, en Iran. Il s’intéresse également au cas de la France avec avec notamment la chute de la propriété ecclésiastique après la Révolution française et à la manière dont la noblesse a cherché à conserver quelques privilèges en négociant la transformation des corvées, banalités, cens et autres lods (droit de mutation perçu par le seigneur) en loyers.
Puis c’est la narration du 19e siècle et la mise en place de la société de propriétaires qui aboutira à une augmentation continue des inégalités jusqu’au début du 20e siècle. La propriété privée y est érigée en modèle : chacun peut y accéder, contrairement à la succession nobiliaire mais, une fois acquise, elle est inviolable et transmissible,. Le passage d’une société ternaire à une société de propriétaires nécessite un Etat garant des droits, détenant le pouvoir de violence légitime et doté d’une justice autonome.
Il y a peu d’impôts et le processus d’accumulation peut opérer. Entre le début du 19e et le début du 20e siècle, la forme de la fortune varie : de terrienne, la propriété devient davantage industrielle, rentière et immobilière et coloniale (en France et au Royaume-Uni). Au pire des inégalités, 1 % de la population détenait 55 % de la richesse totale en France, 45 % aux Etats-Unis, 70 % au Royaume-Uni. L’auteur évoque d’autres pays, notamment la Suède qui était une société très fortement inégalitaire il y a un peu plus d’un siècle. Les inégalités de patrimoine et de revenus allaient de pair avec les inégalités politiques : le vote censitaire était souvent la règle. La Chambre des Lords est explicitement une instance de pouvoir réunissant les aristocrates-propriétaires, pouvoir qu’elle a perdu définitivement au profit de la Chambre des Communes, élue au suffrage universel, au début du 20e siècle.
La logique de la propriété est encore poussée plus loin avec l’analyse des sociétés esclavagistes. Peu à peu, l’esclavage fut aboli au 19e siècle, posant le sujet épineux des conditions économiques de l’abolition : comment indemniser les propriétaires d’esclaves (l’indemnisation des esclaves n’a jamais été très loin) ? Ne pas les indemniser aurait remis en cause le droit de propriété alors que l’esclavage avait été décidé dans un cadre légal. De vastes débats eurent lieu sur le montant de l’indemnisation. Le cas le plus douloureux est celui d’Haïti : ce pays, ayant lutté pour son indépendance sous la direction des anciens esclaves, a dû, sous la contrainte des forces militaires françaises, acheter son indépendance, au prix d’une dette abyssale que le pays a continué d’honorer jusqu’au milieu du 20e siècle.
L’ouvrage se poursuit avec les sociétés coloniales : ici pas d’esclavage mais une détention sans partage des richesses des pays colonisés par une petite partie de la population locale ou directement depuis les métropoles européennes. C’est l’existence d’un Etat plus fort en Europe qui a permis la colonisation dont les effets sont encore prégnants aujourd’hui. Les populations autochtones n’ont pas beaucoup bénéficié des largesses du colonisateur. Les budgets locaux étaient financés par les recettes locales et les dépenses publiques étaient à l’avantage d’une petite frange de la population, notamment les fonctionnaires venus de métropole. Le travail forcé légal était monnaie courante jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale. Rappelons en outre que, sans colonisation stricto sensu, les puissances coloniales ont défendu leurs intérêts, militairement lorsqu’elles le jugeaient nécessaire (par exemple, en Chine avec la guerre de l’opium).
L’Inde fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’auteur, mais davantage d’un point de vue sociologique qu’en terme de répartition de richesse. Dans cet immense pays structuré de manière très complexe, les Britanniques ont « simplifié » les castes pour leurs besoins d’administration et ont favorisé les brahmanes, la caste des intellectuels. Après leur départ en 1948, il n’y eut pas de redistribution des terres mais, peu à peu, une politique de quotas dans le système éducatif.
L’histoire des inégalités des pays développés change du tout au tout à compter de la première guerre mondiale. Elles s’effondrent puis restent à un niveau assez modéré jusqu’aux années 80. L’Etat, dans sa forme moderne, commence à émerger au siècle précédent et ses missions s’élargissent constamment. Le début du 20e siècle voit également l’apparition de l’impôt sur le revenu. Sa naissance, qui a été tout sauf facile, est aussi le fruit du niveau extraordinaire des inégalités, de la peur de la révolution. Les mobilisations et les luttes sociales y prirent leur part. Aux Etats-Unis, l’instauration de l’impôt sur le revenu rappelle que les inégalités trop fortes sont contraires à l’esprit des fondateurs. A certaines périodes, les taux d’imposition effectifs y ont atteint 70-80 %, dissuadant les rémunérations très élevées.
Les propriétaires sont pour la plupart ruinés sous l’effet conjugué des dommages de guerre, des expropriations/nationalisations, des impositions très élevées (notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni mais aussi au Japon, en Allemagne, en Italie, …)[4], de la dévalorisation des marchés financiers, puis de la décolonisation.
Les recettes fiscalo-sociales enrichissent l’Etat et la société de propriétaires se transforme en Etat social-démocrate dans les pays développés après 1945[5]. On observe un développement des dépenses de santé, d’éducation (l’Europe rattrape les Etats-Unis), de retraites, etc., développement qui s’accompagne d’une forte croissance et de contre-pouvoirs au système de propriété privée et au capitalism. T. Piketty regrette que la social-démocratie n’ait pas creusé davantage plusieurs pistes, comme la cogestion, notamment en France, même lorsque le pays était dirigé par les socialistes. Les Etats européens n’ont pas su trouver collectivement une voie médiane entre les Etats-Unis, chantres de la propriété privée intégrale, et l’URSS et ses satellites dans lesquels l’Etat possédait tout.
Et au 21e siècle?
T. Piketty insiste à de nombreuses reprises sur la nécessité que toute société ait une théorie, une justification des inégalités en son sein. Et d’ajouter que lorsque cette justification ne fonctionne plus bien et/ou que les inégalités deviennent trop importantes, elles portent en germe la réaction des populations.
Le mouvement de décrue des inégalités, amorcé à partir des années 20 et qui s’est approfondi à partir de deuxième guerre mondiale jusqu’au début des années 80 n’aura-t-il été qu’une parenthèse dans la longue histoire des inégalités ? Depuis la révolution conservatrice du début des années 80, la chute du communisme, les monarchies pétrolières, on observe une augmentation très significative des inégalités, qu’il s’agisse des revenus (avant ou après impôts) ou du patrimoine. A tel point qu’on retrouve dans de nombreux pays (Etats-Unis, Russie et Chine, monarchies du Moyen-Orient, etc.) les inégalités observées en Europe au début du 20e siècle. Ce retournement n’a pas entrainé une accélération de la croissance, au contraire, malgré les espoirs des tenants de la baisse de la pression fiscale, du moins d’Etat, de la dérégulation, de la marchéisation tous azimuts.
La sévère critique de l’Europe est classique : construite sur la compétition entre territoires, elle profite aux plus mobiles en refusant toute avancée sociale et fiscale (règle de l’unanimité). N’ayant pas de budget autonome, c’est un nain. Les efforts européens sont limités à ceux de la BCE (pour la zone euro) et n’interviennent qu’en temps de crise, pour sauver le système bancaire.
L’auteur affirme en outre que les sociaux-démocrates portent une part de responsabilité dans le retournement spectaculaire des inégalités : en utilisant les données d’enquête post-électorales en Europe continentale, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, il montre que les partis sociaux-démocrates (y compris les démocrates aux Etats-Unis) recueillaient les suffrages des classes populaires jusqu’aux environs des années 90 mais que, depuis, leur base électorale est plutôt devenue le fait des diplômés[6],. Le clivage gauche-droite semble avoir vécu. Les délaissés de la croissance, avec peu de diplômes, peu de revenus, un peu plus de patrimoine que la moyenne, ont pu être attirés par un discours « social-nativiste » (protections des nationaux les plus faibles contre les « autres ») en Pologne ou en Italie. Le clivage identitaire emporte le clivage « classiste ».
C’est pourquoi il développe en fin d’ouvrage un programme de « socialisme participatif » inspiré d’expériences analysées tout au long de l’ouvrage. Il ne s’agit pas d’aboutir à une société égalitaire mais de rechercher une société dans laquelle chacun puisse accéder à des biens fondamentaux dont l’étendue reste à débattre. Ses propositions s’articulent, sans prétendre à l’exhaustivité, autour de :
- Un droit de propriété moins absolu,: droit de vote des salariés dans les (assez grandes) entreprises avec plafonnement des droits de vote des grands actionnaires; impôt (fortement) progressif sur les revenus (tous les revenus), les successions, les émissions de carbone mais surtout sur le patrimoine (tout le patrimoine) pour que le capital circule davantage. Dotation en capital pour tout jeune à l’entrée de la vie active;
- Création d’un revenu de base et d’un capital éducation pour chacun, à hauteur des dépenses d’éducation des mieux lotis aujourd’hui, à utiliser tout au long de la vie.
- Un financement de la vie politique par les citoyens. A chacun sont alloués quelques euros par an qu’il attribue au parti de son choix.
- Création d’une Assemblée européenne issue essentiellement des Parlements nationaux, dotée de pouvoirs étendus, notamment en matière de fiscalité, de recherche et de mesures climatiques (http://tdem.eu/).
L’auteur est plus prudent à l’international. Les Etats européens sont tenus à une libre circulation des biens et capitaux ainsi que des personnes de l’Union européenne. Les affrontements idéologiques au sein des nations portent principalement sur la (non) circulation des non Européens.
Bien entendu, T. Piketty récuse l’idée que ses propositions soient utopiques. Dans le passé, diverses bifurcations se sont produites. Il conclut à la nécessité de la lutte entre idéologies, à la coopération entre sciences sociales et à l’appropriation de l’économie par tout un chacun. Vaste programme !
* « Capital et idéologie » de Thomas Piketty aux éditions du Seuil
Mots-clés : inégalités – richesse – idéologie – bifurcation – éducation – impôt
[1] Le Capital au XXIe siècle, Ed. Seuil, 2013
[2] Dans le même registre, on peut douter d’au moins une partie des nombreuses statistiques qui circulent chaque jour sur le nombre de personnes infectées par le covid-19, sur le nombre de décès : les tests de dépistage ne sont pas pratiqués à la même échelle selon les pays, des décès surviennent sans que leur cause soit certaine, de nombreux gouvernements contrôlent la chaîne de fabrication des statistiques… Les statistiques démographiques donneront probablement une vision plus claire, plus tard.
[3] ce n’est pas par hasard que variances.eu s’appelle ainsi!
[4] A l’issue des guerres napoléoniennes, le Royaume-Uni, avec une dette de 200 % du PIB, avait choisi de ne pas prélever d’impôts et a dû rembourser sa dette pendant un siècle.
[5] Les recettes de l’Etat s’élèvent à environ 10 % du revenu national avant la 1re guerre mondiale; entre 30 et 40 % en 1950.
[6] L’élection d’E. Macron en 2017 bénéficie d’un traitement différencié puisqu’il est parvenu à rallier la « gauche brahmane » et la « droite marchande ». A l’inverse, le Brexit marque leur défaite au Royaume-Uni.
- Notes de lecture :« Il faut dire que les temps ont changé… Chronique (fiévreuse) d’une mutation inquiétante » de Daniel Cohen* - 11 septembre 2023
- Note de lecture : « Homo Numericus » de Daniel Cohen - 15 mai 2023
- Remontée des taux d’intérêt : les conséquences sur les portefeuilles d’actifs - 9 janvier 2023

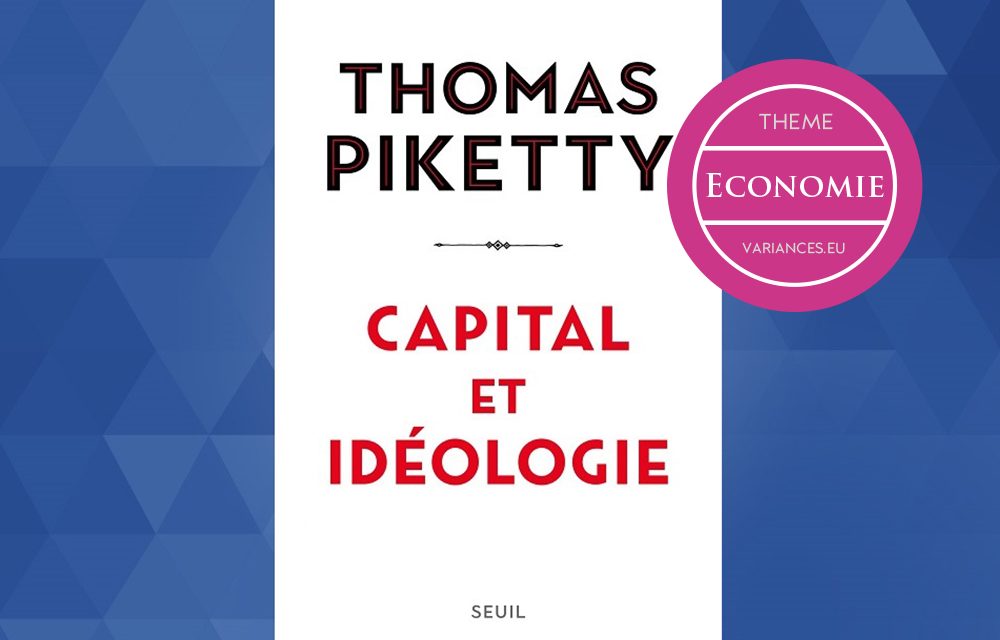
Les statistiques nombreuses de l’auteur sont biaisees par les hypotheses sous-jacentes. Les droits a pension (qui representent tout autant la detention d un engagement de payer que des obligations d’Etat), qui correspondent a un capital de plusieurs centaines de milliers d unites pour des centaines de milliers d employes du public en particulier, l avantage d un loyer hors marche avec droit de succession gratuit pour les habitants de HLM, le droit a la sante sans compter pour tous….tous ces reducteurs d inegalites sont ignores. Pour Piketty, ne compte que la richesse taxee a l’IR ou l’impot sur les successions. Toutes les rentes differentielles de solidarite n y figurent pas.
Piketty ne concoit la richesse que provenant de l exploitation de la rente (pas d innovation, pas de remuneration du risque entrepreneurial, l entrepreneur n est qu un profiteur) – mais les beneficiaires de rentes de solidarite ne sont pas consideres comme riches, meme s ils ne travaillent pas leur vie durant et beneficient de sante, education, loisirs gratuits.
Nulle part dans ses livres ne figure une analyse statistique, sociologique et historique des rares societes egalitaires et egalitaristes. Pourtant on voudrait savoir si le Venezuela et la Coree du Nord ont une meilleure « ideologie ». Quand au Zimbabwe, par exemple, une des societes les plus inegalitaires du monde, on se demande en quoi sa situation resulte du colonialisme.
Enfin la crise COVID prouve que le monde est egalitaire comme jamais. Tout le monde est ruine au benefice de quelques dizaines de milliers de patients a risque.