Nous avons appris avec tristesse le décès de Daniel Cohen. Nous republions à titre d’hommage la note de lecture consacrée à son ouvrage « Il faut dire que les temps ont changé… Chronique (fiévreuse) d’une mutation inquiétante », rédigée par Alain Minczeles.
Il s’agit du 3e livre de Daniel Cohen avec un titre comportant un adjectif entre parenthèses : « une introduction (inquiète) à l’économie » il y a une dizaine d’années puis, en 2012, « un prophète (égaré) des temps nouveaux »; et, aujourd’hui, « une chronique (fiévreuse) d’une mutation inquiétante ». Une progression alarmante.
Cohen donne sa lecture des cinquante dernières années, anniversaire de Mai 68 oblige. Et il en ressort une certaine nostalgie du passé, et une colère rentrée des dévoiements des idéaux portés par certains alors. Les crises sont passées par là et notre génération n’a pas su donner un espoir aux générations suivantes. C’est le sentiment que j’ai ressenti à la lecture d’une bonne partie de l’ouvrage. La croissance qui a accompagné l’après-guerre a permis au capitalisme de vivre et de donner à vivre à tous les acteurs des économies (développées), avec des relations hiérarchiques très formalisées mais avec un sentiment d’appartenance, du haut au bas de l’échelle.
Les illusions perdues
La fin de la croissance, la fin de l’industrie marquent la mort de ce modèle. Et la révolution reagano-thatchérienne lui assène le coup de grâce. Les valeurs de solidarité font place à la cupidité, l’argent est roi, l’individualisme concurrentiel règne.
L’autre devient vite un ennemi. Il y a quelques gagnants, beaucoup sont laissés au bord du chemin, qui viendront grossir les rangs des populismes.
L’auteur rappelle les utopies des grands historiens qui voyaient la société post-industrielle comme celle qui s’occuperait enfin de l’homme (éducation, santé, loisirs). Las, pas de croissance dans ce monde. Et les services à la personne sont assurés par des personnels peu qualifiés.
En revanche, les gagnants sont ceux qui ont inventé les « produits » « fabriqués » avec des rendements d’échelle croissants : les recettes augmentent alors que les coûts ne varient que très peu.
L’ouvrage donne une lecture polymorphe des cinquante dernières années, et pas seulement d’un point de vue économique. L’auteur utilise la géographie, l’histoire, la psychanalyse, la psychologie, les sciences politiques avec tous les grands auteurs de chacune de ces disciplines.
Il ressort de ces analyses que les idéaux de Mai 68 se sont fracassés sur la réalité : les communautés n’ont pas survécu longtemps, plusieurs pays ont connu une dérive violente, la révolution conservatrice a remporté la mise, au moins dans les pays anglo-saxons, la crise de 73 a révélé la chute de la productivité, la baisse de la croissance, la fin de la société industrielle telle que les pays développés la connaissaient depuis un siècle.
Ces bouleversements ont appauvri des régions entières, les syndicats ont périclité, les industries ont été tuées par leurs gains de productivité, seulement utiles à faire baisser les prix. Les gauches perdent leur assise traditionnelle, l’individualisme triomphe. Il n’y a pas paupérisation générale mais déshumanisation, perte du lien social. La géographie électorale montre que les scores des populistes augmentent au fur et à mesure de l’éloignement de ce lien, de l’absence de confiance envers autrui. Les clivages ne sont plus entre gauche et droite mais plus sur le rapport à autrui, sur la confiance envers les institutions, sur une demande de protection certes, mais pour soi, pas pour les autres. Il s’ensuit logiquement pour certains populistes une diminution de la solidarité et une augmentation de la xénophobie.
En fin de compte, les trente glorieuses n’ont été qu’une parenthèse qui épuisent la croissance issue de la généralisation de l’électricité à tous les niveaux. Et la croissance a souvent été de pair avec les idées progressistes. Et vice-versa…
Une société digitale rêvée?
Arrive Internet. Cela n’a pas été un relais de croissance : pas de ruissellement, les inégalités se sont accrues, les usines se vident encore plus, les réorganisations sont permanentes, tout ce qui peut être externalisé l’est, le travail s’intensifie, le client est roi, il faut vendre moins cher. Les problèmes psychiques s’intensifient.
La gauche ne protège plus, la droite est cupide. Le programme économique des populistes est sans doute stupide (croissance inclusive au mépris de la stabilité macroéconomique) mais répond à une détestation des élites et de l’immigration. Ainsi, Trump reconnaît la souffrance de son électorat, il défend leur xénophobie et leur demande de protectionnisme; sa critique du politiquement correct lui permet de dire ouvertement ce qu’il pense. Son « ça » a pour ennemi le « surmoi » des élites.
Après ce constat très peu joyeux, Daniel Cohen aborde dans la troisième partie du livre « Le grand espoir du 21è siècle », autrement dit la société digitale. Hélas, selon lui, les dangers sont bien présents et la voie vers une issue positive bien étroite. Qu’on en juge.
L’intelligence artificielle (IA) fait des progrès chaque jour : il n’y a plus d’activité répétitive dans laquelle l’homme fait mieux que la machine. C’est le cas depuis bien longtemps pour les calculs, c’est le cas pour la plupart des jeux (avec auto-apprentissage qui permet à l’IA de se dégager des parties jouées par les humains), dans la reconnaissance des images, dans la traduction automatique, etc. Il n’y a plus guère que dans la création et lorsque les informations sont pauvres ou ambiguës que l’homme se révèle meilleur. Les robots peuvent remplacer l’homme dans la plupart des tâches et, très bientôt, dans les tâches de proximité. Quel sera le partage des tâches entre robots et humains? Quels seront nos rapports avec eux?
Certes, le progrès technique est bon pour l’emploi, comme l’a montré la diffusion de la machine à vapeur et de l’électricité, mais conduit à la constitution de grands groupes et à la destruction des petits ateliers. Le phénomène est de nouveau à l’oeuvre : le processus productif peut se décomposer entre la conception, la fabrication et la prescription. Avec des rendements d’échelle croissants, la fabrication ne coûte pas grand-chose, la conception est très, très profitable et la prescription, contrairement à certains espoirs, ne s’est pas pour l’instant traduite par des emplois riches et valorisants, ce serait plutôt le contraire. L’aide aux personnes âgées est un travail considéré comme peu qualifié et faiblement rémunéré. Le ralentissement de la croissance a abouti à la prolétarisation des emplois de proximité : c’est devenu le déversoir des emplois détruits ailleurs. De plus, la numérisation de l’économie a conduit à ce que les tâches sans rendements d’échelle soient désormais assurées par le consommateur lui-même alors qu’elles étaient auparavant effectuées par des salariés.
Les entreprises les plus profitables sont celles qui emploient le moins, tous secteurs (hors secteur financier pour le moment) confondus. Et font tout pour empêcher les autres de croître. Le « small is beautiful » a vécu, les GAFA sont énormes, plus riches que ne le fut General Motors à la grande époque, avec beaucoup moins d’emplois. La part des salaires baisse au profit des revenus du capital et les inégalités continuent de s’accroître.
Une faible croissance et une digitalisation poussée procurent moins de travail, d’où moins de croissance, etc.
Arrivé à ce stade, l’auteur envisage deux issues possibles :
- la première est « la masse au service des élites », comme dans tout bon roman (ou série) de science-fiction. Les concepteurs tout en haut, quelques fabricants, des personnes au service des concepteurs, ces personnes ayant elles-mêmes des personnes à leur service;
- la deuxième est de rechercher des complémentarités entre hommes et machines/robots. Il est encore trop tôt pour imaginer toutes les possibilités qui sont ouvertes.
Il est temps de réfléchir à la nature du monde algorithmique dans lequel nous sommes entrés. Daniel Cohen est très critique sur la « génération iphone » : Facebook désocialise, des nouvelles servitudes apparaissent, la culture du « paraître beau » règne, Internet entraîne de l’insatisfaction, l’iphoniste hésite entre apathie et radicalité, la confiance dans les médias et le système éducatif baisse, on lit moins, il n’y a pas de désir d’avenir, le présent supprime l’histoire.
Quelques pistes
La vie algorithmique qu’il présente fait peur : loin d’une filiation hippie visant à une interconnexion universelle et gratuite, on se dirige plutôt vers la disparition du libre-arbitre. On se dissimule dans les réseaux. Les GAFA détruisent le soi intime, l’intimité du foyer vole en éclat. Les classements sont omniprésents. Les individus, les clients, les activités sont notées (on regardera certains épisodes de la série Black Mirror sur ces sujets). Le numérique devient une drogue. On passe de plus en plus de temps à médiatiser l’événement qu’à le vivre. On devient en permanence dans l’attente (du prochain message, du prochain épisode de la série, etc.). Le « moi » devient un « soi digital ». La dictature du direct conduit à ce que le surmoi n’a plus le temps.
Daniel Cohen, en fin d’ouvrage, appelle alors aux critiques sociales et artistes de cette société qui risque d’être rapidement la nôtre. Et avance quelques propositions:
- Surveiller les GAFA et appliquer une loi antitrust pour casser leur monopole
- Inciter les institutions publiques à utiliser l’IA (hôpital, école)
- Protéger les données personnelles
- Promouvoir la transparence des algorithmes
- Instaurer des autorités de contrôle et des contre-pouvoirs efficaces
- Pour lutter contre la disparition des solidarités , promouvoir la sécurité sociale professionnelle, le revenu universel, favoriser le syndicalisme
- Apprendre le codage à l’école
La conclusion de l’ouvrage ne paraît guère optimiste : nous aurions une soif inextinguible de la croissance afin d’obtenir davantage de revenus pour pouvoir consommer. Cependant, la société industrielle a vécu, les gains de productivité aussi. L’économie produit moins d’emplois et, alors que les sociétés féodales et industrielles avaient une structure verticale et néanmoins solidaire, notre société actuelle, fruit de la contre-culture des années soixante, annoncerait la fin de la hiérarchie et de la solidarité. L’augmentation des populismes n’est que le résultat de l’exclusion sociale, de la perte du rapport à autrui.
Des raisons d’espérer ?
On ne ressort évidemment pas indemne d’un tel ouvrage. Daniel Cohen fait appel à une énorme érudition des cinquante dernières années, à grands renforts de références historiques, d’ouvrages aussi divers que ceux de Marx, Freud, Lacan, Sartre, Levi-Strauss, Hirschman, Harari, etc., en croisant diverses approches fécondes. On y ressent une certaine nostalgie pour le monde d’avant qui semblait plus clair, plus lisible, avec des intérêts bien marqués, des clivages nets, mais une certaine solidarité (« on est tous sur le même bateau»), un goût pour la culture, un certain respect de la vie privée.
Je ne crois pas qu’il faille céder à la nostalgie. Comme l’écrit Daniel Cohen lui-même, le monde de jadis était particulièrement dur pour les travailleurs, encore pire pour le chômeur, le malade, l’étranger, l’autre.
Je ne pense pas non plus qu’il faille jeter l’opprobre sur les espoirs des années 60, ni sur ses acteurs qui, c’est vrai, s’en sont très bien sortis, mais c’est une question de génération : les baby-boomers ont bien réussi leur vie, pour la plupart d’entre eux, y compris les vedettes d’alors. Ils occupaient un emploi lorsque la croissance a ralenti et l’ont conservé, au contraire des générations arrivant aujourd’hui sur le marché du travail. Si critique il doit y avoir, elle doit porter sur l’ensemble de cette génération qui n’a pas beaucoup fait preuve de solidarité avec la génération suivante, qui n’a pas très bien reçu l’autre.
Il est vrai qu’aujourd’hui, il y a un nouveau phénomène dont on enregistre déjà les effets : la croissance est plus faible (dans les pays développés, et encore pas partout) et le digital progresse à grands pas. Oui, nous vivons avec des algorithmes et très probablement, ces algorithmes modifient nos comportements. Les entreprises ciblent leurs produits, leurs tarifs beaucoup plus précisément qu’elles ne le faisaient auparavant. L’Etat peut encore plus connaître nos faits et gestes qu’il ne pouvait le faire. Oui, les inégalités progressent car le gagnant prend tout ou presque. Oui, les emplois de proximité sont dévalorisés alors que tout le monde est d’accord pour affirmer qu’une infirmière est un des métiers les plus indispensables.
Mais ne peut-on pas avoir confiance dans le citoyen, notamment le jeune citoyen? La digitalisation est-elle inéluctable dans tous les recoins de la vie? La génération iphone, fortement décriée dans l’ouvrage, est-elle lobotomisée au point qu’elle ne pourra jamais se déconnecter? On observe des départs en masse des réseaux sociaux dès lors qu’on s’aperçoit qu’ils menacent non seulement la vie privée mais également la démocratie, un peu à l’image de la défiance envers l’alimentation industrielle. Certes, on ne peut anticiper la mort d’Internet, des applications, des outils informatiques, mais ne peut-on pas envisager un équilibre entre le tout numérique et le rien du tout numérique? Et si Facebook n’était qu’une mode, une baudruche qui se dégonflera lorsqu’elle n’amusera plus? Et sa valeur s’effondrera, faute de nouveaux utilisateurs.
Si Daniel Cohen a raison, la réaction devrait être bien plus vive que les mesures qu’il propose. Toute entreprise trop grosse devrait être démantelée, le politique doit reprendre la main et interdire plutôt que contrôler, imposer la transparence la plus totale sur les données personnelles collectées et l’autorisation expresse de les utiliser sous peine de fermeture des sites. On devrait mettre à plat les rémunérations : quel statut souhaite-t-on donner aux emplois utiles, avec quelle rémunération?
Le pire n’est jamais sûr, surtout si on croit en nos capacités de réaction.
Au début de cette note, j’avais noté la montée alarmante des titres des derniers ouvrages de Daniel Cohen. Avec la fièvre, la mutation, le changement de temps, je m’attendais à ce que le livre parlât du climat, du réchauffement climatique. Il n’en est rien. Le sujet climatique est évoqué en fin de livre, en une ligne, à propos de la consommation d’électricité des grands serveurs. Je donne donc amicalement le thème du prochain livre de Daniel Cohen : parler de la planète qu’on fait mourir. Et, en prime, je lui offre le titre : « Au secours, on brûle! Récit (désespéré) d’une mort annoncée ».
Cet article a été initialement publié le 21 décembre 2018.
*« Il faut dire que les temps ont changé… Chronique (fiévreuse) d’une mutation inquiétante » de Daniel Cohen, aux éditions Albin Michel
- Notes de lecture :« Il faut dire que les temps ont changé… Chronique (fiévreuse) d’une mutation inquiétante » de Daniel Cohen* - 11 septembre 2023
- Note de lecture : « Homo Numericus » de Daniel Cohen - 15 mai 2023
- Remontée des taux d’intérêt : les conséquences sur les portefeuilles d’actifs - 9 janvier 2023

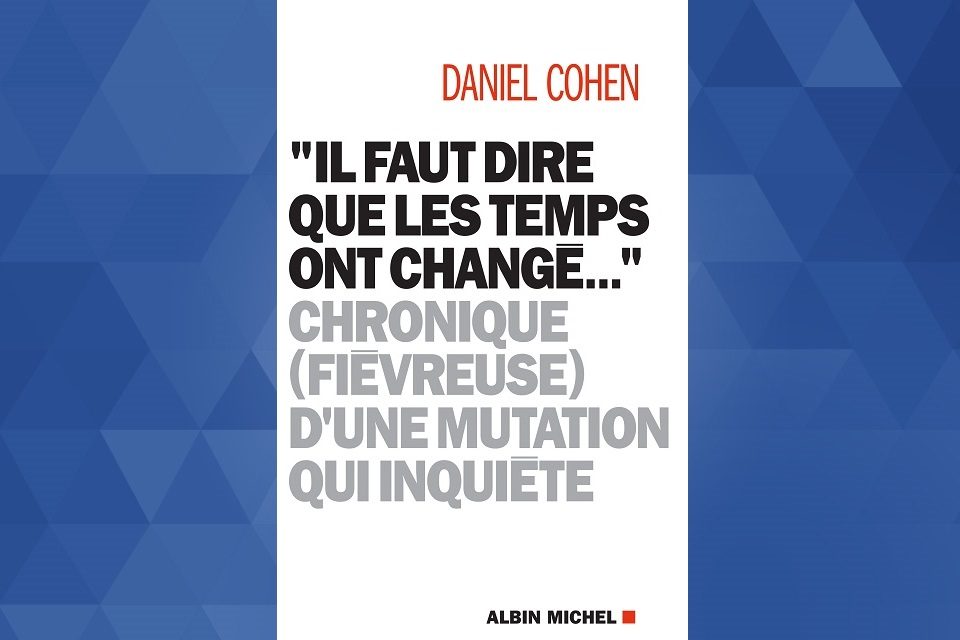
Superbe compte rendu de lecture! Parfait. 👍
Les propositions sont de bon sens, sauf deux qui prêtent à débat: pourquoi faudrait-il particulièrement développer l’IA dans les services publics ? Et faut-il vraiment développer le codage à l’école, quand on nous explique que l’IA va d’abord remplacer… les développeurs ?