La protection sociale redistribue environ 31,5% du PIB français. Jadis, elle bénéficiait essentiellement aux salariés et était financée par des cotisations employeurs et salariés. Aujourd’hui, les prestations peuvent être divisées en trois catégories : les prestations d’assistance pour les plus pauvres, logiquement financées par l’impôt ; les prestations d’assurances sociales (retraites, chômage, accident du travail, indemnités journalières), dépendant des revenus d’activité et logiquement financées par des cotisations assises sur les revenus couverts ; les prestations universelles (famille, maladie, autonomie) qui devraient être financées par tous les revenus des ménages, donc par l’impôt, mais qui restent en partie financées par des cotisations employeurs assises sur les seuls revenus d’activité. Aussi, certains s’indignent de ce que les retraités, les plus grands consommateurs de soins de santé, paient moins de cotisations maladie que les actifs (en estimant que les cotisations employeurs sont en définitive payées par les salariés).
En France, c’est un impôt spécifique, la CSG, qui contribue à financer la protection sociale. Il est proportionnel, alors que l’impôt sur le revenu est progressif, mais il a l’avantage de frapper tous les revenus et de fournir une ressource autonome à la protection sociale[1].
Nous discuterons ici du financement de la protection sociale, puis de la fiscalité des retraités, avant d’évoquer les réformes possibles.
Du financement de la protection sociale.
Deux positions s’opposent parmi les forces politiques, les mouvements sociaux et les économistes attachés au développement de la protection sociale.
Pour les uns, que nous appellerons les syndicalistes, la Sécurité sociale est intimement liée au salariat[2] ; elle ne doit être financée que par des cotisations sociales assises sur les salaires, ce qui fonde le droit des salariés à recevoir des prestations et le droit de leurs syndicats à gérer la Sécurité sociale. Ils refusent que la protection sociale soit étatisée et financée par des impôts, ce qui en ferait une variable d’ajustement des politiques budgétaires. Enfin, ils refusent de partager la protection sociale entre prestations d’assurances sociales, prestations universelles et prestations d’assistance. Selon eux, toutes ces prestations constituent du salaire socialisé. Les entreprises ne peuvent se dégager du financement des prestations maladie et famille qui concernent leurs salariés.
Pour les réalistes, dont je suis, les prestations maladie en nature et les prestations familiales, sont heureusement devenues universelles. Bénéficiant à tous les résidents, elles ne sont plus liées au salariat. Il est donc peu justifié de prétendre qu’elles ne servent qu’à reproduire la force de travail, alors qu’une partie importante des dépenses de santé profite à des personnes handicapées ou à des retraités, qui ne travaillent plus. La santé est un droit du citoyen, indépendamment de son statut de salarié. De même, les enfants ont droit à un niveau de vie satisfaisant, indépendamment de l’activité de leurs parents. Ces droits font partie du modèle social français, tout comme le droit à l’éducation gratuite. Ils doivent être financés par l’impôt.
Par contre, les cotisations sociales doivent financer les prestations d’assurances sociales, directement liées aux revenus d’activité, comme la retraite, le chômage, les accidents du travail, les indemnités journalières maladie-maternité. Les syndicats sont légitimes pour négocier, et même gérer, ces prestations.
De ce point de vue, le système français présente deux anomalies. Le financement de l’Unedic par la CSG, introduit par Emmanuel Macron en 2018, est inacceptable, tant pour les retraités, ponctionnés injustement, que pour les salariés, dont la légitimité à gérer l’Unedic est affaiblie. En fait, 1,47 point de CSG salariés finance directement l’Unedic ; le taux de CSG-CRDS des retraités (8,8%) est supérieur à celui des salariés, une fois corrigé de la part finançant les prestations chômage dont ne bénéficient que les salariés (9,7-1,47= 8,23%)
L’autre anomalie, plus importante en termes de masse en jeu, est que les cotisations sociales employeurs, maladie et famille (CSE), assises sur les revenus d’activité, financent des prestations qui devraient être financées par l’ensemble des ménages. La question ne se pose que pour les retraites, puisque les revenus du capital payent déjà des prélèvements sociaux (au taux de 7,5% en plus des 9,7% de CSG-CRDS) qui contrebalancent les CSE.
La taxation des retraités
On considérait jadis qu’il était inutile de prélever des cotisations sur les prestations. Il suffisait de fixer les prestations à un niveau satisfaisant par rapport aux salaires nets. C’est toujours la logique qui prévaut pour les prestations familiales et les prestations d’assistance. Depuis 1991, la montée en puissance de la CSG a permis d’éviter la hausse des cotisations sociales. Ainsi, en 2024, la CSG-CRDS collectait 6,4% du PIB, les cotisations salariés 5,9 % du PIB (contre 7,7% en 1990), les cotisations patronales 13,7% du PIB (contre 14,6% en 1990). La CSG pèse pour 70% sur les revenus d’activité, pour 18% sur les revenus de remplacement et pour 12% sur les revenus du capital.
Les retraités payent la CSG-CRDS à un taux plus élevé que celui des actifs, une fois corrigé du financement de l’assurance chômage (8,8% contre 8,23 %). Les retraités à faible revenu bénéficient de taux réduits, ce qui n’est pas le cas des salariés à faible revenu[3] mais ceux-ci bénéficient de la prime d’activité : un salarié célibataire au SMIC paie 172 euros de CSG-CRDS, mais reçoit 277 euros de prime d’activité. Les retraités paient la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) au taux de 0,3% égal au taux employeurs de la CSA (Contribution de Solidarité pour l’Autonomie) sur les salaires. Sur les retraites complémentaires versées par l’AGRIC-ARRCO et l’IRCANTEC est prélevée une cotisation maladie au taux de 1%, dont sont bizarrement exemptées les retraites complémentaires des non-salariés et les retraites de la fonction publique.
Les retraités ne supportent pas de cotisations maladie et famille qui équivaudraient aux cotisations sociales employeurs maladie et famille (CSE). Que les personnes âgées qui sont les grands bénéficiaires des dépenses de santé ne paient pas de cotisation maladie peut sembler choquant. Toutefois, on peut arguer que les personnes âgées ayant à peu près le même niveau de vie que les actifs, une réforme qui diminuerait spécifiquement leur pouvoir d’achat serait injuste ; on peut arguer que chacun pendant sa période d’activité paie des cotisations qui lui donne le droit à une retraite satisfaisante et à des soins de santé, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui faire payer de surcroit des cotisations santé durant sa retraite. Enfin, en moyenne, un salarié paie 25 euros pour sa complémentaire santé (soit, en moyenne, 1% de son salaire net), un retraité paie 155 euros (soit, en moyenne, 10 % de sa pension nette) ; de sorte que le transfert des remboursements de la Sécurité sociale vers les complémentaires santé pèse déjà lourdement sur les retraités.
Quelles réformes ?
Les cotisations employeurs, maladie et famille, représentent, en 2025, 120 milliards d’euros, soit 10% des salaires bruts avec des taux progressifs du fait des exonérations de cotisations, soit 0% au niveau du SMIC, 10,45 % pour les salaires de 1,6 à 2,5 SMIC, 16,45 % pour les salaires de 2,5 à 3,5 SMIC, 18,25 % au-delà de 3,5 SMIC. Ce caractère progressif sera difficile à conserver dans la réforme.
Environ 22 milliards, soit 1,8 point, correspondent aux indemnités journalières maladie-maternité, qu’il est normal de financer par des cotisations. Reste 100 milliards. Compte-tenu des masses respectives des salaires et des retraites, ces 100 milliards devraient porter pour 75 milliards sur les salaires, pour 25 milliards sur les retraites, si on souhaite une charge équivalente pour ces deux types de revenu.
Plusieurs modalités de réformes sont possibles. On peut les classer en trois catégories.
La première doit être écartée d’emblée : supprimer les cotisations patronales maladie et famille et les remplacer par de la CSG provoquerait un transfert de 100 milliards des ménages vers les entreprises, soit une baisse immédiate de 6% des salaires et des retraites nets.
Dans la deuxième catégorie, se trouvent trois projets. Le premier serait d’élargir l’assiette des cotisations employeurs à l’ensemble de la valeur ajoutée des entreprises, donc de taxer l’EBE (ou l’EBNE) comme les salaires, comme le faisait la CVAE. Cette réforme a déjà longuement été discutée à la fin des années 90[4]. Elle est parfois préconisée pour faire contribuer les revenus du capital, donc, les machines, au financement de la protection sociale. Elle aurait aussi l’avantage de faire passer une partie de la charge sociale des entreprises de main d’œuvre aux entreprises capitalistiques. Elle a été repoussée à l’époque avec l’argument qu’elle nuirait spécifiquement à l’industrie et à la nécessaire robotisation de l’économie.
Le deuxième projet consisterait à utiliser les ressources de la taxe carbone pour compenser la suppression des CSE maladie et famille[5]. Cette affectation limiterait le caractère inflationniste de la taxe carbone ; elle induirait un double dividende : « moins d’émission de carbone, plus d’emplois ». Cependant, l’évolution du produit de la taxe carbone reste difficilement prévisible. L’objectif « financer la protection sociale » est contradictoire avec l’objectif « supprimer les émissions de carbone ». Surtout les citoyens auraient l’impression que la hausse des prix de l’énergie, qui pèserait plus fortement sur les plus pauvres, servirait à « faire des cadeaux aux entreprises ». Il est politiquement préférable d’utiliser le produit des taxes écologiques à des fins écologiques, comme financer la rénovation des logements, subventionner les ménages les plus pauvres, les plus touchés.
La troisième option serait de faire financer les prestations maladie et famille par la TVA, c’est le projet de « TVA sociale ». Elle aurait le défaut de priver la Sécurité sociale d’une ressource autonome. Surtout, la TVA n’est guère différente du point de vue économique des cotisations employeurs. Contrairement à son nom, la TVA n’est pas une vraie TVA. Déductible sur l’investissement, elle ne pèse pas sur le capital ; donc, comme les CSE, elle ne pèse que sur le travail. Comme les CSE, la TVA pèse plus sur les entreprises de main d’œuvre que sur les entreprises capitalistiques et incite les entreprises à utiliser plus de capital et moins de travail. Une vraie TVA pèserait aussi sur le capital (ou sur l’EBE), c’est le cas de la CVAE, la Contribution à la Valeur Ajoutée que malheureusement le gouvernement est en train de supprimer. De plus, le passage CSE/TVA augmenterait le coût du travail pour les emplois qui bénéficient actuellement des exonérations de CSE puisque les prix de leurs productions incorporeraient à plein la TVA sociale sans exonération spécifique.
Certes, à court terme, comme la TVA ne pèse pas sur les importations et est remboursé à l’exportation, le passage CSE/TVA fournirait des gains de compétitivité. Ce serait une dévaluation interne. Les prix des produits importés augmenteraient, ceux des produits français vendus en France resteraient en principe stable, ceux des produits exportés diminueraient. Mais, comme lors d’une dévaluation, le pouvoir d’achat des salariés (et des retraités) baisserait (car ils devraient payer plus cher les produits importés). Donc, soit les salaires (et les retraites) nominaux resteraient fixes et la mesure augmenterait la compétitivité française au détriment des salariés, soit les salariés (retraités) obtiendraient une hausse de leurs salaires (retraites), pour maintenir leur pouvoir d’achat ; cela enclencherait une boucle prix-salaires de sorte que l’inflation augmenterait et qu’à terme les gains de compétitivité disparaitraient. La TVA sociale ne permet de gagner en compétitivité que si le pouvoir d’achat des salariés diminue ; elle n’améliore les finances sociales que si les retraites ne sont pas indexées. Ce n’est pas un impôt miracle qui permettrait de faire financer notre protection sociale par les producteurs étrangers. Son grand avantage est purement psychologique : les producteurs ne la ressentent pas comme une charge. Le passage des CSE à la TVA ne pèserait pas spécifiquement sur les retraites, sauf si celles-ci étaient désindexées.
Nous en arrivons enfin aux mesures qui modifieraient le partage de la charge entre actifs et retraités. La première consisterait à supprimer les cotisations employeurs maladie et famille tout en imposant aux entreprises d’augmenter les salaires de 8,2 % ; le taux de CSG sur les salaires et les retraites serait ensuite augmenté de 6 points. Ainsi, une baisse de 6% des retraites (6,5% en net) financerait une hausse de 1,8 % des salaires (2,25 % en net) ; le ratio moyen retraites nettes/salaires net passerait de 66% à 60,3 %. Se pose une question juridique : peut-on contraindre les entreprises à augmenter leurs salaires, d’autant que l’opération ne serait pas neutre, favorisant les entreprises à salaires élevés au détriment des entreprises à bas salaires ? Cette réforme maintiendrait une ressource spécifique pour la Sécurité sociale. Par contre, elle augmenterait le coût du travail pour les bas salaires[6]. Elle accélérerait la paupérisation relative des retraités prévue dans les projections officielles.
La deuxième, plus facile à mettre en œuvre, consisterait à supprimer les 8,2 points de CSE maladie et famille en augmentant de 8,2 points les CSE retraite. Parallèlement, les cotisations retraite des salariés seraient diminuées de 8,2 points et la CSG augmenterait de 6 points pour financer la maladie et la famille. Les ressources de la branche vieillesse seraient maintenues. Comme avec la mesure précédente, une baisse de 6% des retraites financerait une hausse de 1,8 % des salaires. Par contre, il ne serait plus nécessaire d’imposer une hausse des salaires bruts. Les exonérations de cotisations employeurs pourraient être maintenues. Le gain pour les salariés serait relativement faible (2,25% en net) ; la perte serait sensible pour les retraités (6,5% en net).
Pour conclure, l’anomalie que représente l’assiette actuelle des cotisations sociales employeurs maladie et famille peut être corrigée de deux façons, soit en remplaçant ces CSE par de la TVA, ce qui serait neutre à long terme, mais se traduirait à court terme par une dévaluation interne (gain temporaire de compétitivité, perte de pouvoir d’achat et hausse de l’inflation), soit en remplaçant les CSE par de la CSG, ce qui induirait un transfert des retraités vers les actifs.
Mots-clés : Protection sociale – Budget – Financement
[1] Par ailleurs, la protection sociale bénéficie de ressources fiscales, soit comportementales (droits sur l’alcool, sur le tabac…), soit compensant les exonérations de cotisations sociales employeurs (TVA, taxe sur les salaires).
[2] Voir, par exemple, Olivier Nobile (2020), La bataille de la cotisation : renouer avec la dimension salariale de la Sécurité sociale, Respublica, Septembre.
[3] Le Conseil Constitutionnel a refusé que la CSG dépende du niveau du salaire puisque tout prélèvement progressif doit être familialisé. C’est pourquoi le taux de CSG des retraités dépend de Revenu Fiscal de Référence de leur ménage et non du montant de leur retraite. Le Conseil n’a pas eu cette exigence pour les exonérations de cotisations employeurs.
[4] Voir Henri Sterdyniak et Pierre Villa (1998) : « Pour une réforme du financement de la Sécurité sociale », Revue de l’OFCE, n°67 ; Edmond Malinvaud (1998) : « Les cotisations sociales à la charge des employeurs », Rapport du CAE.
[5] Voir Jean-Charles Hourcade et Emmanuel Combet (2027) : Fiscalité Carbone et finance climat, Les petits matins.
[6] Sauf à imaginer une hausse différenciée des salaires et une CSG rendue progressive, ce qui imposerait qu’elle soit familialisée, ce qui rendrait nécessaire un bouleversement complet de son fonctionnement.
- Faut-il faire payer des cotisations sociales maladie aux retraités ? - 22 janvier 2026
- La Banque centrale peut-elle tout financer ? - 1 décembre 2025
- Quelques précisions de macroéconomie monétaire - 25 avril 2024

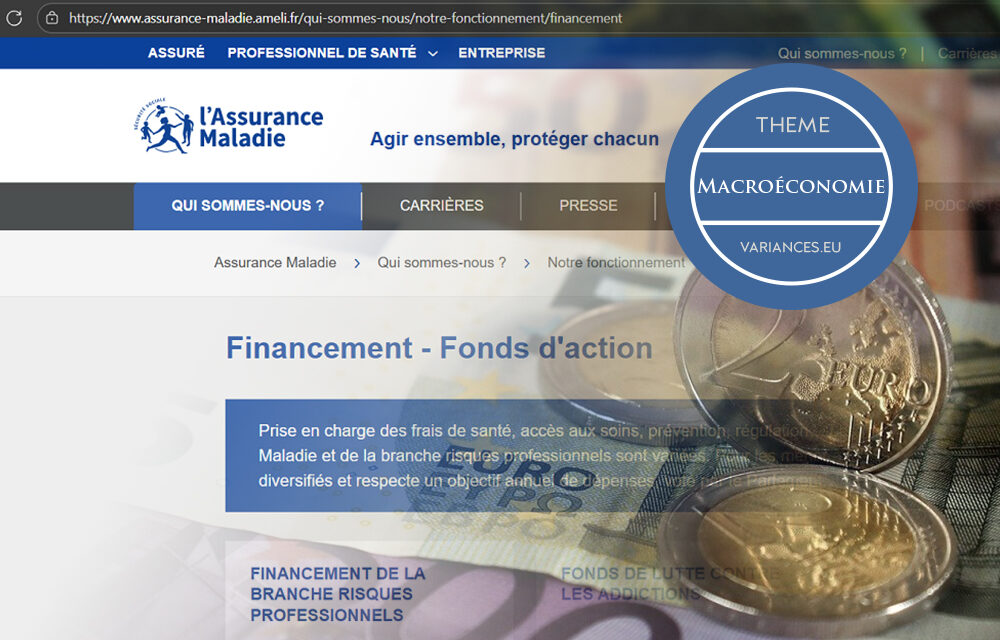
Ce sujet crucial rarement abordé parce que compliqué techniquement et politiquement mérite en effet une étude en profondeur.
Merci.
Il soulève bien des points de notre situation économique actuelle résultat de 50 ans de choix dont nous payons les défauts aujourd’hui.
Il est clair que le système de financement des organismes sociaux doit être repensés.
Comment imaginer ne pas repenser la participation des entreprises à un moment où elles sont pour beaucoup en grande difficulté et les emplois menacés ? Effectivement la CVAE est une piste intéressante en considérant les gains de productivité dus au progrès techniques mais si on avait fait le nécessaire pour garder les entreprises en France au lieu de délocaliser à tout va et de continuer à brader le patrimoine industriel ( voir le livre de Marleix entre autre. Montebourg le dénonce depuis longtemps…) l’assiette de cette CVAE serait plus copieuse.
Augmenter les prélèvements aux retraités est quand même limite parce que ce sont des revenus qu’ eux-mêmes ont financé en amont.
Augmenter la TVA dans un moment de tensions inflationnistes largement sous-estimées dans les chiffres officiels…
Tout ceci n’est pas simple dans un pays qui n’a plus de souveraineté monétaire ( pendant les » Trente Glorieuses » l’État se finançait directement à la Banque de France avec le » système Bloch-Lainé » ou » circuit du Trésor « …), qui n’a plus de réelle souveraineté politique tant nous sommes soumis à Bruxelles…Des études montrent que depuis le début de l’UE le PPA des Français qui était alors au niveau des USA a été divisé par deux !
Bref, comment ne pas penser que nous n’avons pas les mains libres.
En tous cas, encore merci à monsieur Sterdyniac de mettre les choses à plat.