Cet ouvrage de Robert Gordon, qui a fait un certain bruit au moment de sa parution l’an dernier, décrit les grandes évolutions de la société américaine de 1870 à nos jours, en prenant le point de vue des ménages, à la fois en tant que consommateurs, travailleurs et acteurs de la transformation sociale. Au croisement de l’histoire économique, de la théorie macroéconomique de la croissance, de la statistique, de l’économie industrielle (avec une description assez détaillée des innovations majeures des processus de production dans différents secteurs), de la sociologie, de la démographie, il constitue l’une des illustrations les plus complètes qu’il m’ait été donné de lire, de ce que peut être la contribution de l’économiste à l’analyse des grandes tendances de nos sociétés.
L’ouvrage est articulé en trois grandes parties : les deux premières sont segmentées par époque (de 1870 à 1940, puis de 1940 à 2014) et composées de chapitres centrés successivement sur les structures sociales, l’alimentation, l’habillement, l’habitat, les transports, les communications et les loisirs, la santé, les conditions de travail et les conditions financières; la troisième est destinée à analyser les ressorts de la croissance passée aux Etats-Unis pour en tirer des perspectives à long terme, et une postface évoque quelques mesures possibles pour tenter de redresser le potentiel de croissance de l’économie américaine, dont Gordon considère qu’elle demeurera faible au cours des prochaines décennies. Ses messages les plus puissants sont les suivants :
- la croissance du PIB par tête a fortement sous-estimé les progrès en matière de qualité de vie pendant la première moitié du 20ème siècle, alors que cette période a été le théâtre d’avancées majeures, dont les deux éléments phares sont les applications de la découverte de l’électricité et du moteur à combustion. Gordon cite notamment l’arrivée de l’électricité dans les foyers américains, processus quasiment achevé en 1940, le remplacement des chevaux, source de pollution majeure dans les villes américaines, par les automobiles : sait-on que dès 1930 le nombre de véhicules immatriculées représentait 90 % de la population américaine, alors qu’encore dans les années 1880 environ 100000 chevaux assuraient le transport dans les grandes villes américaines ? Et pourtant, nous rappelle Gordon, ce n’est qu’à partir de 1935 que les automobiles ont été incluses dans l’indice des prix à la consommation, qui a donc totalement négligé tous les progrès des deux décennies antérieures ! L’espérance de vie de la population blanche à la naissance est ainsi passée de 45 ans en 1870 à 64 ans en 1940 et 78 ans en 2010[1]. Malgré les progrès remarquables de la médecine au cours de ces décennies, l’auteur montre d’ailleurs que cette amélioration de l’espérance de vie s’explique avant tout par des mesures de santé publique, en particulier par l’équipement des foyers en eau courante et la mise en place de systèmes d’assainissement d’eaux usées, l’amélioration des logements urbains, mais aussi par la régulation du secteur de l’alimentation, sans parler de la disparition des excréments de chevaux, source de pollution considérable dans les villes jusqu’au début du 20ème siècle. Toutes ces évolutions ont permis l’amélioration de la qualité des produits alimentaires commercialisés, alors qu’à la fin du 19ème siècle les consommateurs urbains avaient accès à des laits souvent frelatés et à des viandes avariées. L’amélioration de la santé publique s’est ainsi traduite par une forte chute du taux de mortalité infantile, passé de 175 pour 1000 en 1870 à 43 pour 1000 en 1940 et 6,8 pour 1000 en 2010. Dans la seconde moitié du 20ème siècle, c’est l’allongement de la durée de vie des plus âgés qui a pris le relais pour contribuer à une nouvelle étape d’allongement de l’espérance de vie. La période de 1870 à 1940 a également été très bénéfique à la condition des femmes qui, il y a 150 ans, passaient un nombre d’heures considérable à réaliser des tâches ménagères telles que le transport de l’eau, la préparation des repas, la confection des vêtements et la lessive.
- seconde idée forte, les progrès de productivité ne sont pas constants dans le temps. En décomposant les gains de productivité horaire du travail entre un élément lié aux progrès en matière d’éducation, un second à l’accroissement de l’intensité capitalistique et à la productivité totale des facteurs (PTF) représentative de l’intensité de l’innovation, Robert Gordon montre que c’est le facteur PTF qui a significativement varié suivant les périodes : il a ainsi crû de 1,8 % par an de 1870 à 1920, puis de 2,8 % par an de 1920 à 1970, pour revenir à 1,6 % depuis 1970 (et beaucoup moins au cours des années récentes, comme on le verra plus loin). C’est paradoxalement au cours des décennies 1930 et 1940 que l’innovation a été la plus intense. Les années 1930, dont on se souvient surtout comme celles de la grande Dépression, sont également, nous dit Gordon, celles qui ont vu la pleine diffusion des grandes inventions de la fin du siècle précédent. Elles ont également été celles du New Deal qui a conduit à une progression significative des salaires et à des mesures de relance de l’investissement. Quant à la décennie suivante, elle se caractérise évidemment par l‘effort de guerre – le capital installé pendant les 5 années de guerre a représenté environ 50 % du stock de capital existant en 1941- et une mobilisation collective spectaculaire de la population qui a entraîné de grands progrès dans l’efficacité des processus de production, dont les effets ont continué à se faire sentir au cours des deux décennies suivantes. Ces dernières ont également bénéficié du plein impact du GI Bill, qui a offert aux combattants de la deuxième guerre mondiale la possibilité d’effectuer des études universitaires aux frais de l’Etat, et d’un ambitieux programme d’infrastructures, notamment routières[2].
- en continuant son analyse des différents postes de la consommation, Robert Gordon montre que l’innovation a fortement ralenti depuis les années 1970, à l’exception de la généralisation de l’air conditionné dans les logements, de la sécurité et du confort accrus du transport automobile, du développement du transport aérien et bien sûr des progrès en matière de communication et de loisirs, mais qui sont loin d’avoir un impact aussi déterminant sur les conditions de vie de la population que ceux de la période précédente. Pour Gordon, la société américaine d’aujourd’hui ressemble beaucoup plus à celle de 1970 que cette dernière à celle des années 1920. Il souligne d’ailleurs que dans un certain nombre de domaines, la situation des Etats-Unis aurait plutôt tendance à se dégrader, évoquant notamment la forte augmentation de l’obésité, qui touchait déjà 27 % des Américains en 2000, surtout dans les classes défavorisées; on apprend à ce sujet que l’absorption de calories quotidiennes a été stable aux Etats-Unis de 1870 à 1970, mais avec une forte diversification d’un régime alimentaire dominé par la viande – porc à tous les repas- et les céréales au 19ème siècle, avant d’enregistrer une progression de 20 % au cours des trois décennies suivantes. Parmi les autres éléments de préoccupation mentionnés figurent le plafonnement des progrès en matière d’espérance de vie[3], la forte montée des inégalités sociales ou la dégradation des indicateurs d’éducation : en termes de taux de « high school graduation», ou selon une terminologie française de proportion d’une tranche d’âge parvenant au baccalauréat, les Etats-Unis sont ainsi rapidement passés de la deuxième place en 2000 à la 11ème en 2013 parmi les pays développés. Le constat est d’ailleurs d’autant plus préoccupant que – statistique glaçante – les 2/3 des Noirs ayant abandonné leurs études avant l’équivalent du baccalauréat effectuent un séjour en prison avant l’âge de 40 ans, ce qui de facto leur ferme l’accès à de nombreux emplois.
- on l’aura compris, Robert Gordon ne s’inscrit pas dans le camp des « technoptimistes », qui considèrent que le développement d’Internet et des nouveaux modes de communication sera à l’origine d’une nouvelle vague d’innovation et permettra un nouvel âge d’or de l’économie américaine. Il rejoint ainsi Daron Acemoglu[4] qui a montré que l’impact des industries ICT (Information, Communication et Technologie) sur la productivité n’était visible que sur les secteurs en question, qui ne représentent qu’une modeste part du PIB, mais non sur le reste de l’économie. On a bien observé, pendant la décennie 1994-2004, un rebond de la productivité, lié au développement des nouvelles technologies et à son corollaire en termes de fonctionnement des entreprises, mais le soufflé est vite retombé. Gordon cite d’ailleurs plusieurs indicateurs convaincants qui viennent conforter l’observation d’un ralentissement de la productivité totale des facteurs depuis 2004 :
- la baisse du rythme des créations d’entreprises,
- le ralentissement de la capacité manufacturière, qui avait connu un fort pic autour de l’année 2000,
- la nette baisse du ratio de l’investissement net des entreprises à leur stock de capital,
- les moindres progrès en matière de performance des ordinateurs,
- et le ralentissement des transactions boursières (?).
Gordon essaie ensuite d’anticiper les innovations à venir, dans les domaines de la santé et de l’équipement médical, de la robotisation, du big data et de l’intelligence artificielle et des véhicules automatiques, pour en conclure qu’aucune n’est susceptible d’avoir des effets majeurs sur le potentiel de croissance.
– Le constat de Gordon est d’autant plus préoccupant que plusieurs vents contraires (headwinds) risquent de peser sur le potentiel de croissance de l’économie américaine, citant particulièrement :
- les évolutions démographiques: la grande phase d’insertion des femmes sur le marché du travail, qui s’est opérée à partir des années 1970, est désormais derrière nous, tandis que l’on observe une baisse du taux de participation, à la fois pour les âges élevés avec l’arrivée des baby-boomers à la retraite, et pour les jeunes dont l’insertion sur le marché du travail est de plus en plus difficile. Gordon cite également le cas de plusieurs villes désindustrialisées du MidWest dont plus de 40 % de la population d’âge supérieur à 18 ans s’est retirée du marché du travail et dépend de transferts sociaux.
- la montée des inégalités, qui voit une partie de la population de facto exclue du marché du travail, et se traduit par un écart significatif (que Gordon chiffre à 0,4 point par an) entre croissance du revenu disponible moyen et médian par tête.
- la fin des progrès en matière d’éducation, liée à l’envolée des coûts d’éducation et de la dette des étudiants, conduisant à une forte baisse du college premium, prime reflétant le surcroît de rémunération dont bénéficient les diplômés universitaires au cours de leur carrière professionnelle. Gordon fait observer – le lecteur français ne le sait pas forcément – que les Etats-Unis ne disposent pas de système public d’éducation d’âge préscolaire; les enfants des familles socialement défavorisées des minorités raciales entrent ainsi à 4 ans dans le système scolaire avec un retard considérable qu’ils ne parviennent généralement pas à rattraper.
- le poids de l’endettement public, qui s’accroîtra inexorablement avec la progression des dépenses de retraite et de santé, et se traduira inévitablement par une hausse de la fiscalité.
Synthétisant ces différents éléments, Gordon prévoit une croissance tendancielle de la production par tête de 1,2 % au cours des prochaines décennies, mais en prenant en compte les effets du ralentissement des progrès en matière d’éducation, de l’augmentation prévisible des impôts et de l’écart observé et sans doute extrapolable, entre revenu moyen et médian, on parvient à une progression attendue de 0,3 % par an du revenu disponible brut médian par tête, scénario d’autant plus préoccupant par sa faiblesse que l’on peut considérer les hypothèses retenues par Gordon finalement assez optimistes au vu des constats qu’il dresse.
Gordon termine son ouvrage par un spectre assez large de préconisations, allant, en matière économique et fiscale, d’une augmentation de la progressivité de l’impôt pour les revenus les plus élevés et l’augmentation du salaire minimum; dans le domaine éducatif, à la généralisation de l’éducation d’âge préscolaire et à la maîtrise des coûts de la formation universitaire; mais aussi en matière sociale une réduction des peines d’incarcération, un élargissement de la légalisation de la vente de drogue ou l’ouverture de l’immigration.
En conclusion, il s’agit d’un ouvrage majeur par le large spectre des thèmes abordés, la richesse et la variété de ses sources et des statistiques qu’il nous livre, vrai plaisir pour ceux qui s’intéressent aux chiffres et à leur remise en perspective historique. Et si l’auteur a choisi de se focaliser uniquement sur l’économie américaine, et met en avant certains traits spécifiques aux Etats-Unis, tant sous un angle positif (dynamisme de l’innovation et de l’entrepreneuriat, qualité de la recherche) que négatif (dans l’ampleur des inégalités, l’absence de système de couverture sociale universelle et la dégradation des indicateurs de santé), les leçons à en tirer sont évidemment pertinentes pour l’Europe, dont le potentiel de croissance est encore plus faible que celui des Etats-Unis.
[1] On supposera que l’auteur ne cite pas les chiffres relatifs à la population noire car ceux-ci manquaient de fiabilité en 1870…
[2] Gordon analyse de manière très convaincante la manière dont les politiques publiques ont entraîné la prééminence du transport automobile, au détriment du transport ferroviaire, aujourd’hui quasiment inexistant, alors qu’il avait bénéficié d’investissements considérables à la fin du 19ème siècle, permettant la constitution d’un réseau très dense.
[3] On se tournera avec intérêt à ce sujet vers les travaux du récent prix Nobel d’économie Angus Deaton, qui a mis en évidence une diminution récente de l’espérance de vie de la population blanche masculine d’âge moyen sous l’effet notamment de l’augmentation des suicides et de la consommation de stupéfiants.
[4] Acemoglu, D., D Dorn, G. H. Hanson, and B. Price. 2014. “Return of the Solow Paradox? IT, Productivity, and Employment in US Manufacturing.” The American Economic Review 104(5): 394–99.
- Merci ! - 30 octobre 2023
- Stratégie d’allocation d’actifs : couvrir ou ne pas couvrir le risque de change ? - 27 juillet 2023
- Investing with external managers – A report by Norges Bank Investment Management - 22 mai 2023

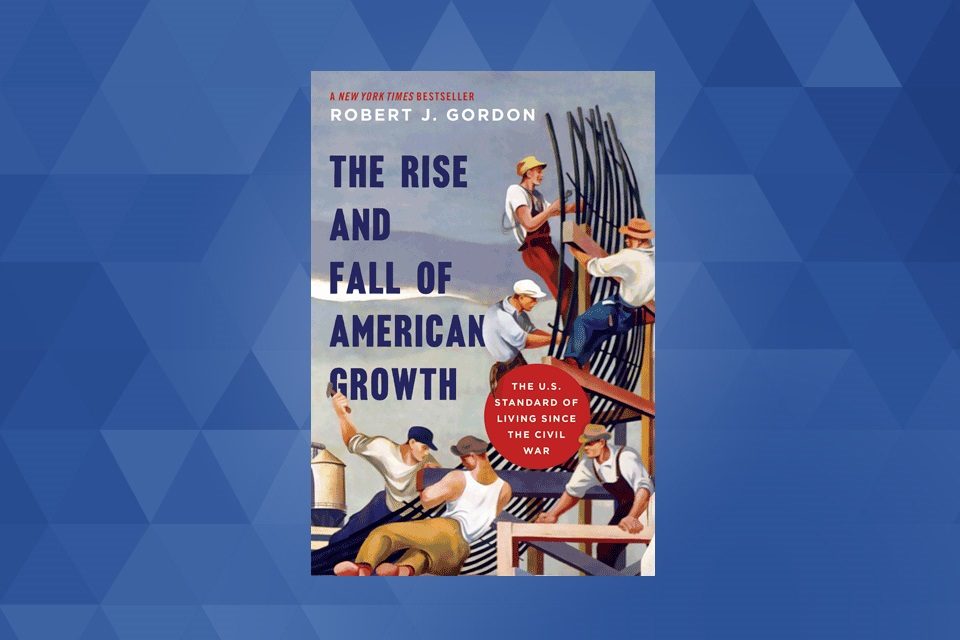

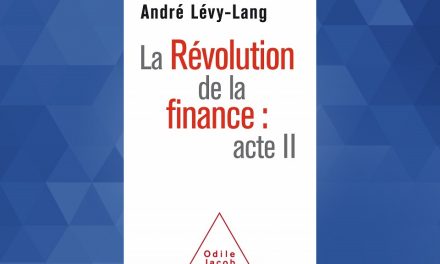


Commentaires récents