A l’occasion de la sortie de son livre « Libérer le travail. Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi cela doit changer« , Thomas Coutrot – dont le portrait a été publié dans le variances n°38, répond aux questions de variances.eu
Thomas, peux-tu tout d’abord nous rappeler ton parcours depuis l’ENSAE ? Et peux-tu nous décrire ton engagement auprès des « Economistes atterrés » ?
Après l’ENSAE, j’ai été chargé d’études au Centre d’étude des revenus et des coûts (CERC) dans les années 80, puis j’ai passé trois ans à l’Université de Brasilia, avant d’intégrer le service des études du Ministère du travail (aujourd’hui la Dares), où j’anime désormais le département « Conditions de travail et santé ». J’ai milité en parallèle dans Attac (dont j’ai été porte-parole de 2009 à 2016) et j’ai co-fondé en 2011 l’association des Economistes atterrés, dans le but de contester la rationalité économique des politiques néolibérales. Le « Manifeste d’économistes atterrés », que j’ai rédigé en 2011 avec Philippe Askenazy, André Orléan et Henri Sterdyniak, montrait pourquoi les politiques d’austérité ne pouvaient qu’aggraver les difficultés et risquaient de mener à l’éclatement de l’Union européenne. La fracture qui ne cesse de s’aggraver entre le Nord et le Sud de l’UE a confirmé nos craintes, tout comme le Brexit et la victoire de Trump : le néolibéralisme fait exploser les inégalités, renforce l’autoritarisme et menace le lien social.
Tu viens de publier « Libérer le travail. Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi cela doit changer » aux éditions du Seuil. Un titre paradoxal, alors qu’on fait plus souvent référence à la libération des humains. Quels sont les principaux messages de cet ouvrage ?
J’ai résumé ici pour vous ces messages en 12 thèses, que je m’efforce (sauf pour la dernière, plus spéculative) d’étayer solidement, tout au long de l’ouvrage, par les acquis des sciences du travail (psychologie, épidémiologie, ergonomie, sociologie, histoire, économie et gestion) :
- L’activité de travail se réalise dans la nécessaire confrontation entre le travail concret et vivant (l’inventivité humaine) et le travail abstrait et mort (les équipements, les consignes et objectifs, les dispositifs disciplinaires, le capital).
- Le déploiement (ou la répression) du travail vivant construit (ou sape) la reconnaissance et le pouvoir d’agir des personnes, donc leur santé.
- Le travail vivant fait prospérer (ou étouffer s’il est réprimé) les dispositions critiques et créatives des personnes, donc la citoyenneté et la démocratie.
- Il permet (ou empêche) chacun.e de prendre soin des autres et de la nature.
- Il est vital pour les individus, l’environnement et la démocratie ; le travail n’est donc pas une affaire privée mais un enjeu politique majeur.
- Le management par et pour les chiffres, antinomique à ces enjeux, met en péril le travail vivant, et plus généralement la vie.
- Le syndicalisme est resté prisonnier de la logique quantitative et mutilante du travail abstrait.
- Les menaces sur le travail vivant suscitent, dans les milieux managériaux et syndicaux et bien au-delà, la recherche de nouvelles pratiques sociales émancipatrices autour du careet du travail collaboratif.
- La logique écoféministe du care, de l’attention au monde, ouvre la voie au dépassement du travail abstrait.
- Les nouvelles formes collaboratives d’organisation fondées, comme le vivant, sur le principe de subsidiarité, sont plus fécondes que la hiérarchie, tant aux plans économique que démocratique.
- L' »entreprise libérée » voit ses promesses étouffées par la logique actionnariale et financière.
- Pour vraiment « libérer le travail », il faudra instituer le travail concret et gouverner l’économie autrement, par la délibération démocratique, au service de la vie.
Dans une perspective historique longue, on peut constater un certain nombre d’avancées sociales : le taylorisme, basé sur la parcellisation du travail et donc la répétition de gestes toute la journée, a laissé la place à une plus grande diversité des tâches… On dirait pourtant que la souffrance au travail que tu évoques est plus marquée aujourd’hui. Comment l’expliques-tu ?
Les enquêtes sur le travail, que je dirige à la Dares, montrent au contraire une hausse importante du travail répétitif au cours des 20 dernières années, ainsi qu’une baisse de l’autonomie dans le travail. Non seulement le travail industriel à la chaîne n’a pas reculé, mais l’organisation néo-taylorienne s’est généralisée dans les services (logistique, centres d’appels, banques, hôpitaux, soins à domicile…). En outre les changements organisationnels (restructurations, filialisations, privatisations, délocalisations, etc) se succèdent à un rythme effréné qui insécurise les salariés, y compris dans le secteur public. La gouvernance par les nombres, dans le privé et le public, mutile le sens du travail, les salariés souffrant fréquemment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Face à la montée des risques psychosociaux et de la souffrance au travail, les chefs d’entreprise ont réagi non pas principalement en améliorant l’organisation du travail dans un sens plus collaboratif (ce qui serait de la prévention « primaire », à la racine), mais en multipliant les démarches de prévention « secondaire » visant les symptômes : formations à la gestion du stress, cellules de soutien psychologique, détection précoce des salariés en difficulté… La dernière enquête française sur les conditions de travail (2016) montre que cela a permis de stabiliser la situation mais pas vraiment de l’améliorer.
Intelligence artificielle, big data, robotisation… La technologie n’est-elle pas le meilleur allié des travailleurs (et de la baisse de la durée du travail) ?
La technologie permet le meilleur comme le pire. L’histoire d’Internet, né dans les années post-68 d’une alliance entre hippies geeks et universités, a montré le potentiel extraordinaire des nouvelles technologies pour inventer de nouvelles formes de travail collaboratif, crowdworking, crowd intelligence, crowdfunding… Internet est ainsi devenu un bien commun de l’humanité mais les multinationales de la communication et Trump mènent une offensive pour supprimer la « neutralité du web » et privatiser Internet. Et dans la plupart des entreprises aujourd’hui, le numérique est utilisé non pas tant pour décentraliser les décisions et stimuler l’intelligence collective, que pour codifier, standardiser et contrôler le travail par des progiciels et des instruments de traçabilité. Le big data peut aussi bien permettre des gains fantastiques d’efficacité qu’un contrôle social généralisé. L’intelligence artificielle peut libérer les travailleurs des tâches routinières pour qu’ils déploient leur ingéniosité humaine ou au contraire réduire le travail à une prestation standardisée. Bref, tout dépend des objectifs de ceux qui déploient les technologies : il n’y a aucun déterminisme technologique mais bien un déterminisme politique. Malheureusement aujourd’hui, les travailleurs pèsent pour très peu, voire rien, dans les choix d’implantation.
En tant que statisticien de formation penses-tu que l’on dispose d’outils de mesure objectifs de cette souffrance ? Economistes, sociologues, statisticiens, politiques, syndicalistes… autant de médecins au chevet du malade. Devrions-nous entendre certains davantage ?
La souffrance ne peut être mesurée de façon « objective », mais il existe en médecine des échelles de douleur ressentie, validées scientifiquement. De même en épidémiologie de la santé au travail, il existe des modèles et des questionnaires validés pour mesurer l’exposition des travailleurs à divers risques psychosociaux, dont on connaît avec précision les conséquences sur la santé en termes de pathologies cardiovasculaires, musculo-squelettiques ou psychiques. Par exemple, selon le modèle de Robert Karasek, l’exposition à la tension au travail – combinaison d’une forte demande psychologique et d’une faible latitude décisionnelle – accroît en moyenne de 40% le risque de dépression, et d’autant le risque d’infarctus. On sait ce qu’il faudrait faire pour réduire ces risques : diminuer la pression au travail, accorder davantage de marges de manoeuvre, etc. Mais pour l’instant, peu est fait en la matière. Les expériences d’entreprises « libérées » qu’on voit se développer, y compris dans des grands groupes comme Michelin ou Auchan, n’ont pas encore fait leurs preuves en la matière.
On dirait également que ce débat est plus présent en France qu’ailleurs ? Est-ce bien le cas selon toi, et comment effectuer des comparaisons internationales en la matière ?
Oui et non. Le débat sur l’intensification du travail et la perte d’autonomie est quasi-universel, de nombreux travaux scientifiques existent sur ce sujet en Europe et dans le monde. Les concepts de souffrance éthique ou d’intensité émotionnelle du travail sont également présents dans la littérature internationale. Ce qui est plus spécifique à la France, c’est l’intensité du débat sur la souffrance éthique et les conflits de valeur : les travailleurs français, en particulier dans le secteur public mais pas seulement, sont particulièrement sensibles à l’amour du travail bien fait, et la souffrance infligée par la « qualité empêchée » (comme dit le psychologue du travail Yves Clot) semble plus intense dans notre pays. On le voit bien avec l’enquête sur les conditions de travail menée tous les cinq ans par la Commission européenne.
Tu soulignes l’impéritie des syndicats qui se sont érigés en contre-pouvoir du management en se battant sur des valeurs identiques, loin de celles du bien-être. Comment dans ce contexte intermédier la nécessaire réponse aux nouvelles aspirations des salariés ?
Les syndicats ont été enrôlés, dès le début du XXème siècle, dans l’idéologie scientiste du taylorisme, l’idée que les ingénieurs savaient mieux que les travailleurs comment organiser efficacement le travail. Avec le compromis fordiste, ils ont accepté d’échanger leur pouvoir d’agir dans le travail contre du pouvoir d’achat hors du travail. Mais aujourd’hui le pouvoir d’achat ne progresse que pour les plus riches, et l’aliénation dans le travail devient intolérable pour des jeunes générations plus éduquées et plus exigeantes. Le compromis fordiste est mort mais n’a pas de successeur. Certaines franges – minoritaires – du management ont compris cela et cherchent des formes d’organisation plus intelligentes, mais cela se heurte à l’obsession du contrôle. Certains syndicalistes – notamment à la CGT – ont aussi compris qu’ils retrouveraient l’oreille des salariés et un plus grand pouvoir d’agir s’ils étaient capables d’incarner ces aspirations à mieux travailler, d’aider les salariés à faire valoir le point de vue du travail vivant. Mais ils ont de grandes difficultés à transformer leur rapport aux travailleurs, à sortir du rôle d’avant-garde éclairée. Je pense qu’on va voir dans les années à venir une émulation intéressante entre initiatives patronales et syndicales pour répondre à ces aspirations.
Penses-tu que la féminisation du monde du travail observée notamment au cours des deux dernières décennies fait évoluer les attentes vis-à-vis de l’activité professionnelle ? Cette évolution sociétale ne sonne-t-elle pas le glas des schémas d’analyse actuels des syndicats issus d’une vision plus économiste que sociologique du monde du travail ? Comment en inventer d’autres, et lesquels ?
C’est une question décisive. La féminisation du monde du travail n’a pas seulement permis aux femmes d’acquérir une indépendance économique et de tisser des liens sociaux hors du foyer. Elle a aussi contribué à transformer le rapport des travailleurs à leur travail. C’est tout l’enjeu de la problématique du care : alors que l’idéologie techniciste et scientiste, fortement masculine, est indifférente aux effets concrets du travail sur les clients, les usagers ou la nature, le point de vue féminin y prête plus d’attention . Cette capacité de faire attention à ce que l’on fait au monde quand on travaille est évidemment capitale si on pense à la question écologique, mais aussi à la qualité des services et des produits, à la santé, à la cohésion sociale, etc.
L’enjeu est de trouver les médiations institutionnelles qui permettraient à cette attention de produire des effets à grande échelle.
Et du côté des entreprises, l’inscription dans la loi d’autres objectifs que la seule maximisation du profit irait-elle dans le bon sens ? Comment favoriser l’épanouissement du management humaniste que tu appelles de tes vœux ? Et que devrait-on apprendre aux étudiant.e.s formé.e.s aujourd’hui pour devenir les manageurs de demain ?
Précisément, parmi les innovations institutionnelles aujourd’hui nécessaires, figurerait l’obligation pour les entreprises de se fixer d’autres objectifs, qualitatifs, sociaux, écologiques, que la seule maximisation du profit. Le profit n’est évidemment pas un mal en soi, mais ce ne peut plus être un objectif prioritaire, cela doit devenir un moyen au service de finalités qualitatives. Il est d’ailleurs assez fascinant de constater que beaucoup des entreprises « libérées » qui ont renoncé à viser le profit maximum sont au bout du compte plus profitables que leurs concurrentes : si elles sont capables de trouver leur véritable raison d’être – une qualité de production, de relations, un apport unique au monde – , elles connaissent souvent une croissance remarquable et soutenable. Les manageurs devraient apprendre à lâcher prise…
Plus généralement, quelles solutions préconises-tu pour remédier à la situation que tu déplores ?
Je ne peux que vous renvoyer au dernier chapitre de mon livre, où j’essaie de dessiner ce que j’appelle une « politique du travail vivant », qui se fonde sur les expérimentations déjà en cours dans la société, pour viser leur généralisation à terme et leur renforcement institutionnel.
Cela suppose de repenser le financement des entreprises, leurs modes de gouvernance et de propriété, leurs objectifs, le fonctionnement du marché du travail, etc…
En conclusion, quel message voudrais-tu transmettre en priorité à nos lecteurs et lectrices ?
Puisque nous sommes entre économistes, je voudrais faire un peu de provocation à la réflexion avec le paradoxe suivant : Hayek a montré que la supériorité du marché sur la planification centralisée vient du fait que le marché permet aux acteurs économiques d’utiliser au mieux les informations dont eux seuls disposent localement, sur les risques, les opportunités et les coûts auxquels ils sont confrontés. Les acteurs de terrain n’ayant aucun intérêt à les révéler, bien au contraire, ces informations ne parviendront jamais au planificateur central. Mais comment justifier que la planification centralisée, discréditée comme mode de gouvernance de l’économie, persiste plus que jamais pour la gouvernance interne des entreprises ? De fait, les hauts dirigeants des multinationales élaborent des plans stratégiques à 5 ans et donnent des ordres détaillés à leurs subordonnés pour les réaliser, à peu près comme les bureaucrates du Gosplan soviétique et souvent avec le même manque de succès… N’est-il pas temps de faire pénétrer cette logique de l’efficacité informationnelle dans l’entreprise ? Et donc de décentraliser radicalement l’organisation du travail, tout en assurant sa cohérence par des mécanismes de coordination adéquats, ceux de la délibération démocratique ? Des modèles comme ceux de la sociocratie et de l’holacratie sont tout à fait passionnants de ce point de vue, et j’invite les lecteurs à s’y reporter.
Propos recueillis par Eric Tazé-Bernard (1978)
- Merci ! - 30 octobre 2023
- Stratégie d’allocation d’actifs : couvrir ou ne pas couvrir le risque de change ? - 27 juillet 2023
- Investing with external managers – A report by Norges Bank Investment Management - 22 mai 2023

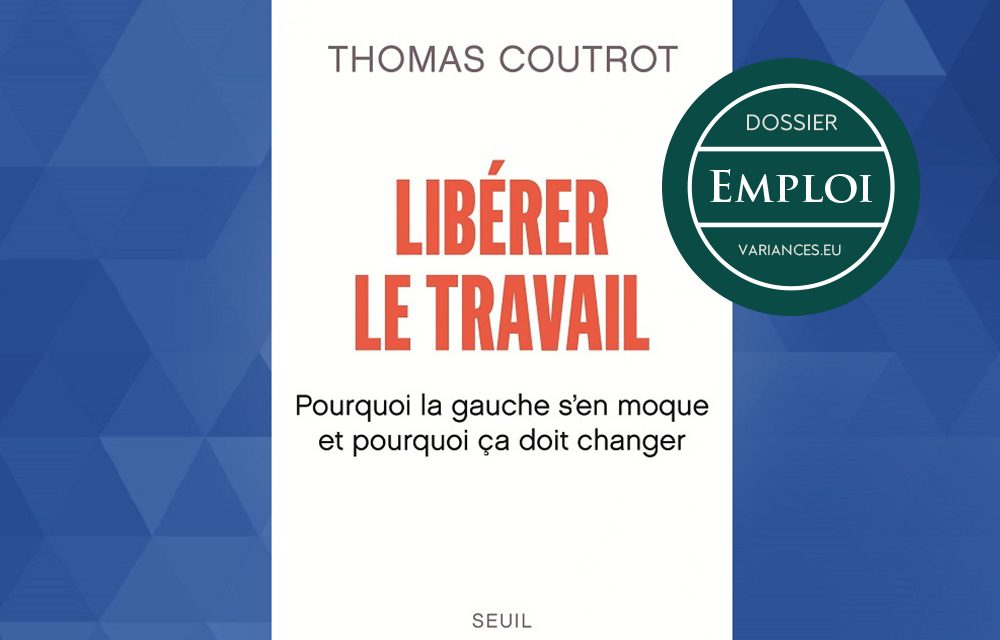
Commentaires récents