Adolphe Quetelet (1796-1874) est un des inconnus les plus connus du monde scientifique. Mathématicien de formation littéraire, astronome par amour des étoiles filantes, statisticien soucieux de contribuer à l’épanouissement de son pays et à sa renommée internationale, cet homme a laissé son nom dans l’Histoire grâce, entre autres, à son « homme moyen », à l’indice de masse corporelle ou encore au cratère de la lune qui porte son nom.
Cet homme prudent, attaché aux bienséances sociales, est loin d’être un révolutionnaire. Pourtant, Quetelet a eu quelques moments d’audace au cours de sa vie, qui n’ont pas été vains. Nous en présentons deux d’entre eux particulièrement importants.
Le premier se passe à Paris, en septembre 1823. Quetelet est alors âgé de 27 ans. Pour en comprendre l’importance, il est nécessaire de rappeler brièvement le parcours de ce personnage durant ses premières années.
L’éclosion d’un mathématicien
En 1795, la première République française annexe les contrées belges, alors sous domination autrichienne. La population a subi depuis 1789 six régimes politiques distincts, presqu’aussi décevants les uns que les autres. La Belgique française disparaît en 1815, à l’issue de la bataille de Waterloo qui met fin à l’époque napoléonienne. Le traité de Vienne la transforme cette année-là en la partie méridionale du Royaume-Uni des Pays-Bas.
Qu’en est-il des activités scientifiques belges durant cette période de vingt ans ? Elles sont pratiquement inexistantes. L’Académie de Bruxelles, fondée en 1772 par l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, a été supprimée par les autorités françaises en 1794 ; de plus, la seule université locale, située à Louvain et devenue peu à peu moribonde, disparaît à son tour en 1797. L’enseignement élémentaire se situe à un niveau déplorable.
C’est dans ce contexte que naît, à Gand, Adolphe Quetelet, le 22 février 1796. Son père, qui possède une quincaillerie, meurt en 1803 alors que le petit Adolphe entame ses études primaires dans un établissement privé. Ses qualités de bon élève lui permettent de suivre des études secondaires essentiellement littéraires dans le lycée de Gand nouvellement créé ; Quetelet achève brillamment ces études en 1813. Mais la joie est courte ; les contrées belges sont occupées par les Prussiens et les Cosaques suite à la défaite de Napoléon à Leipzig, en octobre 1813. Quetelet trouve de petits emplois pour subvenir à ses besoins : un poste d’enseignant primaire puis un autre dans un atelier de peinture. Apprenant qu’un emploi de professeur de mathématiques élémentaires est vacant dans son ancien lycée devenu collège, il pose sa candidature et est engagé, ce qui l’arrange en raison du caractère stable de la fonction, même si l’histoire et le latin l’attirent davantage que les mathématiques. Il est nommé le jour de son 19e anniversaire, trois mois avant la bataille de Waterloo.
Le traité de Vienne implique pour Quetelet un changement de nationalité – la Belgique française est devenue hollandaise – et lui offre l’opportunité de faire des études universitaires à l’Université de Gand, créée en 1816 par le gouvernement du Royaume-Uni des Pays-Bas. En juillet 1819, il devient le premier docteur en mathématiques de cette université, en rédigeant en latin une thèse consacrée à un sujet de géométrie, la « focale »[1]. Cela lui permet, d’une part, d’occuper un poste de professeur de mathématiques à l’Athénée de Bruxelles – un établissement d’enseignement secondaire – et, d’autre part, d’être élu membre de la classe des sciences de l’Académie royale de Bruxelles, réhabilitée en 1816.
Le mariage entre la Hollande marchande et protestante et la Belgique industrielle et catholique n’est pas équilibré. La contestation se fait sentir dans les milieux intellectuels de la capitale belge. Une Société des Douze voit le jour ; Quetelet en est un des douze membres fondateurs. Cette association « littéraire et gastronomique » comporte en son sein des contestataires qui veulent tous combattre les inégalités entre le nord et le sud du royaume. Certains feront de la prison pour leurs prises de position. Quetelet choisit une autre manière d’agir, plus conforme à son caractère : équiper les contrées belges d’une institution scientifique qui n’existe que dans le nord, un observatoire astronomique.
Quetelet convainc son ministre de tutelle du bien-fondé de son projet ; ce dernier lui obtient, durant l’été 1823, une bourse pour aller « se perfectionner » dans l’un des centres astronomiques réputés de l’époque : l’Observatoire de Paris.

Adolphe Quetelet, par le peintre Odevaere (1822)
De l’audace pour réussir
C’est ainsi qu’en septembre 1823, notre jeune enseignant de mathématiques élémentaires s’apprête à gravir les escaliers de l’Observatoire de Paris. Il vient à la rencontre des hommes qui font partie d’un cénacle de très haut niveau scientifique avec son projet. Quelle est la légitimité de sa démarche ? Quels sont ses arguments ? Il n’est pas astronome mais les étoiles filantes le font rêver. Il s’intéresse à la géométrie mais ses cours de mathématiques élémentaires, dispensés à des adolescents, sont assez loin de ce dont il aurait besoin pour justifier sa compétence dans un domaine où personne ne le connaît. En revanche, il va faire preuve pendant près de trois mois d’une audace qui va être payante. Laissons la parole à Quetelet qui s’adresse à son directeur de thèse dans une lettre datée du 21 octobre 1823 :
« Je suis ici dans un paradis […] Je vais quelquefois passer des journées entières à l’Observatoire ou chez Messieurs Mathieu et Bouvard où j’ai déjà rencontré plusieurs fois Monsieur Laplace. Je m’occupe ensuite des expériences électrodynamiques chez Monsieur Ampère, enfin je tâche de prendre tout ce que je puis prendre avec une avidité insatiable […] J’ai eu soin de vous rappeler au souvenir de Monsieur Lacroix […] Je lui ai remis un mémoire que je destine à notre Académie. Il a bien voulu le revoir. Monsieur Poisson chez qui je vais de temps en temps m’a parlé de vous […] Monsieur Cauchy ne tardera pas à faire paraître son calcul intégral. Il m’a déjà donné toutes les premières épreuves avec ses corrections. Je compte aller le voir un de ces jours. […] Je fais ici l’emplette de quelques instruments de physique les plus nouveaux, savoir : l’appareil de Monsieur Ampère pour toutes les expériences électromagnétiques, l’appareil de Monsieur Fresnel pour les expériences sur la lumière […] ».
Dans cette lettre, Quetelet ne parle pas de ses autres rencontres avec l’astronome François Arago, le mathématicien Joseph Fourier ou encore le naturaliste Alexandre de Humboldt. Quelle audace, mais quel investissement ! Quetelet écoute tous ces savants avec passion, les interroge sans arrêt, leur propose son aide pour lire un manuscrit ou leur fournir un renseignement. Son projet ne peut que leur plaire ! Il n’est pas étonnant que ces hommes l’aident à rédiger le rapport que cet enthousiaste doit remettre à son ministre. Et l’audace va payer… mais, lentement, car l’observatoire ne sera pas terminé avant 1832, année pendant laquelle Quetelet s’y installe avec le statut de directeur.
C’est aussi bien intéressant, la statistique
Devoir attendre huit ans pour voir son projet aboutir permet à Quetelet de s’adonner à de nouvelles activités. Certaines font partie de sa stratégie de persuasion : enseigner l’astronomie et la physique dans des cours publics pour adultes, créer une revue scientifique belge avec son directeur de thèse, utiliser l’Académie pour construire des réseaux de savants… Parmi les autres activités, deux disciplines nouvelles rapportées de Paris l’attirent. Il s’agit en premier lieu du calcul des probabilités dont il apprécie l’usage dans le domaine des assurances et qui lui donne l’occasion de proposer des Instructions populaires sur le calcul des probabilités, remarquables d’un point de vue pédagogique[2]. Ce petit livre est publié en 1828, l’année où le gouvernement le nomme astronome (sans observatoire !) et lui demande de renoncer à ses enseignements à l’Athénée.
Il y a par ailleurs la statistique que lui a fait découvrir Fourier. Ce dernier lui présente le docteur Louis-René Villermé, chirurgien pendant l’épopée napoléonienne qui s’est reconverti en s’intéressant à l’hygiène publique avec des analyses statistiques, dont un mémoire sur les prisons qui lui a permis d’être élu à l’Académie de médecine de Paris, en 1823. Quetelet se lance dans des études semblables en Belgique, ce qui lui permet d’ajouter une corde à son arc.
En 1831, Quetelet rédige trois mémoires importants, Recherches sur la loi de croissance de l’homme, Recherches sur le penchant au crime aux différents âges et Recherches sur le poids de l’homme aux différents âges. Ces mémoires fournissent une partie importante des matériaux pour un ouvrage dont l’impact sera important : Sur l’homme et le développement de ses facultés ou Essai de physique sociale (1835).
Les études statistiques contenues dans l’ouvrage de 1835 ont pour objectif « d’étudier, dans leurs effets, les causes soit naturelles soit perturbatrices qui agissent sur le développement de l’homme ». L’ouvrage est divisé en quatre parties, portant respectivement sur la population (démographie), l’anthropométrie (taille, poids, force), la statistique morale (suicide et penchant au crime) et la notion d’homme moyen « considéré comme une fraction de l’espèce », « dépouillé de son individualité », réduit à « être dans la société l’analogue du centre de gravité dans les corps ».
Quetelet a renouvelé la statistique de l’époque en recourant à des observations – que l’on qualifierait aujourd’hui de données numériques – plus ou moins nombreuses pour développer ce qu’on appellerait, toujours aujourd’hui, des modèles. Le calcul des probabilités s’est imposé à Quetelet dans ce rôle et a contribué à fonder sa Physique sociale. C’est par un usage éclairé des données numériques résultant de ses observations, que le calcul des probabilités l’a conduit aux concepts de statistique morale et d’homme moyen[3]. Ce dernier concept est le résultat d’une assimilation audacieuse, voire abusive, entre moyenne de mesures sur des individus distincts et moyenne de mesures multiples d’un même individu. Quetelet s’est permis de transposer les résultats de la théorie probabiliste des erreurs du domaine des sciences physiques et astronomiques à celui des sciences sociales. Cet appui sur la loi des grands nombres et la loi de Laplace Gauss – que Quetelet appelle « loi de possibilité » – résulte d’un coup de force (l’assimilation des deux types de moyennes) mais assure une plus grande efficacité des statistiques à rendre compte des régularités observées et permet d’étendre son rôle conjectural dans les sciences[4], ce qui est pensé par Quetelet dès 1835 et démontré dans un autre ouvrage magistral intitulé Lettres à S.A.R. le duc régnant de Saxe-Cobourg et Gotha, sur la théorie des probabilités, appliquées aux sciences morales et politiques (1846)[5].
Le point central de l’analyse réalisée par Quetelet est la nécessité de disposer de documents exacts et comparables. Cet objectif se traduit dans la Belgique indépendante par la création, en 1841, d’une Commission centrale de statistique. Quetelet en sera le président jusqu’à sa mort, soit pendant trente-trois ans. L’une des premières tâches de la commission est d’établir le « chiffre de la population du royaume ».
En 1849, le prince consort Albert d’Angleterre décide d’organiser à Londres une exposition universelle qui doit se tenir deux ans plus tard. Il sollicite la collaboration de son ancien professeur pour préparer ce grand événement. En 1851, Quetelet propose « …d’inviter à se réunir en un congrès de statistique universelle, en septembre 1852, à Bruxelles, les savants des différentes parties du monde qui s’occupent de statistique, afin d’encourager et de développer les travaux qui se rapportent à cette science et, s’il est possible, de les coordonner par l’adaptation de bases uniformes »[6]. Le congrès connaîtra neuf sessions à partir de 1853. C’est le début des relations entre statisticiens mathématiciens et appliqués. Au niveau de la France, la Société de Statistique de Paris est créée en 1860 par Michel Chevalet, Louis-René Villermé – un ami très proche de Quetelet – accompagnés de quelques autres fondateurs ; elle fusionnera en 1997 avec l’Association pour la Statistique et ses Utilisations et la Société Statistique de France pour créer la Société Française de Statistique (SFdS)[7]. Au niveau mondial, le congrès disparait en 1876, deux ans après le décès de Quetelet ; son intérêt est à l’origine de la création, en 1885, de l’Institut International de Statistique.
Conclusions
Les audaces de Quetelet ont d’abord permis à la Belgique nouvelle de disposer d’un observatoire qui s’est créé une place remarquée dans le réseau mondial des observatoires du milieu du XIXe siècle. Par ailleurs, le recours osé aux outils des astronomes dans le champ des sciences sociales a permis au nouvel État de jouir d’une crédibilité scientifique qui s’est étendue au-delà des seuls domaines de l’astronomie et de la statistique.
Bibliographie
Armatte M. et Droesbeke J.-J., « La probabilité au service de la statistique morale de Quetelet », in Droesbeke J.-J. (éd.), Puissance et impuissance du nombre, Bruxelles, Académie royale de Belgique, Collection Transversales, 2023a.
Armatte M. et Droesbeke J.-J., Quetelet . L’œuvre probabiliste (1828-1873), Paris, Collection des Classiques de l’économie et de la population, Institut National d’Études Démographiques, 2023b.
Droesbeke J.-J., « Les racines de la Société Française de Statistique », Journal de la Société Française de Statistique, tome 146, 2005, p. 5-22.
Droesbeke J.-J., Adolphe Quetelet. Passeur d’idées, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2021. Quetelet A., « Recherches sur la loi de la croissance de l’homme », Nouveaux mémoires de l’Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles, tome 7, 1831, 35 pages + 1 planche + 1 tableau.
Quetelet A., Instructions populaires sur le calcul des probabilités. Bruxelles, Tarlier, 1828.
Quetelet A., « Recherches sur le penchant au crime aux différents âges », Nouveaux mémoires de l’Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles, tome 7, 1831, 87 pages et 3 planches.
Quetelet A., « Recherches sur le poids de l’homme aux différents âges », Nouveaux mémoires de l’Académie des sciences et belles-lettres de Bruxelles, tome 7, 1831, 44 pages et 2 planches.
Quetelet A., Sur l’homme et le développement de ses facultés ou Essai de physique sociale, 2 volumes, Paris, Bachelier, 1834.
Quetelet A., Lettres à S.A.R. le duc régnant de Saxe-Cobourg et Gotha, sur la théorie des probabilités, appliquées aux sciences morales et politiques, Bruxelles, Hayez, 1846.
Notes
[1] Pour plus de détails sur cette période, voir (Droesbeke, 2021).
[2] Voir (Armatte et Droesbeke, 2023).
[3] Voir (Armatte et Droesbeke, 2023a et b).
[4] Voir (Armatte et Droesbeke, 2023b) pour plus de détails.
[5] Ibidem.
[6] Bulletin de la Commission Centrale de Statistique, Procès-verbaux des séances, 1853, p. 23.
[7] Voir (Droesbeke, 2005).

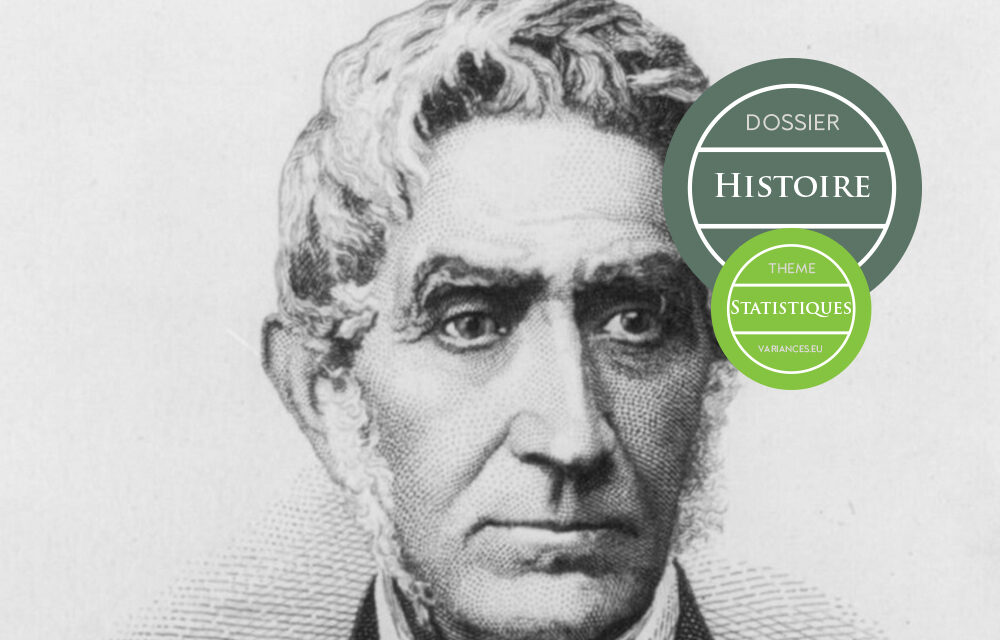


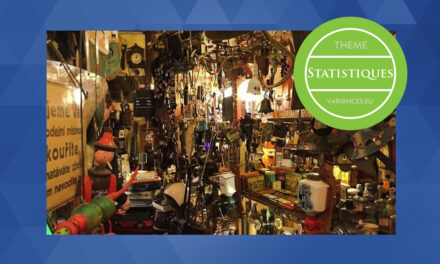

Commentaires récents