En février 1776, le jeune Louis XVI fait adopter un édit royal rédigé par Turgot, destiné à mettre fin aux corporations :
« Article premier.
« Il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité & conditions qu’elles soient, même à tous Étrangers, encore qu’ils n’eussent point obtenu de nous des Lettres de naturalité, d’embrasser & d’exercer dans tout notre royaume, & notamment dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de Commerce, & telle profession d’Arts & Métiers que bon leur semblera ».
L’opposition se mobilise de tous côtés, des parlements, de la noblesse, des paysans et des artisans : Turgot est remercié ; ses réformes sont annulées. Il faudra attendre la Révolution pour les mettre en œuvre.
En 1791 donc, l’Assemblée nationale vote la loi Le Chapelier qui confirme la suppression des corporations :
« Il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s’assembler pour leurs prétendus intérêts communs ; il n’y a plus de corporation dans l’État ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu, et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation ».
Pour les catholiques fervents, la Révolution représente le mal absolu. Rappeler les corporations leur permet de dénigrer le système économique qui s’est imposé, individualiste et libéral. Néanmoins, au début du XIXe siècle, les catholiques ne font pas des anciennes corporations un projet politique. Même à la Restauration, ils ne proposent ni de les rétablir, ni de s’en inspirer pour établir un nouveau système économique. Les choses changent à la fin du Second Empire. Les catholiques de tous bords considèrent alors que le socialisme est devenu l’ennemi prioritaire. Certains se rapprochent donc des libéraux, tandis que les autres, disons les catholiques « intransigeants », mettent en avant la corporation comme une troisième voie entre le socialisme et le libéralisme.
Les deux principaux leaders du mouvement sont les Saint-Cyriens et comtes Albert de Mun (prononcez « main ») et René de la Tour du Pin. Prisonniers à Aix-la-Chapelle après 1870, les deux officiers occupent leurs loisirs à analyser les malheurs de leur temps : la défaite militaire ; la déchristianisation et, bientôt, la Commune de Paris qui révèle l’hostilité des ouvriers parisiens contre l’Église. Fervents catholiques et monarchistes, ils retiennent de leur aîné, Frédéric Le Play, que tout le mal vient de la Révolution. Avec quelques camarades, Albert de Mun fonde en 1871 une sorte de patronage qui devient une sorte de parti destiné à la jeunesse ouvrière masculine, L’Œuvre des cercles catholiques d’ouvriers. En 1886, il fonde, avec d’autres catholiques sociaux, l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF) dont l’actuelle JOC est issue. Il quitte l’armée et mène une carrière d’homme politique comme député d’extrême droite, presque sans interruption de 1876 à sa mort. Il rejoint l’Académie française en 1897. De son côté, René de La Tour du Pin est le principal théoricien de la corporation en France pendant la IIIe République.
La doctrine corporatiste
L’idéal corporatiste consiste à dépasser l’opposition entre le capital et le travail au nom d’une même fraternité communautaire. Au sein d’une entreprise ou au sein d’une branche, ouvriers et maîtres réuniraient leurs délégués pour envisager toutes les questions utiles concernant leur profession : les salaires et les conditions de travail ; la formation et les embauches ; les caisses de retraite, de maladie, de chômage ; les assurances contre les accidents ; les avantages collectifs de toutes espèces. Les accords qui en résulteraient s’imposeraient ensuite à tous, ils deviendraient la loi de la profession.
Dans la future société corporatiste, La Tour du Pin préconise « la participation aux bénéfices […] en considérant toute entreprise comme une sorte d’association du travail et du capital, et faisant en conséquence à chaque associé dans la répartition du produit une part non pas arbitraire, mais proportionnelle à son apport ». Dans cette association, seuls les ouvriers auraient leur part, pas les capitalistes, car « ce n’est pas la charrue qui travaille, c’est le laboureur ». Les moyens de production devraient donc progressivement devenir la propriété collective des seuls ouvriers. L’analyse semble plutôt socialiste que catholique, mais La Tour du Pin nie cette comparaison : les ouvriers sont actuellement les esclaves des capitalistes ; les socialistes veulent en faire les esclaves de l’État ; le corporatisme seul les affranchira. La Tour du Pin envisage l’expropriation des capitalistes d’autant plus sereinement qu’il les identifie à des banquiers juifs ou à des financiers forcément malhonnêtes.
En pratique, les militants corporatistes sont généralement moins radicaux que La Tour du Pin. Les patrons du Nord sont par exemple plus intéressés par l’exemple de Léon Harmel, patron depuis 1854 d’une filature textile, au Val des Bois, près de Reims. Les dirigeants de cette entreprise délibèrent régulièrement avec des délégués ouvriers au sein d’une instance corporative appelée « conseil d’usine ». Les patrons veillent à la conduite religieuse de leurs ouvriers et de leurs familles ; ils en financent généreusement les associations, par exemple sportives et ludiques. Des caisses de solidarité sont constituées, en vue de la santé, de l’éducation et une sorte d’allocation familiale complète certains salaires. Le travail commence chaque jour par une prière collective ; une chapelle est même disponible dans la propriété. Les relations entre garçons et filles sont évidemment très surveillées, les sexes ne sont d’ailleurs pas mélangés dans l’usine.
L’ambiguïté de la référence au corporatisme permet de rassembler des catholiques très différents par ailleurs, des intransigeants et des libéraux, des fervents et des modérés, des riches et des pauvres. Le paternalisme peut même se concevoir comme une variante limite du corporatisme, dans laquelle le patron, et lui seul, devrait dépasser l’opposition du travail et du capital et tenir compte de l’intérêt, matériel et moral, de ses ouvriers. Léon Harmel est plutôt un patron de ce type qu’un militant rêvant d’instaurer un ordre économique et politique radicalement nouveau ; il se méfie de l’État pour organiser les corporations, alors que Mun et La Tour du Pin jugent l’État nécessaire, sinon pour installer un régime corporatif général, du moins pour légiférer en faveur des entreprises corporatistes et prendre en charge la protection des ouvriers.
Le divorce entre les ouvriers et l’Église
La corporation est un thème qui permet de dénoncer les mêmes vices que ceux que les catholiques dénoncent depuis la Révolution, mais en insistant sur la condition ouvrière. L’évêque d’Angers, Charles-Émile Freppel, à l’occasion du centenaire de la Révolution, dénonce les deux hommes dont l’influence aurait particulièrement été importante sur le système économique : « Turgot et les autres économistes contre le régime corporatif » et Rousseau, pour son Contrat social :
« Dès lors, plus une ombre de hiérarchie ; plus de paternité sociale ; plus de charge d’âmes ; plus de fraternité professionnelle ; plus de règles communes ; plus de solidarité d’intérêt, d’honneur et de réputation ; plus de rapprochement entre les maîtres, les ouvriers et les apprentis ; plus de garanties pour les faibles contre les forts ; plus de protection des grands à l’égard des petits. Une concurrence effrénée, une lutte pour la vie où chacun, réduit à ses seules forces, cherche à l’emporter sur les autres, au risque d’entraîner leur ruine ; une mêlée où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se foule aux pieds, c’est-à-dire, en résumé, l’oppression en haut, la servitude en bas, l’antagonisme partout et l’union nulle part ; telle est la situation que la Révolution française est venue créer à la classe ouvrière ».
L’évêque Freppel plaide pour la corporation parce qu’il y voit un remède à l’éloignement des classes ouvrières de la religion. Les statisticiens donnent régulièrement des indices de cet éloignement au XIXe siècle: les ouvriers des villes se marient moins et vivent en union libre ; le nombre de naissances d’enfants illégitimes augmente ; le recours à la contraception est manifeste ; la prostitution s’étend et des filles très jeunes s’y adonnent ; les cabarets attirent davantage les ouvriers que les églises. Non seulement les ouvriers s’éloignent de la religion, mais encore sont-ils de plus en plus séduits par les syndicats révolutionnaires et les partis socialistes. On peut donc présenter les associations corporatistes, aussi, comme des associations catholiques destinées à détourner les ouvriers du mauvais chemin. Le sujet est suffisamment important pour que le pape Léon XIII, en 1891, intervienne et précise l’analyse de l’Église.
L’encyclique Rerum Novarum définit ce que l’on appellera « la doctrine sociale de l’Église » : elle justifie la propriété privée mais elle condamne les excès du capitalisme ; elle condamne aussi le socialisme, c’est-à-dire la lutte des classes et le recours à l’État ; elle encourage explicitement le mouvement en faveur des corporations chrétiennes. En France, l’encyclique apparaît comme un encouragement aux analyses et aux revendications corporatistes. L’économiste libéral Gustave du Puynode s’en désole dans un article sur « Le socialisme en 1896 » :
« La célèbre encyclique Rerum Novarum de Léon XIII sur les ouvriers était destinée à combattre le socialisme, et chacune de ses solutions est une réglementation purement socialiste. Elle veut, en effet, qu’on en revienne aux anciennes corporations ; que chacun ait ‘un juste salaire’, indépendant de l’offre et de la demande ; qu’il n’y ait plus de travaux ‘qui satisfassent d’insatiables cupidités et mêlent les sexes’. Que resterait-il après cela du travail libre et de la propriété individuelle ? ».
Après la première guerre mondiale
Après la première guerre mondiale, les idées de La Tour du Pin sont relayées par Maurras et son Action française, plus précisément par l’économiste du mouvement, Georges Valois. En dehors de ce courant, les catholiques sociaux entretiennent la revendication corporative. Par exemple, depuis 1904, Les Semaines sociales rassemblent les catholiques sociaux dans une sorte de colloque annuel où se mêlent clercs et laïcs, militants et experts. Presque chaque année, une leçon porte sur la corporation ou, au moins, la mentionne comme un courant à encourager. En 1935, la corporation est même le thème des Semaines sociales à Angers. Chacun explique que le capitalisme a fait son temps et que l’idée de la corporation gagne du terrain, dans la réalité comme dans les aspirations. Le capitalisme et le libéralisme sont considérés comme moribonds, alors que trois pays font de la corporation catholique un élément essentiel de leur organisation en 1933 et 1934 : le Portugal, l’Autriche et l’Italie.
En France, deux trajectoires individuelles correspondent bien à l’aventure corporatiste entre 1934 et 1944, passée de l’espoir à la déception et de la déception à l’abandon. François Perroux est, avant la guerre, le professeur d’économie le plus radical en faveur de l’idée corporatiste ; il appelle à une révolution nationale, sociale, morale et spirituelle, plus précisément catholique. Maurice Bouvier-Ajam est un autre économiste, mais bien moins illustre. En 1934, il a 20 ans, entame un doctorat en économie, épouse une fervente catholique et devient lui-même un fervent catholique. Il dirige bientôt une association d’études et de promotion des doctrines corporatistes, l’Institut d’Études Corporatives et Sociales (IECS).
Pendant l’occupation allemande, le maréchal Pétain explique dès septembre 1940 que le corporatisme sera le principe général de son action. La charte du travail d’octobre 1941 passe pour le texte corporatiste du régime, mais elle sera très peu appliquée. Vichy planifie son économie comme une économie de guerre, avec un État plus puissant et plus technocratique que jadis. Perroux et Bouvier-Ajam sont donc déçus, à la fois par la Charte et par son application. Par ailleurs, Bouvier-Ajam est mis en cause pour son train de vie dispendieux au sein de son Institut et pour son intérêt trop vif pour ses jeunes collaboratrices. A la Libération, il passe quelques mois en prison avant d’être jugé pour « intelligence avec l’ennemi ». On lui interdit seulement de passer le concours de l’agrégation : il ne sera donc jamais professeur. Bouvier-Ajam se remarie en 1944. Sa nouvelle femme milite au parti communiste, il devient alors un militant communiste. François Perroux continue sa carrière qui le mènera au Collège de France, il n’évoquera plus ses idées corporatistes, mais il restera très hostile au système capitaliste et libéral.
Dans la période qui suit la guerre, on ne trouve plus de catholiques éminents pour promouvoir la corporation, mais la France évolue vers une forme de corporatisme qui ne dit pas son nom. La gauche politique et syndicale s’en réjouit, mais surtout pas au nom d’une doctrine explicitement corporatiste et encore moins pour appliquer « la doctrine sociale de l’Église ». Par ailleurs, l’idée corporatiste n’est peut-être pas loin de l’autogestion des années 1960, chère à la gauche non communiste. Ce mouvement compte des militants catholiques très actifs, anciens des jeunesses ouvrières et étudiantes, mais qui agissent à titre individuel ; en particulier, la CFDT adopte l’autogestion comme mot d’ordre en mai 1968, peu après sa déconfessionnalisation.
Selon l’économiste catholique Daniel Villey, dans un article de 1954, la recherche d’une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme serait une obsession des élites catholiques, infondée et vouée à l’échec :
« La pensée économique de beaucoup de catholiques […] incline encore aujourd’hui volontiers vers les ‘doctrines intermédiaires’ — corporatisme, coopératisme, associationnisme, solidarisme, travaillisme — c’est parce qu’elle y croit retrouver des échos idéologiques d’une ère précapitaliste dont — consciemment ou inconsciemment — elle conserve la nostalgie ».
Malgré les préventions de Daniel Villey, « entre le plan et le marché », la corporation a suscité des analyses et des espoirs qui relevaient en grande partie de la foi catholique de ses partisans.
Mots-clés : corporation – catholique – capitalisme – paternalisme – socialisme
* d’après un livre à paraître chez Classiques Garnier en 2021, Les catholiques et la science économique.
- Les inégalités sociales sont-elles vraiment injustes ? - 14 novembre 2024
- Utilitarisme vs droit naturel - 10 août 2023
- De l’origine catholique de la participation aux bénéfices - 3 janvier 2023

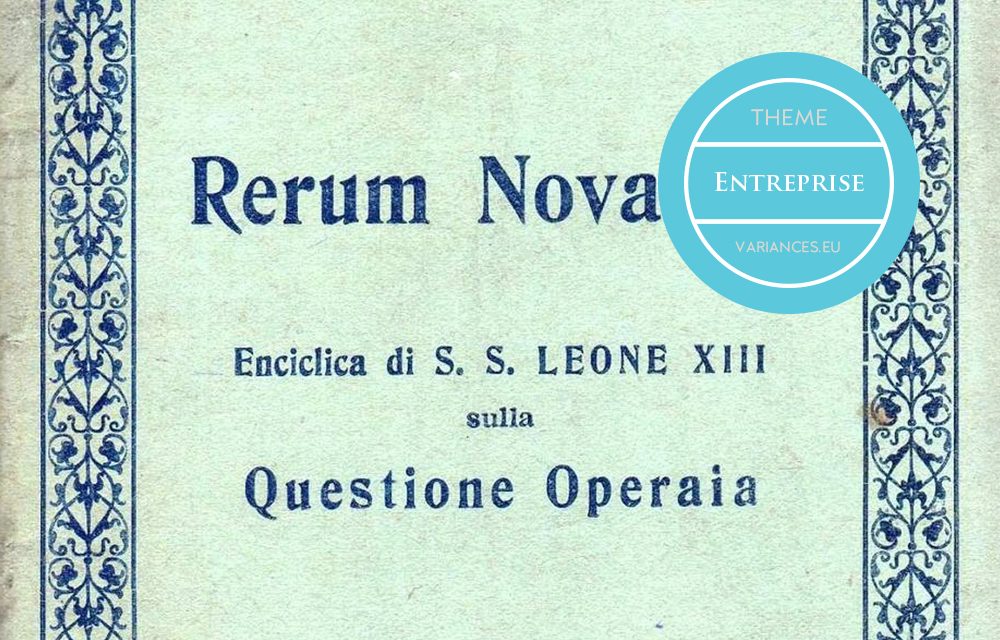
Commentaires récents