Jeremy Bentham (1748-1832) est un juriste britannique qui dénonce l’irrationalité de la justice et de l’action publique et invente une philosophie politique appelée utilitarisme. Il analyse l’homme et la société à la façon d’un scientifique et sans références religieuses, ce qui explique l’intérêt qu’il suscite chez des intellectuels britanniques au XIXe siècle. Un seul principe lui suffit pour définir une décision bonne, « le principe de l’utilité » : est bien ce qui cause du plaisir à des individus, est mal ce qui leur cause de la peine. L’utilité apparaît comme le solde comptable des plaisirs et des peines, à la fois pour un individu et pour la société. Le but d’un individu rationnel est d’augmenter son utilité, celui de la société est d’assurer « le plus grand bonheur pour le plus grand nombre ». La formule est vague, mais elle implique surtout qu’une action n’est pas bonne ou mauvaise en elle-même, elle n’est bonne que si ses conséquences ajoutent de l’utilité à beaucoup d’individus ; elle est alors morale, par définition de la morale selon l’utilitarisme.
Jean-Baptiste Say
Jean-Baptiste Say enseigne l’économie politique à Paris dans les années 1820 et il cite Bentham comme « mon ami, ou plutôt mon maître ». Say est libéral, individualiste et très anticlérical, ce dernier point justifiant sans doute son utilitarisme, mais ses disciples économistes ne revendiqueront pas cette philosophie politique particulière. Pour faire comprendre « le principe de l’utilité », Say en cite ces contre-exemples : le tyran qui n’a pas à justifier son action, l’ascète qui croît plaire à Dieu en dépérissant, l’Église qui étale sa richesse en Italie. L’utilité correspond à ce qui nous satisfait, mais sans supposer une recherche frénétique de plaisirs sensuels : plaisanter avec ses amis, écouter un beau concert augmentent peut-être plus notre utilité que vider une bouteille de vin. Pour évaluer une décision publique, il faut envisager l’utilité qu’elle ajoute aux uns et celle qu’elle retire à d’autres, mais comment conclure ? L’utilitarisme de Bentham en est incapable, et personne ne s’en plaint. Say réclame seulement que la délibération politique se développe sur une base rationnelle, que l’on cherche à savoir qui gagne et qui perd, et combien, sans invoquer des figures imaginaires comme celles du Créateur ou de la Nation.
Selon Say, le principe de l’utilité justifie par exemple la propriété individuelle de la terre. La seule question pertinente serait celle-ci : la terre est-elle plus efficacement exploitée par des propriétaires ou, par exemple, par des ouvriers travaillant pour le compte de la commune ? Selon Say, le droit de propriété individuelle stimule davantage le travail ; cela seul permet de qualifier ce droit « d’utile », donc d’y souscrire sans invoquer un principe absolu au-dessus des lois du moment. La même démarche utilitariste permet d’envisager tel droit relatif à l’héritage ou tel autre sur les brevets d’invention. (Dans les deux cas, la réponse utilitariste n’est pas simple, mais peu importe.) Autre exemple, plus simple : Say justifie que les savants ne jouissent pas de rémunérations spécifiques pour récompenser leurs théorèmes ou leurs démonstrations ; car ils sont tellement intéressés à connaître la vérité qu’il n’est pas nécessaire de les gratifier pour cela. Il est plus utile, pour la société, que chacun puisse utiliser librement leurs découvertes.
Bentham s’est demandé si son « principe d’utilité » ne devrait pas s’étendre aux animaux doués de sentiments. Say reprend ce raisonnement à son compte. Manger des animaux leur cause du tort, mais ajoute de l’utilité aux humains ; de quel côté penche la balance ? Say observe que la vie d’un animal lui apporte plus de satisfaction que s’il n’avait pas vécu ; seules la mort et la perspective de mourir diminuent son utilité. Il suffit donc ne pas l’en avertir et Say, reprenant Bentham, préconise de le tuer sans douleur et par surprise.
L’utilitarisme de Say lui permet de raisonner de la même façon, s’agissant cette fois des humains et pas des bêtes. Les enfants pauvres que l’on abandonne dans des hôpitaux sont élevés jusqu’à leur sortie, vers l’âge de vingt ans ; leur entretien coûte cher et il est souvent incapable d’empêcher leurs maladies ou leur mort prématurée. La suite ne vaudrait guère mieux :
« Et si l’on considère de plus qu’au sortir des hôpitaux ils ont peu de chances de fortune à cause de leur état de dénuement, et qu’ils ont éprouvé peu de bonheur dans les vingt premières années de leur vie, on sera forcé de convenir, que si nos mœurs le permettaient comme en Chine, ce serait faire à la fois un acte d’économie et d’humanité que de les endormir d’un sommeil éternel, si l’on pouvait le faire sans les faire souffrir et avant qu’ils eussent acquis la conscience de leur existence et de la répugnance qu’excite en nous l’idée même de notre fin ».
Say précise que « cette dernière idée ne peut pas encore être énoncée dans l’état de nos préjugés » ; elle ne fut effectivement pas publiée de son vivant.
La défense du droit de propriété
La défense du droit de propriété, surtout celle de la terre, embarrasse les économistes libéraux français depuis les années 1830. Ce droit est difficile à défendre parce que certains bons économistes prétendent que la plupart des propriétaires perçoivent « une rente » en vendant leur production au-dessus du coût de production, une rente qui ne récompense aucun travail spécifique. Pis encore, les socialistes dénoncent désormais la propriété individuelle en général, industrielle ou foncière. Rousseau les avait précédés dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes :
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerre, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux, et comblant le fossé, eût crié à ses semblables : « Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ».
Dans la même veine, Qu’est-ce que la propriété ? demande le livre de Proudhon en 1840, et il répond dès la première page : « La propriété, c’est le vol ».
Les économistes français sont donc à la recherche d’arguments irréfutables en faveur du droit de propriété, en particulier de la terre. L’idée majoritaire est contraire à l’utilitarisme, elle consiste à faire du droit de propriété « un droit naturel », c’est-à-dire universel et supérieur au droit positif. Le produit de mon travail m’appartient, la valeur de ce produit résulte de mon travail, donc la propriété acquise légalement par mon travail m’appartient légitimement. Tel serait le fondement du droit du premier occupant d’une terre, de celui qui l’avait défrichée et ensemencée. Le même droit naturel interdit que l’on imprime et vende contre mon gré le roman que je viens d’écrire ou interdit d’utiliser sans mon consentement le procédé industriel que je viens d’inventer. Et, puisque j’en suis le propriétaire légitime, je peux léguer ma terre, mon roman ou mon invention à celui que je désigne pour qu’il en jouisse après moi.
A quoi les utilitaristes répondent : certes, admettons que cette terre m’appartienne parce que j’en ai hérité, mais quelle était réellement le mérite du premier occupant ? Il n’était sûrement pas un défricheur, mais plutôt un brigand plus fort que les autres, ce qui invalide l’idée de droit naturel. Mais peu importe, puisque la propriété individuelle des terres s’avère, désormais, la plus utile ; cela suffit à légitimer son appropriation individuelle. Adolphe Thiers, juste après la Révolution de 1848, propose une autre analyse, avec la même conclusion contre les socialistes. La prescription serait un des principes sacrés des sociétés civilisées ; le premier occupant d’un terrain était donc éventuellement un brigand, mais il faudrait l’oublier, étant donné le temps écoulé depuis. Dans le camp du droit naturel, on objecte aux utilitaristes que les socialistes pourraient adopter leur principe et faire croire que la propriété collective des terres serait finalement la plus avantageuse pour la collectivité.
Jules Dupuit
L’ingénieur-économiste Jules Dupuit se moque en 1861 de ces propagandistes du droit naturel :
« Ils ont dit que la propriété était juste, parce qu’on leur disait qu’elle ne l’était pas ; ils ont dit qu’elle était de droit naturel et antérieure à la loi, parce qu’ils ont eu peur qu’elle ne tombât avec elle ; enfin, se défiant de la puissance humaine, appelant Dieu au secours de leur idole, ils ont dit qu’elle était sacrée ! et leur doctrine a eu un immense succès… parmi les propriétaires ».
Jules Dupuit est utilitariste comme économiste, mais c’est surtout comme ingénieur qu’il cherche à déterminer mathématiquement la conformité de tel projet à l’intérêt général. Selon lui, l’État doit construire, par exemple un pont, si ceux qui en profiteraient étaient disposés à le financer entièrement moyennant un péage individualisé. Mais, une fois le pont construit, l’État pourrait renoncer à percevoir ce péage pour des raisons de commodité : frais de perception élevés, difficultés de prendre à chacun le maximum de ce qu’il serait disposé à payer. Le pont serait alors financé par l’impôt et rendu gratuit pour les usagers. Il profiterait aux utilisateurs, qui y gagneraient évidemment, et pas aux contribuables ; mais le total des gains virtuels des uns et des pertes des autres serait positif par hypothèse, et ce total semble correspondre à la formule utilitariste du « plus grand bonheur pour le plus grand nombre ». Un raisonnement semblable incite Dupuit à défendre, presque seul parmi les économistes libéraux, l’impôt sur le tabac. Cet impôt serait jugé injuste parce qu’il prend aux uns et pas aux autres, et davantage aux pauvres qu’aux riches. Dupuit raisonne autrement : ceux qui choisissent de fumer payent l’impôt, mais ils en tirent une satisfaction puisqu’ils acceptent de payer. Chacun est donc gagnant, et les principes fiscaux de l’universalité et de la proportionnalité sont ici sans intérêt.
Dupuit est individualiste, puisque l’État ne devrait agir qu’en fonction des situations individuelles, mais il n’est pas tout à fait libéral, contrairement à Jean-Baptiste Say, dans le sens où l’État pourrait intervenir à bon escient en dehors des mécanismes de marché, pourvu que ses dépenses soient conformes au calcul utilitariste. La construction et la gestion des chemins de fer en France est une bonne illustration de cette doctrine. Les ingénieurs du corps des Ponts et Chaussées raisonnent comme Dupuit, ils cherchent à évaluer en argent des avantages individuels directs et ils les comparent aux frais correspondants. En face, les économistes libéraux ne font majoritairement pas confiance à des « agents de l’État » pour limiter leurs dépenses. Du côté non libéral, des saint-simoniens expliquent par exemple qu’une liaison entre Paris et Marseille ouvrirait une porte vers l’Orient, d’où la rencontre de populations jadis isolées, d’où une possible paix universelle : tout calcul serait ici inconvenant. En 1875, l’économiste Léon Walras dénonce de même l’utilitarisme parce que l’utilité des chemins de fer dépasserait les intérêts individuels : « ces voies sont des agents essentiels de la civilisation et du progrès en tous sens ». Pour ne pas le comprendre, « il faut, en vérité, avoir sur les yeux le double bandeau de l’individualisme le plus étroit et de l’utilitarisme le plus borné ».
L’utilitarisme tardif
En Grande-Bretagne, l’utilitarisme séduit des économistes de premier plan. John Stuart Mill, l’économiste majeur au temps de Dupuit, incarne et renouvelle la philosophie utilitariste. Puis, Stanley Jevons et Francis Ysidro Edgeworth, deux grandes figures de la période « néoclassique », prolongent la tradition utilitariste jusqu’à la fin du XIXe siècle. Ces deux auteurs, et d’autres aussi, font le lien entre la fonction mathématique d’utilité individuelle et l’addition utilitariste des satisfactions individuelles ; c’est pour effectuer une telle addition qu’ils supposent l’utilité cardinale et non ordinale. Certains utilitaristes en déduisent la nécessité d’égaliser les conditions. Supposons en effet deux individus, l’un riche et l’autre pauvre. Retirons 100 livres au premier et donnons-les au deuxième. Il en résulte un gain d’utilité ici et une perte là ; le gain est plus grand que la perte en vertu de la décroissance de l’utilité marginale, car 100 livres ôtées à une grande fortune ne diminuent guère son utilité. Le total des utilités, le bien-être au sens de l’utilitarisme, est donc maximum quand les richesses sont égales. Edgeworth propose un raisonnement opposé en 1877, lui aussi au nom de l’utilitarisme. Les « capacités au bonheur » ne sont pas identiques chez les uns et chez les autres. Pour maximiser la somme des utilités individuelles, il faut donc donner beaucoup de ressources aux uns, car ils savent en tirer un grand plaisir, plutôt qu’aux autres. Qui sont ces individus plus disposés au bonheur que d’autres ? Peut-être les membres des classes supérieures, mais Edgeworth ne le dit pas franchement. De même, il serait peut-être judicieux de donner beaucoup plus aux hommes qu’aux femmes ; Edgeworth cite à cette occasion le poète Tennyson, mais sans l’approuver explicitement :
Woman is the lesser man, and her passions unto mine
Are as moonlight unto sunlight and as water unto wine.
Edgeworth, à la suite des Britanniques Spencer et Galton, étend l’utilitarisme à l’espèce humaine en se demandant par exemple quel est le nombre optimal d’humains sur terre, le nombre qui maximise le total des utilités des générations présentes et futures. Il tient compte en particulier, dans cette question, de l’aptitude à bien élever ses enfants. Tous ces calculs économiques britanniques à base d’utilitarisme n’aboutissent à aucun résultat opératoire, contrairement aux calculs des ingénieurs français. Mais l’idée d’utilité à la Dupuit est finalement comprise par l’Anglais Alfred Marshall, le principal économiste de la fin du XIXe siècle. Il l’appelle le « surplus du consommateur » et en révèle l’importance à tous les économistes de son époque.
L’utilitarisme à la française s’épanouit après la dernière guerre mondiale grâce à Maurice Allais, du corps des Mines, et aux ingénieurs-économistes qui suivent son enseignement ; mais ce mouvement s’effectue sans référence à la philosophie de Bentham ni même à ses variantes ultérieures. Allais formalise l’idée de Dupuit dans le cadre d’un équilibre général avec des fonctions d’utilité individuelles. Il démontre que, si une action dégageait un surplus positif, elle permettrait, moyennant d’éventuels transferts de revenus, d’améliorer la situation de chaque individu ; il faudrait donc entreprendre une telle action au nom de l’intérêt général. Par exemple, on calcule en 1951 que fermer certaines mines de charbon en France et en importer depuis la Pologne serait bénéfique du point de vue de l’intérêt général.
Cet article a été initialement publié le 27 mars.
Mots-clés : utilitarisme – droit naturel – Dupuit – Say – Edgeworth – Allais.
Références
Jules Dupuit, « Du principe de propriété. Le juste — L’utile », Journal des économistes, 1861.
François Etner et Claire Silvant, Histoire de la pensée économique en France depuis 1789, Economica, 2017.
- Les inégalités sociales sont-elles vraiment injustes ? - 14 novembre 2024
- Utilitarisme vs droit naturel - 10 août 2023
- De l’origine catholique de la participation aux bénéfices - 3 janvier 2023

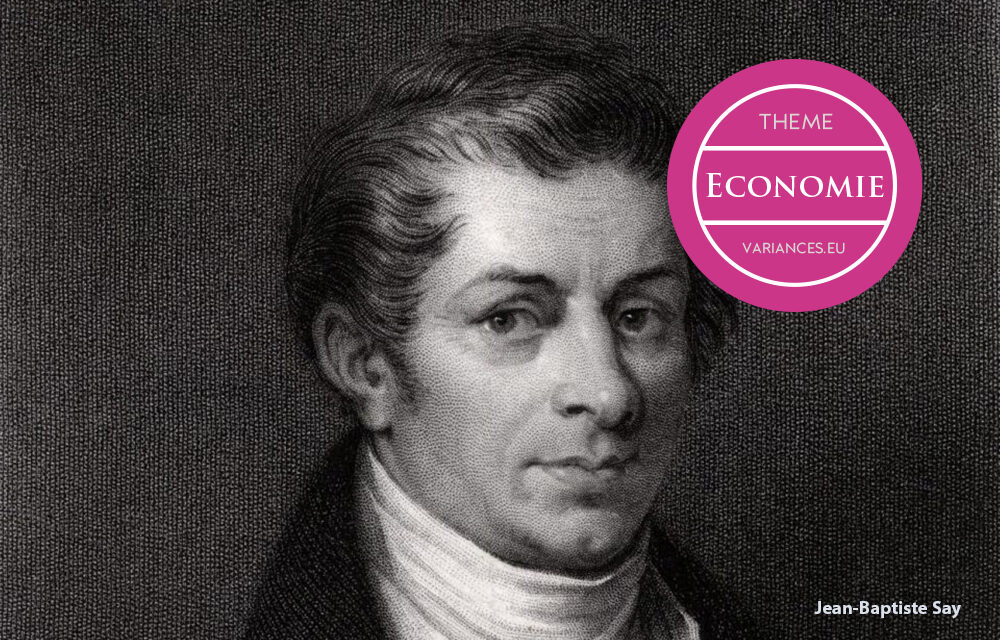
Commentaires récents