Marceline Bodier est une femme aux multiples facettes. Du piano aux statistiques, du diplôme de l’Ensae à celui de psychologue clinicienne, de Sciences Po au violon, elle est aujourd’hui administratrice de l’Insee, et a autoédité en 2017 chez Librinova « La fille au Mitote », roman dont la lecture m’a « embarquée ».
Pour Variances, elle nous livre une réflexion personnelle sur l’écriture à partir des deux pratiques qu’elle en fait : l’analytique statistique et la romanesque.
Parmi les réactions à la lecture de mon roman, il en est deux qui m’ont particulièrement frappée. Une lectrice m’a dit « c’est sympa, mais quand même, le dénouement est trop noir, c’est exagéré, personne ne peut croire que la vie peut être aussi noire ». Un lecteur a affirmé sur le même ton de l’évidence « c’est sympa mais quand même, le dénouement est tellement rose limite guimauve, tu n’as pas peur qu’on te dise que tu as fait des concessions à la mode du développement personnel ? ». Un seul livre. Deux lectures aussi opposées que possible d’un texte rigoureusement identique.
Or, je n’étais pas habituée à cela : à l’Insee, je participe à l’écriture d’un marronnier annuel sur le marché du travail et je serais horrifiée si on me disait à la fois « c’est intéressant, mais dis donc, je ne savais pas que ça se dégradait à ce point » et « c’est intéressant, et je suis bien content que le pire soit derrière nous ».
Alors pourquoi est-ce que je considère la diversité de lectures de mon roman, et l’unicité de celles de mes textes signés de l’Insee, comme autant de bons signes ? Une personne – moi -, un rapport à l’écrit – le mien -, mais qui s’exprime dans deux univers aussi différents que possible… de quoi me dédoubler radicalement ? Je ne crois pas. De quoi s’approcher, au contraire, du cœur du sujet : l’écriture.
Pour me faire comprendre, je peux essayer de schématiser les deux pôles entre lesquels mon esprit navigue : le monde des statistiques et celui du roman.
Dans le monde des statistiques, on a une obsession : délivrer un message univoque, dont toute ambiguïté est chassée et que tous les lecteurs comprennent de la même manière. Pour cela, on pose toutes les définitions de manière à éviter la polysémie naturelle de la langue et à être sûr qu’auteur et lecteur partagent la même acception de chaque mot. Quand on dit « chômeur au sens du BIT », on entend quelque chose de précis qui n’est pas la vague représentation d’une personne dépourvue de travail à laquelle chacun peut associer le cliché qui lui convient.
Dans le monde des statistiques, on choisit ses mots de façon à ce qu’il y ait un seul sens possible pour tous les lecteurs.
Dans le monde du roman, on peut schématiser la démarche de façon exactement inverse : la polysémie est une qualité. La variété des clichés que fait surgir le terme « chômeur » est la bienvenue : un.e auteur.trice se garde bien de choisir. Bien sûr, quand on écrit, on a aussi une représentation en tête et elle nous fait décrire un certain type de personnage chômeur, mais cela n’empêchera pas celui ou celle qui lit d’y ajouter la connotation qui est la sienne.
Dans le monde du roman, l’ambiguïté, l’ambivalence, sont riches, parce qu’elles favorisent l’appropriation du texte par celui ou celle qui lit : on lui propose un monde, mais il.elle s’en sert pour en créer un autre, le sien, et c’est d’autant plus possible que l’auteur ou l’autrice n’a pas cherché à résumer le texte de départ à un ensemble de messages univoques. Si un terme est ambivalent, si l’interprétation est incertaine, c’est celui ou celle qui lit qui est incité.e à donner son sens au texte qui est lu. Il ou elle le fait avec son imaginaire, le mêle au texte, qui devient un support de projection plus qu’un cadre imposé.
Obsession de l’univocité de l’interprétation d’un côté, épanouissement de l’ambiguïté de l’autre… Je le redis : c’est bien sûr une représentation très schématique, à l’image des extrêmes entre lesquels alterne mon esprit plusieurs fois par jour. Mais on comprend que ce faisant, on arrive du côté de l’Insee à des textes très normés, reconnaissables quelle que soit la personne qui a tenu la première plume. La personne qui découvre un texte de l’Insee ne doit jamais oublier que c’est l’institut qui signe. Les textes publiés par l’Insee ont été relus par au moins sept personnes différentes, qui sont chacune susceptibles d’y apporter des changements et qui, brique après brique, convergent vers un résultat où ce n’est plus l’auteur ou l’autrice de départ, mais l’institution, qui est reconnaissable.
Le but explicite est d’être objectif, de faire en sorte qu’il y ait une interprétation « vraie » et des interprétations « fausses ». A l’Insee, quand on discute les « bons » termes à employer dans un texte, le critère auquel on se réfère est celui de la ligne de partage entre vrai et faux : certes, cette frontière n’existe pas, mais on peut s’y référer comme à une fiction commode pour décider qu’une formulation est « meilleure » qu’une autre.
En revanche, dans un roman, le vrai et le faux n’ont pas de sens, et s’en servir comme critères pour discuter une formulation est une fiction dénuée d’intérêt : il n’y a pas d’interprétation vraie ou fausse d’un roman, mais seulement des lectures intégrées à des imaginaires et des mondes internes différents. Et même, plus il y a d’interprétations différentes, et plus l’écrivain.e a de raisons d’être content.e ! En voyant arriver des interprétations trop convergentes, il.elle est en droit de se reprocher d’avoir utilisé trop de stéréotypes.
J’en reviens alors à mon propos de départ : les critères pour reconnaître un texte raté sont exactement opposés. A l’Insee, un texte est raté quand on se rend compte que fleurissent sur les réseaux sociaux des interprétations contradictoires. A l’inverse, un roman est raté quand on se rend compte que tous les lecteurs y voient la même chose.
Ces oppositions ne sont-elles pas paradoxales ? Je viens d’écrire que dans mon expérience, un roman est très particulier, alors que les textes de l’Insee suivent des règles, donc des principes universellement partageables. Pourtant, en principe, n’attend-on pas d’un roman qu’il soit universel, et d’un texte de l’Insee, qu’il soit très particulier, adapté à l’Insee et à la littérature dite grise, mais à rien d’autre ?
Le paradoxe est résolu si on distingue l’outil du résultat. L’outil de l’Insee, ce sont des règles ; le résultat, c’est un texte qui ne doit pas dépasser les bornes fixées par ces règles. L’outil du roman, c’est une expérience particulière ; le résultat, c’est un texte dans lequel les autres pourront se projeter, et qui résultera en autant de lectures que de lecteurs.trices. Voilà pourquoi les romans à ingrédients mettent si mal à l’aise : ils suivent des règles (« show, don’t tell » ; mettez un peu de violence, un peu de sexe, un peu d’enjeux de pouvoir et un peu d’argent…), et le résultat, ce sont des textes qui ne dépasseront pas les bornes fixées par ces règles, qui peuvent être larges, voire satisfaisantes, mais limiteront les possibilités de projection à la lecture.
Et voilà comment, grâce à mon expérience d’écriture dans un cadre strict, je me suis spontanément libérée de toute tentation d’écrire un roman à ingrédients.
Mots-clés : #lafilleaumitote – #marcelinebodier – #books – #librinova – #écriture
- « C’est à ce danger qu’écrire confronte » – Conversation avec Marceline Bodier - 4 mai 2023
- (Auto)-éditer son premier roman, pourquoi pas vous ? - 28 mai 2021
- Statisticienne ou romancière, pourquoi choisir ? - 26 juillet 2019

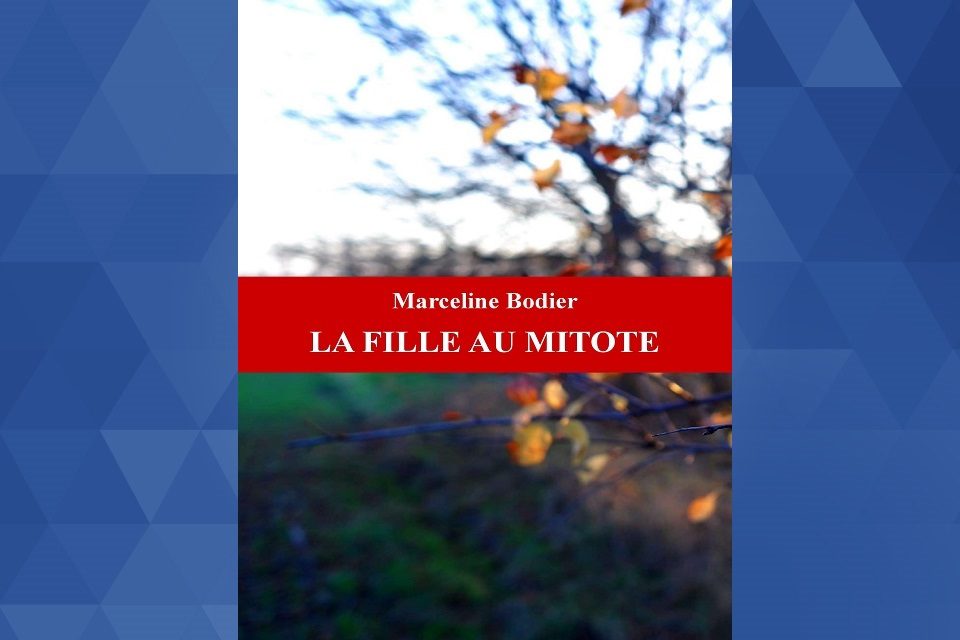
Commentaires récents