Les bons scolastiques du Moyen-Âge étaient hommes d’Église en même temps que fins juristes. Et gens pragmatiques. Ils voyaient, nous sommes au 12e siècle, l’extraordinaire progression économique, démographique, institutionnelle et agricole de leurs sociétés, et la multiplication des échanges que cela provoquait. Il fallait comprendre, légiférer, juger, orienter. Nombre d’écrits sur le sujet des échanges économiques avaient un but pratique., par exemple publiés sous la forme de guides pour aider les prêtres lors de la confession des fidèles, quand ceux-ci étaient de riches marchands. S’agissant des échanges et des prix, ils en restaient à cette règle venue du droit romain : « La valeur d’une chose est le prix auquel elle peut être vendue, sed communiter ».
En simplifiant à peine, l’immense débat sur le « juste prix » tourne autour du sens à donner à cette simple phrase. La référence unique de prix est celle qui apparaît lors des échanges sur un marché. Le juste prix est donc donné par le prix de marché, sed (mais !) communiter. Pour marquer les choses de façon polaire, les uns diront à propos de ce « communiter » : 1- à condition que l’échange suive des procédures acceptées par la communauté »[1]; les autres diront : 2- à condition que l’échange respecte des règles d’équité dans la communauté », ceci obligeant l’autorité publique à suppléer au marché si l’objectif d’équité n’est pas rempli. Il y a bien sûr toutes les nuances intermédiaires entre ces deux lectures. Et le débat ira s’étendre sur environ cinq siècles et concerner une multitude de marchés : le blé, les matières périssables, les biens durables et d’investissement, etc., chacun d’entre eux obéissant à une logique propre.
[Pour prévenir le lecteur de cette revue, je m’inscrirais plutôt dans la lecture n°1 signalée ci-dessus, une lecture privilégiée par entre autres des auteurs comme Raymond de Roover ou Giacomo Todeschini. Voir pour référence ici sur le site de l’AFSE ou là dans Vox-Fi. À noter aussi le marquage « moral » du terme français de juste prix, justum pretium, venu du latin. L’anglais « fair price » est plus neutre axiologiquement, si l’on se rappelle l’étymologie du mot fair, venu également, via l’ancien français, du latin (feriae), qui a donné le mot « foire » en français. L’ancrage marchand est immédiatement affirmé.]
On ne doit donc s’étonner – c’est l’un des apports du remarquable livre sous revue – qu’il n’y ait pas d’interprétation univoque de cette notion de juste prix. Elle est marquée historiquement de multiples façons, selon les auteurs, selon les problématiques concrètes soulevées et selon les périodes. Les réflexions de l’époque de Thomas d’Aquin (début du 13e siècle) diffèrent de celles qu’on peut lire après la gigantesque crise ayant marqué le milieu du 14e siècle ou plus encore de ce qu’en disait la seconde scolastique au 16e siècle. Avec ce point commun qu’il s’agit rarement de réflexions purement théoriques mais de réponses aux questions concrètes que posait cette entrée croissante dans une économie d’échanges.
Les contributeurs sont tous des historiens confirmés, traitant de leur sujet avec une méthodologie pointilleuse que les économistes seraient souvent bien venus de copier. Véronique Chankowski, spécialiste de l’économie sous l’Antiquité, fait ainsi une recension très complète des débats et interprétations de ce qu’était le prix de marché dans la Grèce antique. Son regard est utile quand on sait l’importance qu’a eue Aristote dans les réflexions sur le sujet au Moyen-Âge. Certaines lectures donnent au marché de l’époque grecque la capacité naturelle d’établir ce prix juste ; d’autres soulignent la méfiance qui prévalait à son endroit – c’est le cas chez Aristote –de sorte qu’il était nécessaire de le contrôler dans le sens du bien commun.
Michela Barbot montre efficacement que beaucoup de biens, aux 17e et 18e siècles, échappaient à la logique du marché, entendu comme procédure permettant l’établissement d’un prix par l’interaction de nombreux participants. Les exemples qu’elle donne concernent souvent des biens uniques tel un actif immobilier pour lequel l’établissement du prix suit une procédure d’expertise, avec des règles de droit établies. Le lecteur se fait le commentaire qu’ils ne sont pas en soi spécifiques de la période étudiée, ni ne sont en soi une critique devant être portée à toute économie de marché. Il s’agit ici de marchés très particuliers, qu’on observe aujourd’hui encore par exemple pour les achats et ventes d’entreprises ou pour les calculs de dédommagement des compagnies d’assurance en matière de risques industriels. Le prix ici ne surgit pas du jeu même du marché, indépendamment des acteurs. Il est piloté et suppose des investigations poussées par des évaluateurs collectant les informations et s’en servant comme armes dans une négociation contradictoire. Le marché finit d’ailleurs par devenir muet au-delà d’une certaine précision, ce que les économistes appellent un monopole bilatéral, où le vendeur dit 120 quand l’acheteur dit 100, le prix d’« équilibre » ne résultant que d’un bras de fer au sein de cette fourchette.
Guillaume Garner nous fait connaître un moment fascinant de l’histoire intellectuelle allemande, celui des « sciences camérales ». Il s’agissait tout bonnement de la mise en place par le roi de Prusse de ce qu’on appellerait aujourd’hui des écoles supérieures de gestion, aux fins d’une meilleure administration du royaume, ceci au 18e siècle dans une Allemagne qui gardait encore le souvenir douloureux des dévastations dues à la guerre de Trente Ans. Par gestion, il fallait entendre gestion économique de la production, gestion administrative du territoire (ce qu’on appelait élégamment « police ») et finances publiques. On était en plein mercantilisme où toute la réflexion administrative consistait à assurer la puissance du souverain non nécessairement par des moyens militaires mais par optimisation des rentrées fiscales de l’État et des recettes d’exportation du pays. Les réflexions restaient assez brouillonnes (à mes yeux) mais il y avait en quelque sorte le souci du juste milieu en matière de prix : un prix trop élevé sur le marché domestique par rapport à l’expédition sur les marchés lointains lésait l’habitant de la région ; un prix trop bas dissuadait le producteur d’investir, avec cette idée force que le prix est en quelque sorte à la commande de l’administrateur (plutôt que du « régulateur » comme on dit aujourd’hui) public et non pas des forces anonymes du marché. Il y a une idée originale de « bouclage économique d’ensemble » qui pourrait évoquer les physiocrates français : un prix des aliments trop élevé se répercute dans les salaires et donc les coûts des producteurs ; même chose pour les biens intermédiaires, tout cela avec la vision de la prospérité du royaume plus que de la justice distributive. Là où les physiocrates s’écartent complètement de ces Allemands, comme le souligne Garner à raison, c’est dans leur vision d’un vaste marché, qui doit nécessairement bénéficier de la suppression de toute barrière faisant obstacle à l’échange et à la concurrence. Les prix « caméraux » sont au contraire ancrés dans des échanges locaux, pilotés quand cela est possible par ces administrateurs bienveillants que sont les caméralistes.
Les marchés comme mécanismes
Les chapitres écrits par Clément Lenoble, par Jean-Yves Grenier, et avec une approche différente qu’on verra plus loin, par Alain Guery et par Jérôme Maucourant, forment le cœur du livre. Je ne cherche pas à les résumer ici. On y voit très bien, au Moyen-Âge comme maintenant, que la notion de marché « libre » n’a tout simplement pas de sens. Un marché ne peut exister qu’en raison d’un environnement institutionnel et juridique très étroit. Un commentaire ici.
Les scolastiques étaient bien sûr avertis des limites que rencontrait fréquemment le marché. Le juste prix, c’est le prix de marché, mais d’un marché qui fonctionne bien, à tout le moins dans son partage de l’information et dans la mise en relation de participants libres et non contraints[2]. La notion plus abstraite de concurrence, mise au premier plan aujourd’hui par les économistes, apparait plus tardivement, mais se lit en clair dans les textes de la grande école de Salamanque. Pour que le marché exprime bien le prix (pour les biens qui le permettent, ajouterait-on aujourd’hui), il fallait une multiplicité d’acheteurs et de vendeurs, permettant une bonne circulation de l’information, non soumis à l’obstruction de monopoles.
Il me semble que la seule perspective par laquelle on peut comprendre le rôle du marché est de le voir comme un mécanisme, ou même un algorithme, d’appariement : comment s’arranger, par quelles règles opérer, pour que des biens et des services puissent passer d’une main à l’autre ? On voit alors la complexité de la chose, la masse de détails et de points logistiques qu’il faut établir, le plus souvent par essais et erreurs, pour que l’allocation se réalise plus ou moins à la satisfaction des parties. Je tente ici plusieurs exemples.
Le premier est celui des marchés ambulants du dimanche matin, où une grande part des produits échangés sont périssables. Pour qu’un tel marché fonctionne, il faut des règles impératives, par exemple une heure du début du marché et une heure de fin. Il est hors de question de laisser un commerçant ouvrir son stand une heure avant les autres et glaner ainsi la bonne clientèle, ce qui forcerait les autres marchands à venir eux aussi une heure plus tôt. Il est impératif qu’on régule l’entrée des marchands qui ont le droit de leur stand, pour éviter la venue d’opportunistes qui profitent d’une aubaine dans l’achat de marchandises pour casser les prix du moment et déstabiliser les circuits d’approvisionnement. Il est vital que les horaires d’ouverture du marché soient très limités : un jour ou deux par semaine, et uniquement le matin, de sorte qu’il y ait une « épaisseur » du marché permettant que le jeu des prix puisse bien fonctionner et qu’on limite les coûts pour les commerçants tenus d’ouvrir leurs stands quand les clients ne sont pas là tout en gardant une marchandise fraiche. Il faut que le marché soit réellement « ambulant », c’est-à-dire ouvre ici un lundi, là le mardi, etc., de sorte que les commerçants aient toujours à vendre et surtout pour éviter un pic d’approvisionnement (par exemple le seul dimanche) qui obligerait à des coûts logistiques prohibitifs en amont. On voit que certaines de ces règles procèdent d’un ordre spontané fixant la convention ; d’autres d’une autorité centrale fixant la loi[3].
La problématique des délais de paiement entre acheteur et vendeur dans le commerce inter-entreprises procède aussi de régulations et conventions bâties ou imposées au fil du temps : l’acheteur veut être protégé contre la malfaçon ou l’infraction à un contrat. Quoi de mieux alors que de différer le paiement le temps de la vérification et donc, implicitement, de profiter d’un crédit vendeur de son fournisseur (et de lui faire subir le risque de défaut). C’est un mode de partage du risque efficace mais qui peut se révéler inadapté et donc injuste face à des changements d’organisation du commerce (la grande distribution face à des producteurs dispersés) ou des changements technologiques (le juste-à-temps des chaînes de valeur) qui couvrent mieux le risque de mauvaise exécution des contrats. Le délai de paiement apparait alors comme un pur mécanisme de crédit, privé de sa fonction assurantielle, et donc souvent abusif.
Le marché du grain est chéri par les historiens économistes en raison de son importance dans la vie des populations d’alors et parce qu’on en connaît assez bien les ressorts et les niveaux de prix. Il s’agit d’un bien dont l’offre subit les chocs violents des saisons et du climat, mais stockable (à un certain coût). Il n’y a pas de marché possible sans une régulation très forte, soit par convention soit par l’autorité du prince. Les auteurs mentionnés soulignent deux façons dont une certaine régulation du prix a pu se mettre en place : l’annone, pratiquée au sud de l’Europe, qui est une sorte de stock stratégique géré et financé par la puissance publique, et la régulation directe des prix, plus fréquente au nord. Le marché s’organise comme un mécanisme – toujours fragile – d’allocation cherchant à minimiser les risques subis. On comprend parfaitement que les marchés du grain soient restés assez cloisonnés jusqu’en gros au 19e siècle, ce qui choquait Turgot pour qui, dans l’idéal, un marché « libre » et sans frictions fournit automatiquement son service assurantiel : une région peut connaître une sécheresse quand sa voisine a des pluies en abondance, de sorte que l’élargissement du marché garantit une meilleure stabilité. En pratique, il n’en allait pas ainsi : les coûts de transport étaient prohibitifs (davantage que les coûts de stockage), le climat était relativement homogène sur le territoire et il y avait toutes les raisons qu’une région ne rende pas sa pareille si elle avait pu être aidée dans le passé. Le stockage par région devait probablement être un pis-aller proche de l’optimum. Turgot était visionnaire, mais sa libéralisation trop soudaine a été une faute majeure de politique économique et de politique tout court : les institutions – et probablement la technologie logistique – n’étaient tout simplement pas en place pour cette ouverture soudaine. (Cela évoque les privatisations faites à la hâte sous l’emprise d’une idéologie sommaire et d’intérêts ploutocratiques bien installés dans les pays de l’Est qui venaient de sortir du communisme.) On note ici que l’élargissement spatial de l’échange rend plus « épais » le marché et permet davantage d’approcher un prix unique et concurrentiel, ce qui explique que le concept moderne de « concurrence » n’a pu apparaître que tardivement, au tournant du 17ème siècle, dans des économies plus sophistiquées (alors que la notion de « monopole » a été décrite à des époques bien antérieures, parce qu’elle était vécue – et subie – très localement par l’accapareur de la ville ou par le monastère de la province).
On voit pareillement que la stabilisation assurée par l’annone sous égide publique a pu commencer à être assurée par le privé au fil du développement des économies, par exemple via la mise en place de marchés notionnels du blé (un marché financier à terme). Mais quelles précautions, quelles législations faut-il pour que le spéculateur joue proprement son rôle de stabilisateur du prix ! On a ici le célèbre apologue de Milton Friedman faisant de Joseph le saint-patron des spéculateurs (le Joseph du Pharaon et non le Joseph de Jésus) : il sait (par un « tuyau » obtenu de très haut !) qu’il y a 7 années de vaches grasses devant lui, suivies de 7 années de vaches maigres. Il recommande au pharaon de stocker à toute force pendant les 7 premières années, quand le prix du blé est bas, pour revendre ensuite quand il est haut. Est-ce pour le bien public ou par simple avidité ? Qu’importe, dit Friedman. Car l’achat pendant les années grasses soutient le cours et la vente le déprime pendant les années maigres. En clair, un spéculateur ne peut gagner de l’argent que s’il achète bas et revend haut, ce qui provoque le contre-effet sur le prix du marché et donc sa stabilisation. Mais cette fonction s’enraye quand le choc d’offre sur le marché est violent, car un spéculateur laissé à lui-même ira provoquer la rareté par ses achats, stimulant une ruée d’achats par panique chez les intervenants. C’est le marché alors qui s’effondre, au détriment de la partie la moins informée et la plus démunie de la population. D’où un des problèmes éthiques du marché dont on traite dans un instant.
Un dernier exemple montre l’interférence entre la technologie et la structuration de marché. La VPC ou vente à distance est une chose ancienne, bouleversée désormais par la combinaison d’internet et du portable. L’appariement est chose plus facile et crée parfois de nouveaux marchés ou remodèle ceux qui, comme la location temporaire de logement, ne fonctionnaient que grâce à des agents spécialisés assez coûteux. On devine bien que de tels marchés souffrent d’une régulation encore inadaptée, tant du point de vue social que même en ce qui concerne la bonne formation du prix : on sait désormais que les algorithmes de prix peuvent fonctionner sous forme collusive, permettant des surprofits aux places de marché dont on voit qu’elles captent une part élevée de la valeur.
Tous ces sujets font partie de la recherche économique la plus active et une des plus fascinantes de la discipline, comme le montre bien un excellent petit ouvrage de Alvin Roth, Prix Nobel d’économie[4].
Le prix comme équité
Alain Guéry et Jérôme Maucourant ont clairement la deuxième lecture du juste prix, un prix juste parce que rémunérateur et préservant l’ordre social. Guery cherche, comme Michela Barbot, à montrer que le marché dans les sociétés féodales est très loin de représenter l’ensemble des échanges de biens et services. Ceci ne doit pas surprendre puisqu’il en va de même de nos jours : il suffit de voir la masse des échanges non marchands qui se font quotidiennement au sein de chaque entreprise, d’un département ou d’un service à l’autre. L’entreprise est le lieu par excellence du non-marché. Je suis l’auteur plus difficilement quand il indique que l’annone, décrite plus haut, est en contradiction avec le marché et indique le manque de confiance dont il souffre. On a vu qu’elle est bien plutôt un service d’assurance couplé au marché, qui lui en est inséparable (à défaut, le prix qu’offrirait l’acheteur serait bien inférieur pour compenser le risque pris de variabilité du cours). De même, il lui semble que le juste prix féodal s’attache avant tout à défendre une rémunération digne pour le producteur et qu’à défaut c’est le distributeur qui accapare la valeur. Il y a quantité d’auteurs de l’époque médiévale qui sont plus cyniques, indiquant que la dignité n’a rien à voir avec la notion de « juste rémunération » des parties si le prix est fixé dans les bonnes règles d’information et d’égalité des coéchangistes. Un producteur d’un bien qui n’a aucun usage ou qui n’en a plus, ou encore qui n’arrive pas à vendre au même prix que ses concurrents, doit accepter le prix courant, parce qu’il s’agit du prix déterminé par la collectivité du marché[5].
Il y a bien pourtant un problème éthique qui peut surgir du marché, une opposition entre la justice du contrat (qui repose sur une équivalence et en même temps un bénéfice mutuel des deux parties – sinon elles n’échangeraient pas) et la justice de distribution (recevoir de quoi vivre dignement, en vendant ses produits ou son service de travail). La tension est nulle, pourrait-on dire, si tous les intervenants ont un revenu identique : la répartition se fait au mieux des besoins par le jeu du marché. Mais il en va différemment si les conditions économiques diffèrent, comme on le voit en cas de crise d’offre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait du mal à s’approvisionner en thé, la boisson incontournable de tout Britannique. La logique du marché fait que la pénurie n’affecte que les pauvres qui ne peuvent pas payer le prix d’équilibre spontané du marché. Au-delà du thé, c’est vrai pour tout bien dont l’offre est très peu élastique au prix : qu’on pense aux logements en région parisienne ! Le marché est alors « indigne » puisqu’il exclut certaines personnes de l’accès à des biens de base sur un seul critère de revenu. Il faut d’autres procédures d’allocation, par exemple les prix fixes (taxés comme on disait sous l’Ancien régime), ou des coupons ou des tickets de rationnement, ou des files d’attente. Le marché règle bien l’allocation, mais ne respecte pas la dignité des intervenants. On sort de la question du bon « mécanisme » à concevoir pour le marché ; il faut le mettre de côté. Les économistes répondent trop souvent ici qu’il ne faut pas gêner le jeu du marché et des prix dans ces cas-ci, il suffit d’une compensation monétaire : des prestations sociales ou de moindres impôts, en quelque sorte une redistribution par l’argent, alors que l’enjeu est la dignité, celle de pouvoir acheter ou vendre tel bien ou tel service (dont le travail) comme tout un chacun. Cette seconde acception est bien entendu contenue dans la notion de juste prix pour certains religieux du Moyen-Âge, mais elle se situe à mon sens plutôt à la périphérie. Ce n’est pas ici la condamnation du principe de l’échange marchand, mais simplement du fait que dans ce cas d’espèce le marché n’est pas le bon instrument, comme on le voit plus encore s’agissant de certains « biens » moraux (le droit de vote par exemple qui est non négociable) ou certains biens nocifs ou dégradants (les drogues dures, les organes, etc.).
***
Une petite ombre pour finir sur cet excellent livre. Pourquoi des universitaires de talent ont-ils besoin du patronage de Paul Jorion pour soutenir, via sa préface, la vente de leur livre ? Voici une série de travaux qui montrent, sous de nombreux aspects, la complexité du fonctionnement des marchés et l’actualité des réflexions érudites des siècles passés. Et voici que Jorion arrive et, d’une main négligente, balaie – ce qui est hors sujet – les formalisations rapides qu’en donnent les manuels d’initiation à l’économie, pour rentrer dans sa sempiternelle querelle épistémologique sur une science économique qui ne serait qu’une idéologie au service des puissants. Pour être juste, Jérôme Maucourant succombe un peu à la même tentation dans le chapitre qu’il traite, plus occupé à pourfendre l’économie « mainstream » qu’à traiter de son sujet. Il est clair que tout économiste est conscient de l’ancrage social des marchés, de leur « encastrement » pour user du mot un peu lourd qu’on répète à l’envi depuis les travaux de Polyani. Mais redire le mot ne suffit pas. On encastre, on encastre, et finalement on n’a guère fait avancer les choses.
Que cette gêne, peut-être personnelle, ne soit pas un frein à acheter et lire ce livre novateur.
Cet article a été initialement publié le 11 février 2021.
* « Les Infortunes du Juste Prix », sous la direction de Chankowski, Lenoble et Maucourant, éditions Le bord de l’eau, 2020.
[1] C’est « le juste prix comme procédure » comme le dit très bien Jean-Yves Grenier dans sa contribution au livre.
[2] Une des voix les plus écoutées au 16e siècle, le cardinal Cajetan, un thomiste averti, indiquait ainsi ce qu’il fallait entendre par la notion de juste prix : « il s’agit du prix qui, à un moment donné, peut être obtenu des acheteurs, à la condition d’une information partagée et d’une absence de fraude et de coercition ». Cité par de Roover.
[3] Par de nombreux aspects, les marchés financiers, notamment les bourses de valeurs mobilières, fonctionnent pareillement.
[4] Voir « Who Gets What – and Why. The New Economics of Matchmaking and Market Design”, 2015, titre assez sottement traduit en français, avec une tonalité morale décalée : « Les marchés où l’argent ne fait pas la loi », De Boeck, 2017.
[5] Le théologien dominicain Francisco de Vitoria, au début du XVIe siècle, était plus clair encore : les coûts de production, les salaires ou le risque encouru ne sont pas un critère pour juger du bon prix (ceci contre l’idée qu’un juste prix n’est qu’une marge raisonnable sur les coûts) : c’est l’offre et la demande qui dictent les conditions de la vente. Les producteurs inefficaces ou malchanceux n’ont qu’à assumer les conséquences de leur incompétence, malchance ou défaut de prévision.
- Le protectionnisme colonial et le développement économique de l’Inde - 9 janvier 2025
- Gérer le risque ou gérer la résilience ? - 5 décembre 2024
- La trappe malthusienne et son actualité (I) - 14 octobre 2024

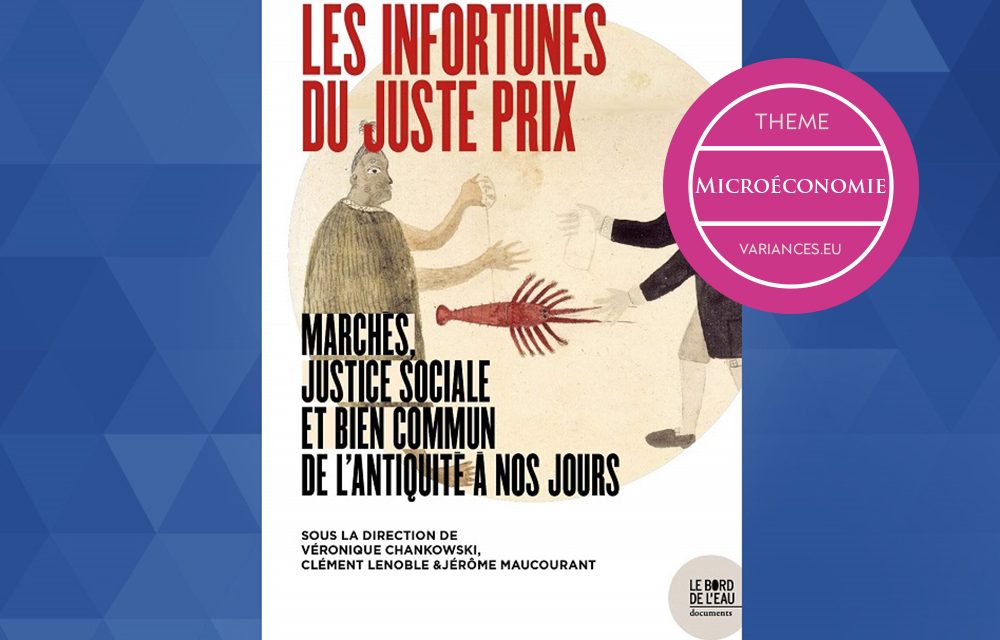
comment mesurez-vous la dignité ? A dires d expert désintéressé, c a d un fonctionnaire au service du public ? Vous rêvez, ou sans doute pas, juste un rêve d interventionniste come tous les ENSAE.