Olivier Martin, alumni, sociologue et statisticien, vient de publier « l’empire des chiffres ». Son ouvrage se structure en deux grandes parties. Il s’agit d’abord d’une enquête sur la quantification progressive des sociétés qui s’observe tant dans les rapports humains que dans les rapports de ceux-ci au monde. Les conséquences actuelles en sont alors tirées, avec l’analyse de la quantification comme fait social. On apprend les nombreux avantages de cette quantification dans l’organisation de nos sociétés, puis le lecteur est finalement conduit à réfléchir sur « le prix à payer ». L’auteur nous propose quelques clés d’entrée dans son livre dense et très documenté, au travers de l’entretien qui suit.
Variances : Tu viens de publier un ouvrage, L’empire des chiffres (éditions Armand Colin), dans lequel tu analyses la quantification du monde, sa mise en chiffres. Pourrais-tu préciser les grandes questions abordées dans ton livre ?
Je suis parti d’un constat simple et peu discutable : il suffit d’écouter la radio, de lire la presse (et pas seulement la presse économique), de surfer sur les sites web ou d’observer nos pratiques professionnelles comme nos vies plus personnelles pour prendre conscience de la présence massive de chiffres, de nombres, d’indicateurs, de mesures, d’indices ou encore de statistiques.
Mon propos est d’analyser les raisons de cette mise en chiffres du monde. Pour quelles raisons les sociétés et les individus en viennent-ils à quantifier la nature qui les entoure, les phénomènes économiques, les pratiques sociales, les propriétés individuelles comme collectives ? Pour quelles raisons cherche-t-on à mesurer l’intelligence, la croissance, le taux de chômage, le poids des biens qu’on échange, les surfaces des terrains qu’on achète, les états dépressifs, le temps qui passe, les distances, la qualité d’un bien et d’un service, ou encore la satisfaction des consommateurs ? On peut répondre que la quantification du monde rend des services. Dès lors la question est celle de la nature des services que la mise en chiffre nous rend. Et on sent bien, comme statisticiens, que la réponse consistant à dire que cela est né d’une quête de connaissance n’est pas la seule raison qui pousse à mesurer. Quels sont les autres motifs ?
Une autre des questions soulevées dans le livre est celle des conséquences de cette mise en chiffre du monde. Que fait-on et que produit-on quand on met le monde en chiffres ?
Variances : Les statisticiens et économistes sont familiers des indicateurs économiques, financiers ou sociaux : on mesure le PIB ; on attribue des notations financières aux États comme aux entreprises ; on mesure la pauvreté ; on évalue des niveaux de risque ; etc. Mais il existe des formes de quantification qui paraissent très différentes a priori : mesurer la température ; chronométrer une course à pied ; peser des légumes ; mesurer l’heure ; etc. Quels rapports y a-t-il entre ces différents types de quantification ? Ont-ils vraiment des points communs ?
Cette question est centrale. Je dirais même que c’est la principale question que je pose et que j’essaie de résoudre : y a-t-il un rapport entre toutes les formes de quantification, entre la mesure du temps, des longueurs, des populations, des faits sociaux, des grandeurs psychologiques ou des phénomènes économiques ? Dans l’ouvrage, je défends l’idée que toutes les formes de quantification partagent des propriétés communes fondamentales. Dans tous les cas, il faut un dispositif technique (ce peut être des questionnaires, des instruments métrologiques, des capteurs, des formulaires administratifs…), une convention (qui rend la mesure acceptable et utilisable par bien d’autres personnes que celle qui procède à la mesure) et un pouvoir (l’individu, le groupe ou l’institution qui effectue la mesure, en défend ou préserve la convention). Toute opération de quantification est faite de ces trois choses : une technique ; une convention ; un pouvoir.
Par ailleurs, mes recherches dans l’histoire et la sociologie de la quantification tendent à montrer qu’il y a trois raisons d’être à la quantification. La première raison (celle qui semble la plus ancienne dans l’histoire des sociétés humaines) résulte de besoins de coordination, d’articulation, de compréhension entre individus : on chiffre le temps, le poids ou la croissance pour coordonner nos actions. Cette coordination peut être locale (à l’image des premières cloches au sommet des églises, qui permettaient de coordonner la vie à l’échelle d’une communauté) ou beaucoup plus vaste (à l’image de l’heure définie à l’échelle d’un pays – comme en France depuis 1891 – ou du monde – depuis l’existence de l’heure universelle depuis 1928 et l’adoption de la Greenwich Mean Time » GMT). De l’époque mésopotamienne à nos jours, ce besoin de coordination (dans l’espace ou dans le temps) est un des principaux moteurs de la quantification.
La deuxième raison d’être des chiffres est le besoin de prendre des décisions, de fonder ces décisions sur des arguments et d’établir la confiance dans les choix opérés : que ce soit à l’échelle individuelle ou à l’échelle d’un gouvernement, les chiffres participent à la prise de décision et à la construction d’une confiance. Les exemples ne manquent évidemment pas : des psychologues ont proposé des tests de mesure de l’intelligence pour orienter ou sélectionner des individus ; on évalue les performances d’une entreprise pour arbitrer et décider d’un éventuel investissement ; on mesure la satisfaction des clients pour ajuster l’offre de biens ou de services ; on évalue l’efficacité des services de police pour décider de les féliciter ou pas ; on mesure la surface d’un terrain pour le partager entre héritiers… Cette raison d’être des chiffres est bien connue des statisticiens comme des manageurs et des décideurs d’aujourd’hui. Mais elle est aussi celle qui justifie qu’on cherche à mesurer la température ou apprécier la probabilité d’une averse avant de sortir de chez soi.
Enfin, la troisième raison est relativement récente : elle s’installe progressivement dans les esprits à partir du XIXe siècle, même si aujourd’hui c’est la raison qui est presque systématiquement mise en avant lorsqu’on veut justifier une opération de quantification. Elle est apparue au moment où les pratiques métrologiques prennent une place croissante dans la recherche scientifique (on peut parler de « révolution quantitative » en science à partir de la fin du XVIIIe siècle) et surtout à partir du moment où les sciences et leurs applications triomphent. Cette raison est celle que nous avons tous en tête parce que nous avons grandi avec : on mesure pour connaître, pour acquérir une connaissance objective des phénomènes.
Variances : Peux-tu préciser l’origine de cette idée selon laquelle « pour bien connaître il faut mesurer » et « sans quantification ni chiffrage, les connaissances ne sont qu’approximatives ». D’ailleurs les agents de l’Insee connaissent bien l’affirmation selon laquelle il faut « mesurer pour comprendre » puisqu’elle qui fait partie du logo de l’institut…
La généalogie de cette idée est évidemment complexe. Mais on peut essayer de la résumer. Il faut d’abord bien réaliser que science ne rime pas avec quantification avant la fin du XVIIIe ou le XIXe siècle : la révolution scientifique du XVIIe siècle, dont il est souvent question et qui marque d’une certaine manière notre entrée dans la modernité scientifique, n’est pas une révolution quantitative. Si la mesure et la mathématisation font lentement leur entrée, il y a beaucoup d’autres choses qui se jouent alors : le rôle de l’expérience (qu’on peut dupliquer et qui peut être publique) ; la constitution de communautés qui échangent et se critiquent ; la naissance d’institutions scientifiques ; l’affirmation d’une rupture avec des préceptes religieux, métaphysiques ou politiques ; etc. Ce n’est qu’au cours du XIXe siècle que les pratiques de mesure et la mise en réseaux de données s’affirment. Les publications scientifiques intègrent de plus en plus de données chiffrées. La quantification devient un ingrédient majeur de la recherche scientifique. Et c’est dans ce contexte qu’un des très grands physiciens du XIXe siècle, Lord Kelvin (de son vrai nom William Thomson) énonce en 1883 l’idée selon laquelle « Dénué de la capacité de mesurer, le savoir reste ingrat et bien peu satisfaisant ». Cet énoncé sera décliné par plusieurs autres auteurs : « mesurer et peser ; ce sont là les causes de toutes les découvertes » ; « quand vous pouvez mesurer ce dont vous parlez, et l’exprimer en chiffres, vous connaissez ce dont vous parlez » ; « tout ce qui n’est pas mesurable relève de la métaphysique » ; etc. Mais la formule la plus célèbre reste incontestablement : « il n’y a de science que du mesurable ».
On trouve ensuite trace de cette affirmation un peu partout, des manuels de sciences physiques à ceux de sciences du management, d’ouvrages de statistiques à des plaquettes de promotion du Quantified-Self, de livres de communication à des sites de conseil en gestion. Cet énoncé est même gravé sur le fronton du bâtiment des sciences sociales de l’Université de Chicago.
Selon moi, de cette histoire, il faut retenir deux choses . D’une part ce n’est qu’assez récemment que l’idée selon laquelle pour connaître il faut mesurer s’est installée dans les esprits. D’autre part que cette histoire est le récit d’une inversion : du constat que la science s’appuie souvent sur des mesures, on arrive à l’idée que la mesure est signe de scientificité et, par-là, d’objectivité, de neutralité…
Variances : Comme tu l’as dit précédemment, tu te penches également sur les effets de la quantification. Peux-tu nous dire un peu plus en quelques mots ?
Chiffrer n’est pas une opération neutre. Il y a plusieurs effets de la quantification. Bien entendu, les chiffres participent à nos manières d’agir, de décider et de nous comporter. Ils façonnent donc notre monde en participant, plus ou moins fortement, au gouvernement de nos conduites. Leurs effets ne s’arrêtent toutefois pas là. Ils peuvent plus profondément nous « gouverner » lorsqu’ils deviennent des objectifs. C’est de plus en plus souvent le cas, en raison de l’émergence des chiffres évaluatifs, qui servent à mesurer des performances et à fixer des objectifs : les sociologues ont bien analysé les effets de l’évaluation chiffrée sur les comportements, par exemple dans les hôpitaux, les services de police et de gendarmerie, ou encore dans l’enseignement. Enfin, la quantification est performative dans la mesure où elle fait exister des grandeurs : les mesures des opinions contribuent à installer l’idée qu’une opinion publique existe ; les tests du QI nous poussent à croire qu’il existe une grandeur, appelée intelligence et que celle-ci est mesurable… À la limite, ces grandeurs n’ont parfois pas tellement d’autre existence que celle que leur confère le dispositif de mesure. On peut par exemple s’interroger sur ce que serait la notion du chômage sans le dispositif qui sert à l’évaluer, à calculer le nombre ou le taux de chômage. De ce point de vue, la quantification réifie des grandeurs ou des notions.
Au total, les quantifications ne sont donc pas que des instruments de description, de connaissance ou d’objectivation du monde : elles participent très activement à la construction du monde tel que nous le percevons et le vivons. Ce sont des « faits sociaux », pour reprendre une expression chère aux sciences sociales. Cela signifie bien sûr qu’ils ne sont pas naturels : les chiffres ne préexistent pas aux sociétés ou aux individus. Cela signifie aussi qu’on ne peut pas y échapper : ils s’imposent aux individus, participent au cours des événements historiques, structurent les relations entre les individus, et on ne peut pas les réduire à de simples actes individuels isolés.
Variances : Ton livre aborde un grand nombre d’exemples de quantification, dans des contextes historiques très différents. Comment as-tu pu te plonger dans des contextes historiques et sociaux si variés ?
En fait j’ai rassemblé plusieurs domaines de recherche qui ont produit des résultats tout à fait intéressants, mais qui ont malheureusement tendance à trop s’ignorer les uns les autres. Il existe par exemple des travaux en histoire de la métrologie qui s’intéressent aux pratiques anciennes d’estimation des longueurs, des poids ou encore des volumes. Il existe aussi un domaine de l’histoire et de la sociologie qui se penche sur les procédés de mesure du temps, aux dispositifs qui rythment la vie des sociétés et aux inventions techniques ayant contribué à faire de l’heure ce qu’elle est aujourd’hui. Dernier exemple, que les statisticiens et économistes connaissent bien mieux : la sociologie historique des statistiques, c’est-à-dire les analyses sur la manière dont les statistiques démographiques, sociales ou économiques ont progressivement été conçues et se sont installées au cœur de nos États. Tous ces domaines de recherche, ainsi que d’autres s’intéressant par exemple à la métrologie scientifique ou aux méthodes d’évaluation, sont riches d’enseignement sur l’histoire de la mise en chiffre du monde. Mais elles dialoguent trop peu et travaillent souvent sans croiser leurs résultats. D’une certaine manière, mon travail a consisté à rassembler ces travaux pour proposer d’en tirer les leçons générales et transversales.
Variances : Tu cites souvent Alain Desrosières dans ton ouvrage. Plusieurs générations d’élèves de l’École l’ont connu comme enseignant et les alumni connaissent bien ses contributions à la construction des nomenclatures socioprofessionnelles[1] comme ses recherches sur l’histoire de la statistique. Peux-tu nous rappeler ses importantes contributions à la sociologie historique de la quantification et pourquoi tu évoques souvent ses travaux dans ton ouvrage ?
Alain Desrosières était un administrateur de l’INSEE qui a notamment œuvré pour réformer les nomenclatures des CSP et pour bâtir des outils de comparaison statistique internationale. Il a également conduit des recherches originales et fécondes en sociologie et en histoire des statistiques en étant membre d’un laboratoire de sociologie de l’EHESS et en dialoguant avec plusieurs chercheurs très renommés en sociologie et en histoire. Il est l’auteur d’un ouvrage qui est désormais un grand classique pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la statistique publique, des sciences statistiques et probabilistes et de leur rôle dans la constitution des sociétés et des États : La politique des grands nombres, paru en 1993 et traduit dans plusieurs langues depuis. Son double positionnement, à la fois comme statisticien à l’INSEE et comme sociologue dans l’espace universitaire, lui a permis de construire une réflexion originale située au croisement d’une vision positiviste et d’une vision critique des statistiques. Il est difficile de résumer en quelques mots son apport, mais s’il fallait retenir une phrase qu’il prononçait et écrivait souvent, nous pourrions citer « quantifier, c’est convenir puis mesurer ». À travers ces mots il voulait notamment dire que la production de statistiques n’est pas un acte de lecture passive du monde, mais une action de création de conventions nécessaires à toute opération de dénombrement ou de mesure. Mettre en chiffre, quantifier, suppose au préalable que soient élaborées des conventions d’équivalences, qui nécessitent un « travail social » de négociation, de compromis, de catégorisation… Sans cela, il n’y aurait pas de « mesure du chômage » ni du PIB. D’une certaine manière Alain Desrosières a théorisé les pratiques de quantification statistique dans les domaines économiques, sociaux et démographiques.
Le domaine de recherche qu’on appelle la « sociologie historique de la quantification » lui doit beaucoup : à la fois parce qu’il a produit des travaux qui ont bien identifié les enjeux et ont proposé des réponses stimulantes, et aussi parce qu’il a très généreusement aidé beaucoup de chercheurs, notamment de jeunes chercheurs, à construire leur propre réflexion. J’ai eu la chance de faire partie de celles et ceux qu’il a aidés durant leur doctorat.
Son travail trouve une place naturelle dans mon propre travail, même si j’essaie d’élargir son questionnement et son approche à d’autres formes de quantification que les statistiques, les indicateurs économiques et sociaux ou les outils quantitatifs du néolibéralisme.
Variances : Comment un ancien élève de l’ENSAE comme toi en arrive-t-il à s’intéresser à ces questions ?
J’avais choisi l’ENSAE pour continuer à faire des mathématiques et découvrir leurs applications aux faits humains. Évidemment, quand je suis arrivé à l’ENSAE c’était davantage une intuition qu’un choix mûrement réfléchi. J’aimais beaucoup l’histoire, mais je ne savais pas vraiment ce que c’était que la sociologie ou l’économie. Je me sentais simplement attiré par des questionnements – très vagues à l’époque – sur la place et le rôle des mathématiques pour étudier les individus et les sociétés. Je dois avouer ici que j’ai été plutôt déçu par les enseignements de l’époque : il y avait des choses passionnantes, mais aussi beaucoup de cours qui ressemblaient à de simples exercices de mathématiques avec un vernis de réflexion sur les comportements individuels et sociaux. Cela me semblait bien artificiel. En somme, j’avais le sentiment de modéliser, de mesurer, de calculer sans trop savoir ce qu’on étudiait derrière tout cela. Par exemple j’étais dubitatif devant l’idée de prétendre mesurer l’utilité ou l’intérêt des individus… J’ai voulu creuser la question que je formulais de manière naïve à l’époque : peut-on mesurer les grandeurs que les économistes, les sociologues ou les psychologues utilisent ? Comment peut-on penser qu’on va arriver à mesurer une utilité, un intérêt, une opinion ou une intelligence ? J’ai eu la chance de pouvoir faire une thèse à l’EHESS sur ces sujets, en lien avec un laboratoire de mathématiques regroupant des historiens des mathématiques et des probabilités, et un laboratoire de sociologie des sciences.
Au fond, l’ouvrage l’Empire des chiffres, est une réponse directe, mais lointaine à ces questions sur la mesure ! J’espère simplement que le temps a permis de faire mûrir à la fois mon questionnement et les éléments de réponses que je propose aujourd’hui.
Propos recueillis par Gérard Bouvier
« L’empire des chiffres » d’Olivier Martin, aux éditions Armand Colin
[1] On pourra notamment se référer à https://variances.eu/?p=4452

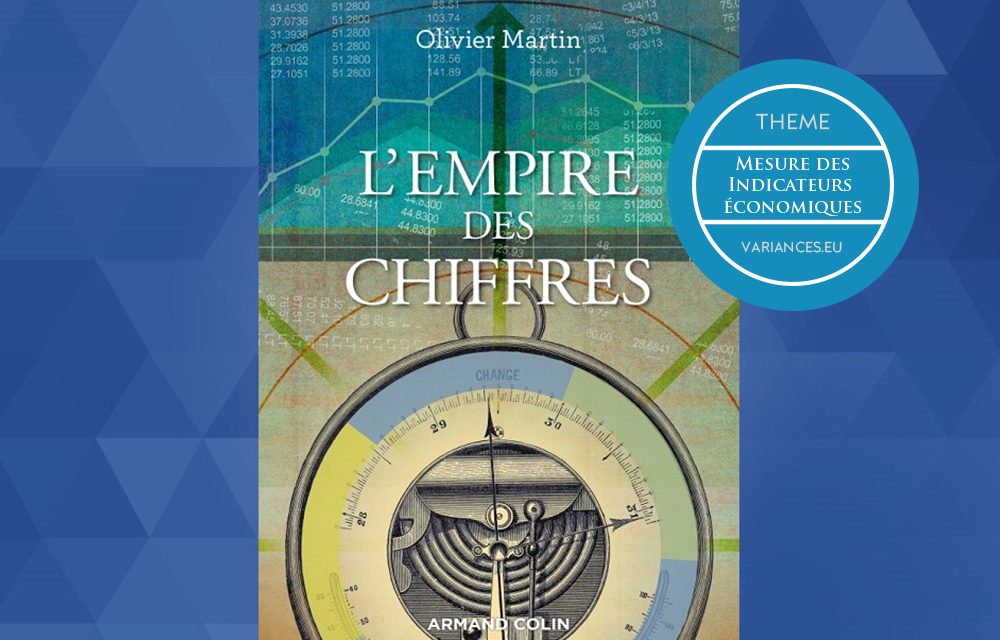
Je ne suis pas certain que mes remarques seront prises en compte , en raison d’une remarque précédente qui n’avait eu de suite dans les échanges.
Cependant, je souhaiterais affirmer que si « science is measurement », science is as well « understanding » and « qualifying ». Autrement dit, on a trop tendance à « voir » les faits qualifiés de scientifiques par la lorgnette numérique, alors que, depuis maintenant longtemps, l’on distingue le quantitatif et le quantitatif.
Une grandeur numérique ne vaut que si on la rapporte à son signifiant, qui est généralement un attribut (indice de prix à la consommation, etc) de même que, à l’inverse, un tableau de contingence n’a de sens que si l’on connaît la nature des descripteurs et de leurs modalités. Autrement dit, l’on ne saurait tout réduire au quantitatif, même si J.C. Deville me disait un jour que l’on doit pouvoir « tout » réduire, non seulement à du numérique, mais en plus à du discret dichotomique (0 ou 1 = binary unit).
Bien sûr, on a besoin des maths pour aller au-delà, mais celles-ci sont conditionnées par les variables qu’elles sont censées représenter aussi bien que par ses propriétés opératoires. En outre, on peut remarquer que aussi bien l’introduction (summary) d’une étude que sa conclusion ne sont pas numériques, mais généralement évaluatives. Même une CS peut être vue comme une variable qualitative (de type score qualitatif) « résumant » en une modalité un ensemble de considérants quantitatifs (revenu ou niveau de vie, etc) ou qualitatifs (nature du métier, de la formation, de l’activité économique, etc).
Par ailleurs, ce que l’on peut observer des phénomènes étudiés dépend largement de nos sens, notamment la vue, et ceux-ci ont, aussi bien que les outils statistiques qui servent à observer et aboutissent à une « production statistique » (instituts, labos), leurs propres limites observationnelles. Ceci entraîne des considérations parfois nuancées en raison de ces limites (observations imparfaites et imprécisions, erreurs subséquentes, tests peu conclusifs ou avec doute, données censurées ou manquantes, etc). Enfin, la « vulgarisation » des connaissances auprès d’un « public » donné comporte les deux aspects évoqués ici.
J’espère que cet interview ne laisse pas entendre ou croire que je défends l’idée que « science is measurement ». Mes recherches (et notamment l’ouvrage « L’empire des chiffres ») ne constituent pas des travaux d’épistémologie cherchant à savoir ce qu’est la science, ce que n’est pas la science. Je m’interroge simplement sur le rôle historique et sociologique des pratiques de quantification dans nos sociétés. Cela conduit évidemment à porter un regard sur le rôle de la quantification dans les sciences : mon propos est de souligner que les pratiques de mesure sont allées croissantes, notamment à partir du XIXe siècle et qu’elles ont progressivement joué un rôle essentiel dans l’imaginaire ordinaire (vulgarisation) de la science. Ce n’est pas un propos normatif ou épistémologique mais plus simplement une analyse historique et sociologique sur la place des chiffres dans les sciences (et en dehors de l’univers des savoirs savants).
Et même si la mesure joue un rôle historique croissant dans les sciences, rien ne doit laisser croire que la science se résumerait à des activités de quantification. Il y a bien d’autres choses dans les sciences : des concepts, des formalisations non quantitatives, des catégorisations qualitatives, des nomenclatures, des notions non déductibles à des grandeurs quantifiées, des paradigmes… Il suffit par exemple de penser au « principe d’inertie » en physique, ou aux classifications en biologie…