Publier un livre intitulé « Histoire de l’économie mondiale »[1] est ambitieux au point même de paraître prétentieux. Et donc quand je me suis engagé dans cette aventure, je ne me donnais pas comme objectif d’être exhaustif. En fait, il s’agissait de partir d’une appréciation sur l’économie faite par Voltaire dans son conte L’Homme aux quarante écus publié en 1768. Il y dénonce en particulier le fait que la vie économique est perturbée par le détournement des richesses par des groupes de prédateurs. Ceux-ci sont, selon lui, surtout les religieux. C’est ainsi qu’il écrit :
« Pourquoi le monarchisme a-t-il prévalu ? Parce que le gouvernement fut presque partout détestable et absurde depuis Constantin ; parce que l’Empire romain eut plus de moines que de soldats ; parce que les chefs des nations barbares qui détruisirent l’empire, s’étant faits chrétiens pour gouverner des chrétiens, exercèrent la plus horrible tyrannie ; parce qu’on se jetait en foule dans les cloîtres pour échapper aux fureurs de ces tyrans, et qu’on se plongeait dans un esclavage pour en éviter un autre ; parce que les papes, en instituant tant d’ordres différents de fainéants sacrés, se firent autant de sujets dans les autres États ; parce qu’un paysan aime mieux être appelé mon révérend père, et donner des bénédictions, que de conduire la charrue ; parce qu’il ne sait pas que la charrue est plus noble que le froc ; parce qu’il aime mieux vivre aux dépens des sots que par un travail honnête ; enfin parce qu’il ne sait pas qu’en se faisant moine il se prépare des jours malheureux, tissus d’ennui et de repentir. »
Pour Voltaire, l’Église que symbolise le froc ignore la charrue et le travail pour vivre d’une rente prélevée sur la charrue, c’est-à-dire de la possibilité institutionnelle d’obtenir un revenu supérieur à sa contribution à la création de richesses.
Ce constat est fait également au XIXe siècle par Adolphe Blanqui (1798-1854). Cet ami et disciple de Jean-Baptiste Say (1767-1832) publie en 1837 une Histoire de l’économie politique depuis les Anciens jusqu’à nos jours. Le texte n’est pas une histoire des idées économiques mais une histoire des événements économiques. Dans son introduction, il écrit :
« Dans toutes révolutions, il n’y a jamais eu que deux partis en présence : celui des gens qui veulent vivre de leur travail ; celui des gens qui veulent vivre du travail d’autrui. On ne se dispute le pouvoir et les honneurs que pour se reposer dans cette région de béatitude. »
Le fil conducteur de mon livre est donc que l’histoire économique reste marquée inexorablement, quelles que soient les circonstances et quel que soit le lieu, par l’affrontement entre le monde du travail et de la création de richesses d’une part, et celui de la prédation bureaucratique de cette richesse, d’autre part.
L’« économie politique », qui naît au XVIIe siècle, est d’abord une réflexion sur les finances publiques. Si elle devient au XVIIIe siècle une étude de l’augmentation de la richesse créée, elle reste une réflexion sur la possibilité, grâce à la croissance économique, d’accroître la base taxable à disposition de la prédation étatique. L’un des tout premiers économistes de l’histoire, le Français François Quesnay (1694-1774), explicitait cela au travers d’une formule restée célèbre :
« Pauvres paysans, pauvre royaume ; pauvre royaume, pauvre roi. »
Cela signifie simplement que l’État a du mal à collecter l’impôt et donc à exister si son accise géographique ne génère pas suffisamment de richesses.
Au XIXe siècle, cette articulation entre l’Etat et la production prend une nouvelle dimension.
Les économistes allemands que l’on appelle les « socialistes de la chaire » étendent en effet le rôle économique de l’État. Né initialement comme garant de la sécurité physique de ses obligés et en partie de la préservation de leur droit de propriété, l’État a par ailleurs une mission économique et sociale spécifique. Il doit d’abord garantir des débouchés aux entreprises. Il doit ainsi être considéré directement ou indirectement comme le « consommateur en dernier ressort », capable de fournir la demande susceptible d’absorber l’offre, au besoin en augmentant ses dépenses. Il doit ensuite être également considéré comme le « gestionnaire de l’oisiveté ». Les socialistes de la chaire défendent un droit à l’oisiveté consentie par la société à une partie de la population du fait de son âge ou de sa situation de santé, théorisant ainsi la création de l’« État-providence ». Ce double rôle de l’État – consommateur en dernier ressort/gestionnaire de l’oisiveté –conduit à l’énoncé de la « loi de Wagner », du nom de son auteur, Adolf Wagner (1835-1917). Cette figure de proue du « socialisme de la chaire » expose ses idées dans ses Fondements de l’économie politique parus en 1876. La fameuse « loi de Wagner » y figure, ainsi formulée :
« Plus la société se civilise, plus l’État est dispendieux. »
Construit autour de la phrase de Quesnay et de celle de Wagner, le livre analyse l’évolution de la croissance à partir des travaux d’Angus Maddison (1926-2010). Celui-ci a établi que le PIB mondial a doublé entre 1000 et 1500. Il a de nouveau doublé entre 1500 et 1700, puis entre 1700 et 1820. Entre 1820 et 1913, il a été multiplié par quatre. Si on regarde le PIB par habitant, sa croissance a été nulle des débuts de notre ère à 1700. De 1700 à 1820, elle a été de 0,1 % par an. Puis l’économie décolle avec une moyenne annuelle de 0,9 % entre 1820 et 1912, et de 1,6 % entre 1913 et 2012.
En 1813, beaucoup d’habitants de la planète ont un style de vie qu’un Romain de la période impériale aurait compris. En 1913, beaucoup d’habitants ont un style de vie qu’un Français de la période impériale ne comprendrait pas.
Pour expliquer ces évolutions, Maddison écrivait dans un article résumant ses recherches et publié en 1992 :
« Le progrès technique est le moteur essentiel de la croissance économique. S’il n’avait jamais existé, l’ensemble du processus d’accumulation du capital aurait été plus modeste. »
Et ce progrès technique a été rendu possible par une véritable révolution intellectuelle ; il écrit en effet :
« A partir du XVIIe siècle les élites occidentales ont abandonné la superstition, la magie et la soumission à l’autorité religieuse »
Une des caractéristiques de l’accélération de la croissance de l’économie mondiale est qu’elle a connu deux pays leaders successifs – le Royaume-Uni d’abord, les Etats-Unis ensuite – et deux effacements relatifs – la France et surtout la Chine.
Le Royaume-Uni qui fait la course en tête au XIXe siècle, a conforté sa position de leader grâce à la cohérence de son modèle économique que les économistes d’autrefois qualifiaient de ponocratique, c’est-à-dire, étymologiquement parlant, fondé sur le respect et la mobilisation du travail. Ce modèle avait deux fondements essentiels : la liberté et le charbon.
La liberté s’incarne dans la généralisation de la concurrence dont un des aspects les plus déterminants est le libre-échange. Une légende veut que le libre-échange anglais ait été la réponse des autorités de Londres, en 1847, à la nécessité d’importer des céréales pour faire face à une grave famine en Irlande. C’est méconnaître le sentiment profond de la classe politique anglaise de l’époque vis-à-vis de l’Irlande que de penser qu’elle ait pu prendre une décision dans le but de soulager les malheurs de ce pays. D’ailleurs, l’abolition des lois sur l’importation des céréales est antérieure à 1847 : elle date de mai 1846. L’Angleterre devient libre-échangiste, non pas sous le poids d’une quelconque urgence irlandaise, mais selon une vision globale du fonctionnement de l’économie et des avantages de la concurrence. Pour les Anglais des années 1840, la concurrence stimule l’activité économique, que cette concurrence soit nationale ou internationale. Cette opinion est assez caractéristique de la façon de penser des Anglais. Dans la Magna carta de 1215, l’article 41 peut être considéré comme une des premières manifestations de l’esprit libre-échangiste anglais. Il précise en effet :
« Tous les marchands pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d’après les anciens droits et coutumes, sans péage malveillant, excepté en temps de guerre. »
Le second atout de l’économie anglaise du temps de sa splendeur a été popularisé en France au travers d’un roman de Jules Verne paru en 1877. Son titre – Les Indes noires – se veut un résumé des origines de la richesse et de la puissance économique du Royaume-Uni de l’époque. Pour l’auteur, cette puissance repose sur deux piliers : d’une part, l’exploitation coloniale de l’Inde ; d’autre part, la production de charbon qui donne à la révolution industrielle l’énergie dont elle a besoin, le pays minier britannique recevant ainsi le surnom d’Indes noires. Dans le premier chapitre de ce roman, Jules Verne écrit :
« On sait que les Anglais ont donné à l’ensemble de leurs vastes houillères un nom très significatif. Ils les appellent très justement les « Indes-Noires », et ces Indes ont peut-être plus contribué que les Indes orientales à accroître la surprenante richesse du Royaume-Uni. Là, en effet, tout un peuple de mineurs travaille, nuit et jour, à extraire du sous-sol britannique le charbon, ce précieux combustible, indispensable élément de la vie industrielle. »
Pendant longtemps, le Royaume-Uni a été un producteur et un exportateur d’énergie. En 1913, la production annuelle de charbon du Royaume-Uni est de 294 millions de tonnes dont 96 millions sont exportés. Cette production représente 22 % de la production mondiale. Elle occupe 1 127 000 ouvriers mineurs. Elle fournit une quantité d’énergie sans équivalent. En 1840, pour obtenir en brûlant du bois la quantité d’énergie fournie par le charbon utilisé, il aurait fallu abattre une forêt couvrant le double de la surface de la Grande-Bretagne. Le charbon est d’autant plus important qu’il fournit à l’Angleterre non seulement l’énergie de ses usines et le chauffage de sa population, mais encore le combustible de ses chemins de fer et la matière première de son industrie sidérurgique.
Quant à la prédation étatique, le modèle britannique fait tout pour la contenir. Il repose sur la promotion d’un « État minimal » équilibrant ses comptes et réduisant au strict nécessaire son rôle de « gestionnaire de l’oisiveté ». La mise en place de cet État minimal est symbolisée par William Gladstone qui est le leader du parti libéral. Gladstone fut successivement chancelier de l’Échiquier et Premier ministre. Il donne la définition de l’État minimal en 1852, lors de son premier passage à l’Échiquier. Pour lui, la première chose à faire, chaque fois que l’on augmente la dépense publique, est de regarder la conséquence qu’aura la disparition concomitante d’une dépense privée, disparition liée à l’augmentation des impôts. Ce choix de l’État minimal freine pendant près d’un siècle la montée en puissance de la loi de Wagner.
Après deux guerres mondiales qui sont comme un suicide de l’Europe, ce sont clairement les États-Unis qui deviennent la puissance dominante. En 1950, ils sont dirigés par Harry Truman, qui met en place le cadre intellectuel de ce monde américain du système qui va s’imposer au monde. Sur le plan économique, il est conseillé par Alvin Hansen, que l’on peut considérer comme le concepteur, plus encore que Keynes, de ce qu’il est convenu d’appeler le keynésianisme. En 1948, il publie Economic Policy and Full Employment. La thèse centrale en est que l’État peut atteindre le plein-emploi, pourvu qu’il accepte de laisser filer le déficit budgétaire. Face à l’URSS, rival finalement disparu du modèle américain qui fait de l’État l’employeur total et exclusif, l’État keynésien américain se mettant en place dans la foulée du New Deal et de la Seconde Guerre mondiale à la place de l’État libéral anglais, affirme avoir les moyens de garantir le plein-emploi pourvu qu’il accepte de s’endetter.
L’État communiste est employeur en premier ressort. L’État keynésien, parce qu’il est consommateur en dernier ressort, s’affirme employeur en dernier ressort, se faisant ainsi une incarnation ultime de la loi de Wagner. Les deux prétendent atteindre in fine, bien que par des moyens différents, le plein-emploi.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les premières années de l’Etat keynésien sont remarquables sur le plan de la croissance. Ce sont celles, mythiques, des Trente Glorieuses. Elles s’achèvent avec le choc pétrolier de 1973, qui initie une inflexion dans l’évolution de la croissance, sans briser pour autant complètement la dynamique d’expansion, ni remettre en cause le choix keynésien des années Truman.
Aujourd’hui, l’Etat keynésien américain est essoufflé. La croissance se dérobe : en France, la croissance potentielle, qui était de 5,5% dans les années 1960 est désormais d’à peine 1%, un niveau, en temps de paix, qui n’a jamais été aussi bas depuis 1820.
Au terme de cette longue histoire, la leçon qui s’impose est que l’économie ne s’est jamais mieux portée que quand l’État l’a laissée vivre, quand le roi a compris qu’il resterait pauvre si le royaume l’était.
Pour aller dans ce sens, citons deux économistes d’autrefois. Michel Chevalier d’abord. Dans la leçon inaugurale de son cours d’économie au Collège de France en 1849, revenant sur le bilan des révolutions de 1848, il déclarait que l’ennemi de l’économie était l’alchimiste. Le même Michel Chevalier, prenant de nouveau la parole au Collège de France en juillet 1871, à l’issue de « l’année terrible » que venait de traverser la France, assurait que le pays pouvait rétablir sa prospérité, à condition de respecter quelques règles simples. Celles-ci se résument en quatre mots : travail, épargne, instruction, liberté. Et Michel Chevalier de préciser que « liberté » en économie se dit « concurrence ».
Mais le texte le plus percutant sur le destin croisé de l’Etat et de la croissance économique reste cet extrait de l’article « Économie politique » de l’Encyclopédie :
« Si l’on examine comment croissent les besoins d’un État, on trouvera que souvent cela arrive à peu près comme chez les particuliers, moins par une véritable nécessité, que par un accroissement de désirs inutiles, et que souvent on n’augmente la dépense que pour avoir le prétexte d’augmenter la recette ; de sorte que l’État gagnerait quelquefois à se passer d’être riche, et que cette richesse apparente lui est au fond plus onéreuse que ne serait la pauvreté même. On peut espérer, il est vrai, de tenir les peuples dans une dépendance plus étroite, en leur donnant d’une main ce qu’on leur a pris de l’autre ; mais ce vain sophisme est d’autant plus funeste à l’État, que l’argent ne rentre plus dans les mêmes mains dont il est sorti, et qu’avec de pareilles maximes on n’enrichit que des fainéants de la dépouille des hommes utiles »
Et ce n’est pas Voltaire qui a écrit cela, mais …Jean-Jacques Rousseau !
Mots-clés : Quesnay – Wagner – Prédation fiscale – Croissance économique – Progrès technique – Royaume-Uni – Etats-Unis
Cet article a été initialement publié le 10 mars 2022.
[1] « Histoire de l’économie mondiale », aux éditions Tallandier
- Monnaie : voile ou moteur de la croissance - 1 décembre 2025
- Histoire de l’économie mondiale : des chasseurs-cueilleurs aux cybertravailleurs - 16 août 2022
- Enseigner l’économie - 10 décembre 2018

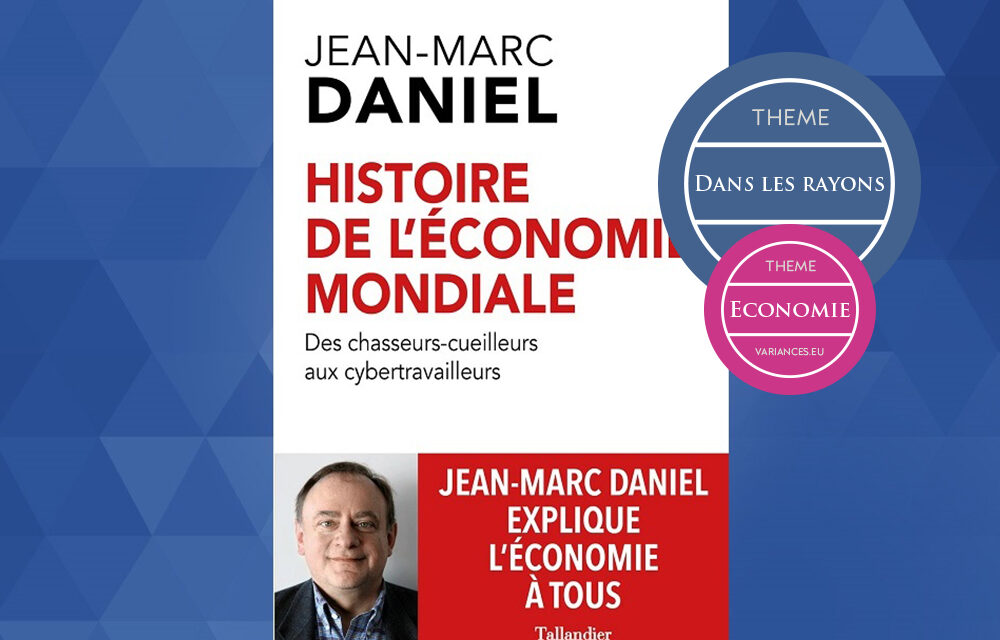
Intéressant mais on aurait aimé plus de distance critique sur les présupposés politiques et idéologiques de cette éloge de l’économie libérale, e la libre concurrence et de la liberté d’entreprendre. Au moment où le dernier rapport du GIEC, la guerre en Ukraine, et l’évidence des limites physiques de notre planète à une croissance sans fin pointent vers l’impérieuse nécessité de repenser nos modèles économiques, on aurait apprécié que ce tour d’horizon de l’économie jette ses regards sur ces économistes, philosophes, sociologues et historiens qui ouvrent des perspectives autres que celle du sacro saint PIB à l’évaluation des richesses et à la recherche du bien être d’un pays. Citons à ce titre les travaux du Shift Project, auquel la revue Variances pourrait ouvrir ses pages, mais aussi ceux de la commission Stiglitz – Sen, ou de F Jany-Catrice. On pourrait même aller voir ce que donne l’expérience néo-zélandaise de mise en place d’un « well-being » budget, depuis 2019.
En bref, il est vraiment temps de changer de lunettes, non seulement pour comprendre où va notre monde, et les forces centrifuges qui le déchirent, et donc les impasses d’un modèle néo-libéral exclusif et prédateur, mais aussi avancer sur des voies, nouvelles, porteuses d’un avenir durable pour nos enfants, et constructrices d’un monde qui ne laisse personne de côté, comme le veulent les ODD 2030. #Lookup!
Cet économiste ressasse encore et encore la théorie des Chicago-boys des années 80… théorie un poil daté, non?
Est-ce vraiment le poil qui est daté ou la théorie ?
Jean-Marc Daniel, pourquoi sait-on à l’avance ce que vous allez écrire ?
Je suis d’accord avec la réponse de Philippe Huet, à laquelle j’ajoute trois points :
– Quid de la bureaucratie dans les grandes entreprises, où les cadres de direction font travailler les salariés esclaves à leur profit, ce qui constitue une oppression et une prédation bien plus terribles que celle de l’Etat ? Et je ne parle pas de la situation des ouvriers durant le « génial » XIXème siècle anglais et français (Cf. les romans de Charles Dickens et de Victor Hugo)…
– La concurrence « libre et non-faussée » et le libre-échangisme ne sont ni souhaitables, ni réalistes : Cf. les asymétries d’information sur la plupart des marchés, ainsi que la situation de monopole à laquelle tend le capitalisme. Vous oubliez le rôle indispensable de l’Etat en tant que régulateur de l’économie, en particulier lorsque les marchés et la concurrence s’avèrent incapables d’atteindre de quelconques objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
– L’action budgétaire de l’Etat de nos jours, que ce soit en France ou dans les pays d’Europe du Nord, est surtout de redistribuer les richesses créées, afin qu’elles profitent également aux plus pauvres, qui n’ont pas le pouvoir. Que reprocher à cet objectif de réduction des inégalités de naissance et de destin et de justice sociale ?
Frédéric Eichel, ENSAE 1986