L’opportunité m’est donnée de rencontrer Marianne (née un 14 juillet !) dans un bistrot parisien. J’ai en face de moi une trentenaire épanouie, ravie de son métier, mariée à un X de sa promotion et mère de deux enfants en bas âge. L’image même de la réussite. Elle est depuis cinq ans « data scientist » au siège d’Uber à San Francisco et elle adore ça. Ce n’était pas son premier job. Elle a commencé comme administratrice Insee, en choisissant une direction régionale, à Nantes. Cela lui a bien plu mais l’attrait des Etats-Unis a été le plus fort… Et, quand elle en parle, elle est très, très convaincante. Son expérience est d’un intérêt majeur pour les élèves qui cherchent leur voie à la sortie de l’école. Et elle est prête à les conseiller.
Les années Insee : l’attrait du terrain
Marianne choisit l’ENSAE à la sortie de l’X par attirance pour la micro-économie et la statistique mathématique. Elle a été surprise au tout début par le côté assez scolaire et académique des cours mais elle a rapidement accroché en découvrant que la stat maths avait des applications concrètes. Elle aime en effet proposer des solutions pratiques à des problèmes concrets posés par les demandeurs. C’est pourquoi elle a choisi, comme premier poste, une direction régionale car, plus que les études nationales des collègues parisiens, les études régionales répondent à des demandes effectives des acteurs publics locaux. Elle se rappelle ainsi la prévision qu’elle avait faite du nombre de lycéens à moyen terme, instrument essentiel pour déterminer les investissements scolaires à financer par la région.
Mais Marianne et Maxime, son mari, avaient un projet depuis leur stage de l’X : aller travailler aux États-Unis. Cela leur est venu depuis qu’ils ont pu bénéficier l’une, d’un stage au MIT, l’autre à Harvard. Et là, ils ont découvert un monde où on fait confiance aux jeunes chercheurs et où on dispose de beaucoup plus de moyens, notamment logiciels, qu’à l’Insee. Au MIT, elle conçoit un modèle réduit de réacteur et on lui donne une carte de crédit pour acheter tout ce dont elle a besoin, sans discuter et en lui faisant totale confiance ! Alors les deux jeunes, éblouis, se lancent de conserve dans la recherche d’un job dans le Nouveau Monde, et plutôt sur la côte Ouest… Celle de la Silicon Valley.
La conquête de l’Ouest
Ils découvrent d’abord que c’est très difficile. Pour être embauché, il faut un visa de travail et ce document n’est accordé qu’au compte-goutte. C’est si compliqué et coûteux pour une entreprise que les petites structures renoncent. Seules les grosses peuvent se le permettre. Il faut ensuite sauter l’obstacle de la DRH qui, ne connaissant pas bien les écoles de chez nous, met systématiquement les demandes françaises au panier. Ainsi, ce sont plus de cent candidatures que Marianne envoie à nombre d’entreprises californiennes. Et c’est par chance qu’un cadre technique indien de Uber qui connaît l’X car il y a fait un mastère, rattrape le coup d’une DRH qui l’avait écartée d’office. S’ensuit une véritable course de haies : cinq entretiens très techniques dont le dernier s’est déroulé de 21h à 1h du matin (heure française) ! De son côté, à force de persévérance, Maxime voit également la chance lui sourire et il décroche un boulot dans une filiale d’un groupe français, à San Francisco. Son bureau est même en face d’Uber ! Ca y est, ils ont décroché la Lune !
Chez Uber (27 000 employés, des milliers d’ingénieurs, des centaines de data scientists), Marianne a une liberté totale et les moyens qui vont avec. C’est l’esprit américain : si on échoue, ce n’est pas grave. Le contexte est comme on le décrit souvent : tout est fait pour qu’on se sente bien au travail (et donc qu’on y reste le plus longtemps possible…). Le salaire va bien sûr avec, même si le coût de la vie est beaucoup plus élevé qu’à Paris et ce n’est pas le salaire qui est la motivation principale. Cela n’empêche pas le couple d’avoir un appartement en centre-ville donnant sur la baie. Tous les matins, Marianne se réveille, se pinçant face à cette magnifique vue. Et puis les week-ends, il y a les randonnées dans les parcs et le ski à trois heures de route. En plus, elle a le sentiment qu’elle est, en tant que femme et mère, très bien traitée. Bien sûr, le « politiquement correct », l’idéologie « anti discriminatoire », l’obsession de la « gender equality », conduisent parfois à recevoir des messages des RH qui peuvent sembler surréalistes à une Française. Ainsi, comme dans la plupart des entreprises de la Silicon Valley, les employés peuvent notamment choisir le pronom par lequel ils souhaitent être désignés. Elle se contente d’observer, curieuse de cette culture différente… En revanche, comme d’autres (dont moi-même) en font l’expérience, on ne se fait pas d’amis américains sur place. On fait des connaissances mais plutôt parmi les étrangers. Il faut dire que chez Uber, les équipes sont très internationales et finalement rares sont ceux qui sont nés et ont grandi aux États-Unis. Les relations qu’elle a nouées à l’Insee sont bien plus fortes et durables, et, elle l’admet sans détour, son cœur est encore en France.
Un travail passionnant
Avant de l’interviewer, j’avais lu un papier qu’elle a publié au début de l’année, au sujet de son travail chez Uber. Il est intitulé : « Why Financial Planning is Exciting… at Least for a Data Scientist ». Dans ce papier, pourtant un peu technique, elle associe sa fonction aux mots surprenants de « real fun », « creativity », « incredibly exciting ». Honnêtement, je pensais que c’était un peu du chiqué pour faire plaisir à sa direction qui, comme toutes les entreprises de la Silicon Valley, cherche à tout prix des ingénieurs. Mais, l’expérience que vit Marianne semble tout à fait valider ces qualificatifs. Son job est « hyper » varié ; elle est « hyper » autonome ; elle a tous les moyens qu’elle veut ; elle a une équipe de six data scientists de très bon niveau. Bref, elle adore son boulot.
Les outils appris à l’ENSAE lui sont utiles mais elle n’en utilise qu’une petite partie. Le traitement des big data commence par exemple par leur nettoyage préalable, ce qui requiert quelques bases de maths, de la pratique et du bon sens. Ensuite, pour faire ses analyses et répondre aux questions qu’on lui pose, elle utilise de temps en temps de l’IA de traitement de données comme les réseaux neuronaux, mais elle opte souvent pour des modèles plus classiques. En effet, les demandeurs (ses « business partners ») veulent savoir comment ses résultats ont été obtenus et la boîte noire de l’IA ne le permet pas. Les modèles traditionnels sont extrêmement variés, il peut s’agir de simples régressions linéaires, logistiques, ou bien d’analyses en composantes principales, de modèles bayésiens, ou encore de modélisations de distributions bien connues (lois binomiales, géométriques, bêta, gamma, etc). Dans tous les cas, ses logiciels de prédilection pour implémenter ses idées sont Python et R. Elle commence par développer des prototypes sur des « notebooks » en ligne, puis une fois satisfaite de ses modèles, elle passe à l’étape de « production » qui consiste à écrire du code optimisé et standardisé sur les « repostories » Uber. En passant, elle me glisse qu’elle a dû faire économiser à Uber des millions de dollars avec ses modèles de prévision de trajets/chauffeurs/clients/prix, ville par ville, dans le monde entier !
Quand je lui dis que certains critiquent « l’Uberisation » du marché du travail, elle répond que, si le métier de chauffeur n’est pas nécessairement « durable », il est selon elle un formidable marchepied pour des milliers de laissés pour compte qui avaient perdu tout accès au marché du travail. Ainsi, des jeunes sans diplômes, sans expérience, plus ou moins marginalisés font l’expérience d’un emploi où il faut présenter bien, être à l’heure et respecter des règles.
Elle me confie que le but ultime d’Uber est de créer une application complètement généraliste permettant de savoir comment aller de A à B partout dans le monde en utilisant tous les modes de transport, au maximum respectueux de l’environnement, y compris publics, y compris bicyclettes ou trottinettes… Elle ne m’a pas dit si elle y travaillait personnellement… C’est probablement confidentiel.
Je lui demande alors, question traditionnelle, quel conseil elle donne aux jeunes ENSAE. Elle me répond du tac au tac, sans hésitation. D’abord, elle conseille aux X de choisir l’ENSAE les yeux fermés, beaucoup plus de notre temps que tout le reste. En effet, vu l’importance grandissante des données, cette école offre une formation en parfaite adéquation aux enjeux actuels et de demain. La demande pour les profils ENSAE est là et elle va encore augmenter, elle en est convaincue. Ensuite, elle recommande aux jeunes ENSAE de faire leur expérience à l’étranger le plus vite possible, quitte à revenir plus tard. En les rassurant : même s’ils manquent généralement de pratique, ils sont très bien formés techniquement et peuvent tout apprendre avec les outils qu’ils ont. De plus, les formations françaises commencent à être reconnues dans la Silicon Valley : il y a par exemple maintenant une dizaine d’X, d’ENSAE ou d’ENSAI chez Uber. Enfin, pour Marianne, il est faux de dire, comme on l’entend souvent, qu’en France on ne bosse pas beaucoup : les ingénieurs bossent en moyenne beaucoup moins en Californie qu’ici. Alors, elle leur dit : n’hésitez pas !
- Splendeur et misère de ChatGPT - 13 mars 2023
- De la comptabilité nationale au roman régional - 24 novembre 2022
- Un éclatant parcours en deux vies entremêlées : Portrait d’Evelyne Huet, peintre, ENSAE 1979 - 10 novembre 2021

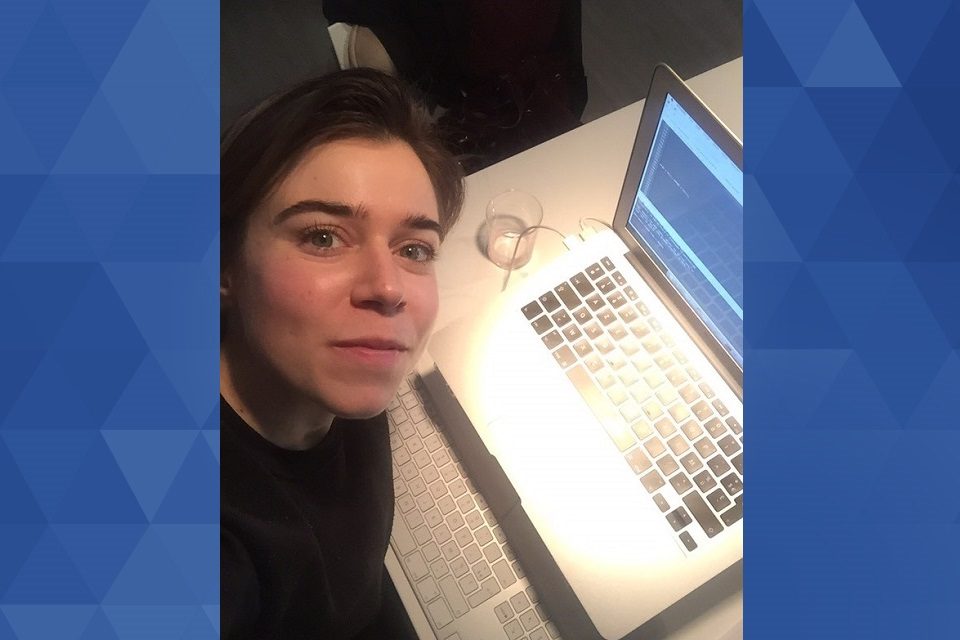
Commentaires récents