Le Gouvernement a introduit une disposition dans le Code du travail demandant aux entreprises de calculer et publier un « index » censé rendre compte des discriminations subies par les femmes au travail afin de les réduire. En confondant mesure des inégalités et mesure des discriminations, il est douteux que l’objectif visé puisse être atteint. On peut même se demander si cette mesure ne relève pas d’abord d’un affichage politique. Ce point de vue s’appuie essentiellement sur une analyse plus détaillée, publiée par ailleurs, dans « Les inégalités se mesurent, les discriminations se constatent » [7]. Il décortique l’origine de cette disposition, explique son erreur de méthode sous-jacente et ses effets pervers possibles.
Le 5 septembre 2018, la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a été promulguée [9]. Le Code du travail dispose dorénavant que « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret ».
Quatre mois plus tard, un décret d’application [9] a défini les modalités de calcul d’un « index de l’égalité professionnelle femmes hommes ». Cet indicateur composite aboutit à une note sur 100 supposée permettre l’identification des entreprises vertueuses et de celles ayant des progrès à faire pour atteindre l’égalité salariale. En cas de note inférieure à 75, les entreprises doivent mettre en place un plan de correction. Elles disposent alors de trois ans pour atteindre ce seuil minimal de 75. Si une entreprise ne publie pas son index, si elle ne met pas en œuvre de plan de correction ou si elle n’atteint pas le seuil minimal au bout de trois ans, elle s’expose à une pénalité financière pouvant représenter jusqu’à 1 % de sa masse salariale.
Dans les premiers résultats communiqués le 17 septembre 2019 par le ministère du travail, 17 % des entreprises de 250 salariés et plus, seules concernées la première année, sont considérées comme « en alerte rouge ». A l’opposé, 167 entreprises atteignent un index de 99 ou 100. Elles ont le privilège d’être citées nommément au tableau d’honneur dans le dossier de presse du ministère.
Dans l’esprit de la ministre du travail, cette innovation vise à passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats pour rendre effective une obligation inscrite dans le code du travail depuis 1973, selon laquelle « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » [9].
Elle s’inscrit en réalité dans une posture qui confond inégalités observées et mesure des discriminations en pensant, à tort, que celle-ci est possible. Cette approche conduit à imposer une définition normative d’une pseudo-mesure des discriminations. En privilégiant une politique de gestion des indicateurs, plutôt qu’une réflexion sur les processus, elle peut permettre d’afficher de bons résultats sans modifier la réalité des discriminations.
Encadré : Le calcul de l’index de l’égalité professionnelle femmes hommes
La méthode de calcul de l’index de l’égalité professionnelle femmes hommes est précisé dans la partie règlementaire du code du travail, créé par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019.
Il s’agit d’un indicateur composite, calculé selon des modalités différentes selon la taille de l’entreprise. A titre d’exemple, pour les entreprises de plus de 250 salariés, cinq indicateurs doivent être calculés. Ils donnent chacun droit à un nombre de points qui dépend du niveau atteint :
1° « L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents », qui permet d’obtenir de 0 point (écart supérieur à 20 %) à 40 points (écart égal à 0 %) ;
2° « L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes », qui permet d’obtenir de 0 point (écart supérieur à 10 %) à 20 points (écart inférieur ou égal à 2 %) ;
3° « L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes », qui permet d’obtenir de 0 point (écart supérieur à 10 %) à 15 points (écart inférieur ou égal à 2 %) ;
4° « Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris », qui permet d’obtenir 15 points s’il est égal à 100 %, 0 point sinon ;
5° « Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations », qui permet d’obtenir de 0 point (0 ou 1 salarié) à 10 points (4 ou 5 salariés).
Les points sont ensuite sommés. Le maximum possible est de 100. Le seuil critique est fixé à 75.
Le cadre réglementaire entre dans le détail des modalités de calcul de chaque indicateur. Par exemple, le calcul de l’écart de rémunération par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents doit utiliser des tranches d’âges prescrites (moins de 30 ans, 30 à 39 ans, 40 à 49 ans, 50 ans et plus). Pour définir les catégories de postes équivalents, l’employeur peut répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d’une autre méthode de cotation des postes. Sinon, par défaut, il doit les répartir selon quatre catégories socioprofessionnelles prescrites (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).
Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et au moins trois femmes sont pris en compte. La rémunération moyenne est calculée pour chacun des groupes, sur la base des salaires en équivalent temps plein. Le texte précise ensuite que : « l’écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes ».
Pour simplifier le calcul, un seuil de pertinence des écarts dans les groupes est fixé à 5 % si l’on utilise les catégories socioprofessionnelles ou 2 % si l’on utilise le niveau ou le coefficient hiérarchique. Ce seuil de pertinence est déduit de l’écart observé dans le groupe si l’écart est positif (il est ajouté dans le cas contraire), avec comme borne l’impossibilité de faire changer de signe cet écart ajusté. L’écart global est obtenu en sommant ces écarts ajustés, pondérés par l’importance du groupe dans l’effectif total. Précis jusqu’au bout, le code du travail ajoute que « le résultat final est la valeur absolue de l’écart global de rémunération, arrondie à la première décimale ».
Les imperfections des modélisations deviennent l’objectif de référence d’une politique publique
Dans sa communication, la ministre du Travail a largement communiqué sur le fait qu’à travail égal, les femmes seraient rémunérées 9 % de moins que les hommes[1]. En affirmant que cet écart est observé « à travail égal », la ministre suggère qu’il donne la mesure d’un écart illégitime uniquement lié au sexe. Il quantifierait une inégalité de traitement prohibée par les dispositifs législatifs réprimant les discriminations. Cette mesure d’une inégalité de situation serait donc aussi une mesure des discriminations subies par les femmes en matière de rémunération. Ce raccourci n’est pas rigoureux.
L’origine de cette quantification se trouve dans un document préparé par la Dares, service statistique du ministère du Travail, pour les « Rendez-vous de Grenelle » d’août 2018 [3] (ces rendez-vous trimestriels ont été mis en place par la ministre depuis 2017 pour proposer un point de situation approfondi régulier sur le marché du travail, en lieu et place de l’analyse mensuelle peu pertinente que proposaient jusqu’alors Pôle Emploi et la Dares). Dans ce document, un graphique portant sur l’écart entre les salaires des femmes et ceux des hommes proclame ainsi : « 24 % d’écart, 7 points liés aux temps partiels plus fréquents pour les femmes, 8 points liés à des secteurs d’activité et des postes moins rémunérateurs, 9 points à travail égal ».
Le graphique de la Dares illustre l’écart de salaire horaire femmes-hommes parmi les salariés du secteur privé sur plusieurs années en reprenant une étude de l’Insee [2]. Selon celle-ci, l’écart observé passe de 16,8 % en 1995 à 14,4 % en 2014, le salaire moyen des femmes ayant augmenté plus vite que celui des hommes. En fin de période, 41 % de l’écart (5,9 points) est expliqué par les différences de caractéristiques entre les femmes et les hommes pour les facteurs suivants : plus haut diplôme (sept niveaux), âge, expérience professionnelle (durée d’emploi comme salarié toutes entreprises confondues), ancienneté dans l’entreprise, catégorie socioprofessionnelle, quotité de travail, secteur d’activité, région d’emploi et taille de l’entreprise. La partie inexpliquée par le modèle est donc de 9 points.
Dans la communication ministérielle, ce que le modélisateur n’explique pas devient ainsi une « mesure des discriminations», comme si un écart inexpliqué était forcément illégitime et, inversement d’ailleurs, comme si l’écart expliqué était, lui, légitime, passant outre les précautions des auteurs de l’article, qui précisent que « cet écart inexpliqué ne peut être intégralement imputé à des comportements de discrimination salariale car les études ne peuvent jamais prendre en compte l’intégralité des circonstances pouvant justifier des écarts de salaires ».
Il ne faut bien sûr pas jeter la pierre à la ministre. La possibilité d’une mesure des discriminations est sous-jacente aux travaux d’instances dont les compétences statistiques et scientifiques semblent a priori garanties. On retrouve ainsi ce présupposé dans le rapport Héran [5] et dans le nom même de la commission dont il est issu : le comité pour la mesure et l’évaluation de la diversité et des discriminations. Le Conseil national de l’information statistique (Cnis), instance pilotée par l’Insee pour organiser les échanges entre les services producteurs de la statistique publique et les acteurs sociaux, a aussi conforté cette idée en organisant en juin 2017 une journée autour de cette question : « Comment mesurer les discriminations dans le domaine de l’emploi ? » [1][2].
Les mesures « toutes choses égales par ailleurs » n’existent pas
Pour celles et ceux qui se préoccupent des discriminations et sont à la recherche de mesures pour appuyer leurs analyses ou leurs préconisations, la tentation est naturelle de voir dans les résultats des analyses « toutes choses égales par ailleurs » un moyen de mesurer les discriminations en s’appuyant sur l’idée que l’analyse des inégalités étant « toutes choses égales par ailleurs », la partie résiduelle, souvent importante, des inégalités mesurées, devient l’écart inexplicable, donc illégitime causé par les discriminations. Cette tendance s’appuie sur la facilité de langage résumée par l’expression « toutes choses égales par ailleurs » souvent employée alors qu’aucune mesure n’est « toutes choses égales par ailleurs » :
1° L’importance de la part expliquée, donc corrélativement de la part inexpliquée, dépend d’abord des variables explicatives retenues et en particulier de leur pertinence au regard du phénomène étudié mais les informations pertinentes sont rarement toutes disponibles dans les sources de données mobilisées. Certaines informations sont d’ailleurs difficilement « observables » en dehors de l’observation directe, voire difficilement quantifiables, comme le degré d’implication ou de motivation, le comportement, etc.
2° L’importance de la part expliquée dépend aussi du nombre de facteurs explicatifs introduits dans le modèle et de leur degré de détail, car plus le nombre de facteurs explicatifs augmente ou plus ces facteurs sont introduits de façon détaillée, plus la partie « inexpliquée » des inégalités observées « toutes choses égales par ailleurs » se réduit de façon mécanique. On peut d’ailleurs regretter que les nombreuses études publiées sur les écarts salariaux montrent rarement la sensibilité de leurs résultats à leurs hypothèses. Exception notable, une étude des analyses des écarts de rémunération dans la fonction publique expose les résultats de tests de plusieurs modèles [4]. Elle montre ainsi que la part inexpliquée varie de 57 % à 8 % selon le modèle retenu.
3° Le nombre de variables explicatives ou le détail des variables mobilisables se heurte au nombre d’observations disponibles puisqu’il faut d’autant plus d’observations que l’on souhaite être précis dans le choix des facteurs explicatifs si l’on veut pouvoir conclure à des résultats statistiquement significatifs. L’analyste se trouve donc face à un dilemme entre richesse des informations mobilisables et nombre d’observations disponibles, entre choix d’une source administrative, avec de nombreuses observations mais pauvre en informations mobilisables, et données d’enquête, dont il ne peut exploiter toute la richesse parce que les données ne portent que sur un échantillon, donc un nombre réduit de personnes.
Les données disponibles et les choix des analystes influencent ainsi la mesure des inégalités entre groupes et l’importance de la part expliquée de ces inégalités. Cette part d’inexpliqué résiduelle rappelle que la réalité ne se met pas simplement en équation. D’un point de vue théorique, elle n’est qu’un « résidu », qui emporte bien sûr des effets des pratiques discriminatoires mais qui est d’abord le reflet des limites de la modélisation. Se focaliser sur la part d’inexpliqué revient à mettre en avant les insuffisances du modèle et non les effets d’un facteur illégitime, que sont les discriminations.
L’administration ne propose qu’une définition normative d’une pseudo-mesure des discriminations
Comme la mesure des inégalités « toutes choses égales par ailleurs » dépend fortement des modélisations retenues, la volonté des pouvoirs publics de s’appuyer sur une telle mesure pour piloter l’action et obtenir des résultats l’oblige à définir de façon précise la façon d’effectuer cette mesure. De ce fait, elle devient normative. Le décret déjà cité détermine ainsi réglementairement la méthode de calcul de l’« index de l’égalité professionnelle femmes hommes », dont sa composante principale, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (voir encadré). Il impose notamment que cet écart soit mesuré en ne tenant compte que de deux facteurs : la tranche d’âge, selon quatre modalités imposées, et la catégorie de postes, définie par l’employeur à partir de la classification de branche « ou d’une autre méthode de cotation » ou, à défaut, selon quatre catégories socioprofessionnelles prescrites (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). Pour être opérationnelle, la mesure doit faire fi de la recherche des meilleurs facteurs explicatifs mobilisables dans chaque entreprise, qui constituent autant de contextes spécifiques. Il ne s’agit plus d’être dans la sphère de la connaissance mais dans celle de l’action. C’est ainsi l’administration qui définit ce qu’elle décide être sa mesure des discriminations.
Cette approche n’est pas novatrice. Elle est le fondement de la loi sur l’équité en matière d’emploi adoptée au Canada en 1986 et révisée en 1992. Cette loi met en place une politique de quotas implicites décentralisée qui n’ose pas dire son nom, en demandant aux entreprises d’établir un diagnostic statistique normé, sur l’emploi et les salaires des quatre groupes cibles de cette politique : les femmes, les personnes en situation de handicap, les autochtones et les « minorités visibles » [6]. En cas de positionnement non satisfaisant des groupes cibles, l’entreprise doit planifier des mesures pour y remédier. La démarche est très encadrée, par une administration fédérale dédiée qui propose guides méthodologiques et questionnaires types. Les guides abordent en particulier les difficultés techniques, qui rendent les mesures plus normatives que scientifiques : comment définir les groupes d’emploi de référence en termes de qualification ? Comment choisir les aires de recrutement potentielles auxquelles se référer ? Etc. Ces questions ne sont pas secondaires. Elles constituent au contraire le nœud du problème : dans les entreprises trop petites ou si l’on est trop précis sur les qualifications, les effectifs pris en compte sont trop petits pour pouvoir conclure de façon statistiquement robuste à l’existence d’inégalités. Le bassin géographique de recrutement potentiel d’une entreprise est difficile à déterminer. De ce fait, l’exercice ne peut pas être scientifique. Il ne peut être que normatif.
La démarche normative proposée incite à une politique de gestion des indicateurs, en laissant de côté la question des discriminations
Plusieurs écueils peuvent être soulevés face à la démarche normative mise en place. Sans chercher à être exhaustif, ni à revenir sur les enseignements de l’échec des économies centralement planifiées, un premier écueil renvoie à la nature fruste des déterminants implicitement affichés comme légitimes des niveaux de salaires : la tranche d’âge et des groupes d’emploi susceptibles de mélanger des emplois en réalité très variés. Point de niveau de diplôme. Point de critère d’ancienneté. De ce fait, il n’est pas certain que toute politique RH strictement égalitaire permette d’atteindre le score maximum dans le calcul demandé.
L’égalité dans la classification n’est pas non plus gage d’égalité dans le travail s’il n’y a pas égalité face à la classification. Rachel Silvera [8] démontre ainsi que les classifications professionnelles sont plus promptes à reconnaître et valoriser les compétences techniques de métiers souvent plus masculins que les connaissances et les compétences spécifiques des métiers les plus féminisés, comme ceux des fonctions dites « support », qui impliquent des compétences relationnelles peu formalisables. Dans ces conditions, analyser les écarts de salaires à profession ou classification identique ne permet pas de rendre compte d’écarts illégitimes de rémunération au regard des contributions de chacun à la production.
Plus globalement, la mise en avant de l’index peut conduire les services RH des entreprises à développer une gestion de l’indicateur plutôt qu’à travailler véritablement sur les discriminations potentielles. C’est une pratique que la gestion de la liste des demandeurs d’emploi a déjà popularisée sur le marché du travail. Pourquoi s’intéresser à la question si le seuil demandé est atteint ? Pourquoi travailler sur les stéréotypes et sur les processus, dont les effets ne sont sensibles que dans le long terme, si une définition judicieuse des groupes et un ciblage pertinent des augmentations salariales suffisent à rentrer dans les clous, quitte à augmenter les sentiments d’injustice de certains, comme dans toute politique de quotas ?
L’index répond en réalité davantage à une politique d’affichage d’une volonté politique et à la recherche de pseudo résultats rapides plutôt qu’à une volonté de réduire réellement les espaces ouverts à la discrimination. Il permet aussi d’éviter d’examiner les processus, de recrutement, d’évaluation, de promotion, leur transparence, leur objectivité, mais aussi leur traçabilité pour permettre le cas échéant, des vérifications et des actions en justice. Agir sur les processus aurait pourtant l’intérêt de bénéficier de façon transversale à tous les motifs de discrimination potentielle. A contrario, la gestion RH des entreprises pourrait devenir de plus en plus complexe s’il fallait décliner les politiques fondées sur des pseudo mesures normatives des discriminations pour chacun des critères de discriminations possibles, déclinaisons qu’il serait après tout légitime de réclamer pour lutter aussi contre les discriminations liées à l’origine présumée, l’orientation sexuelle, l’appartenance syndicale, etc. En s’orientant dans cette direction, l’Etat ajoute une couche à sa croyance déjà présente que l’on peut déterminer plusieurs mois à l’avance les besoins de recrutements des entreprises, pour orienter le service public de l’Emploi sur les métiers en tension ou pour quantifier des besoins de main d’œuvre étrangère. Paradoxalement, dans sa gestion du marché du travail, l’Etat capitaliste rejoint ainsi les illusions qu’avait le Gosplan lorsqu’il cherchait à définir et à planifier les objectifs de l’économie soviétique. Le Gosplan n’est donc pas mort.
[1] Voir par exemple l’intervention de Muriel Pénicaud devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 23 mai 2018 ou son intervention lors de la discussion en première lecture de l’article 61 du projet de loi en séance le 15 juin 2018.
[2] Les interventions montrent cependant un clivage entre les spécialistes du chiffre, qui parlent peu de « mesure des discriminations », et les acteurs de terrain (DRH, Défenseur des Droits) ou certains sociologues, qui en font presque une exigence.
Références bibliographiques
[1] Cnis (2017), « Compte-rendu de la rencontre du 22 juin 2017 : comment mesurer les discriminations dans le domaine de l’emploi ? », n° 92/H030.
[2] Coudin E., Maillard S., Tô M. (2017), « Écarts salariaux entre les entreprises et au sein de l’entreprise : femmes et hommes payés à la même enseigne ? », in Insee Références. Emploi, chômage, revenus du travail – Édition 2017, p. 35-46.
[3] Dares (2018), « La situation du marché du travail au 1er trimestre 2018. Les 5 faits saillants », Les rendez-vous de Grenelle, Ministère du Travail.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_12_pp.pdf
[4] Duvivier C., Lafranchi J., Narcy M. (2016), « Les sources de l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans la fonction publique », Économie et Statistique, n° 488-489, p. 123-150.
[5] Héran F. (2010), Inégalités et discriminations – Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique, Rapport du comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD), février.
[6] Jugnot S. (2015), « Les statistiques “ethniques” outillent des politiques de quotas plutôt que la connaissance des discriminations : l’exemple canadien », La Revue de l’IRES, n° 83, p. 51-84.
[7] Jugnot S. (2019), « Les inégalités se mesurent, les discriminations se constatent », La Revue de l’Ires, n° 98), p. 3-28.
[8] Silvera R. (2014), Un quart en moins : des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaires, Paris, La Découverte.
[9] Références législatives et réglementaires : L’article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel crée le chapitre II bis du Code du travail sur les « mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise » (article L1142-7 à L1142-10). En particulier, l’article L1142-8 prévoit la publication d’indicateurs calculés suivant une méthodologie fixée par son décret d’application n°2019-15 du 8 janvier 2019. Ces nouveautés complètent l’article L3221-2 du code du travail qui, depuis 1973, pose le principe général « à travail égal, salaire égal ».

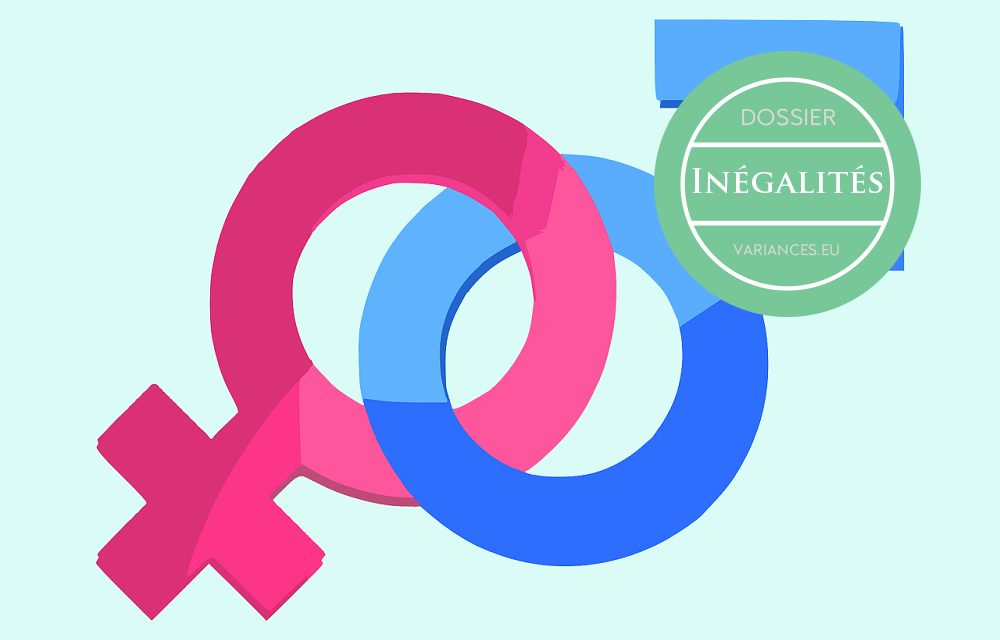
la conciliation vie professionnelle – vie privée est certainement déterminant dans la différence hommes/femmes pour les responsabilités du salarié au travail et dans son foyer : Il s’agit de créer de la souplesse dans les rythmes et les structures de travail et de proposer des services aux salariés avec l’amélioration de la qualité de vie au travail : https://www.officiel-prevention.com/dossier/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/lamelioration-de-la-qualite-de-vie-au-travail