En France, la vérité scientifique sur laquelle s’appuient les autorités est désormais établie : une maladie virale transmissible grave se diffuse dans la population. Seule une mobilisation absolue de tout le corps social pendant des semaines, voire des mois, permettra d’éviter une catastrophe sanitaire.
Au Royaume-Uni, la vérité scientifique qui inspire les autorités est un peu différente : une maladie transmissible se diffuse mais sa létalité est du même niveau que la grippe. Il suffit que les personnes qui présentent ses symptômes (proches de la grippe, toux et fièvre) restent quelques jours chez elles : cela étale la diffusion dans le temps, jusqu’à ce que la population soit naturellement immunisée parce que 60 % d’entre elle aura été touchée.
En Chine, une troisième vérité émerge : tout est terminé, l’épidémie a été endiguée par un Président résolu et les nouveaux cas au sein d’une population de 1,3 milliards d’habitants (en omettant ceux qui arrivent de l’étranger, bien sûr) se comptent sur les doigts d’une seule main.
Nous parlons pourtant bien du même coronavirus, mais à partir de statistiques bien plus sociales que scientifiques, celle de la diffusion du virus et de sa létalité. On ne sait rien ni de l’une ni de l’autre, et on les approxime par le nombre de cas diagnostiqués, et par la proportion de décès parmi ces cas.
Pour être diagnostiqué, il faut deux choses : que quelqu’un, le patient ou son médecin, ait demandé le test, et que les autorités sanitaires aient eu les moyens ou la volonté de le réaliser. Ce double filtre rend impossible d’interpréter à chaud les chiffres disponibles.
On peut faire trois hypothèses.
Il est vraisemblable que la diffusion est infiniment plus importante que ce que l’on mesure par les tests, et qu’une part importante des différences de morbidité dépend du nombre de tests effectués. Il est frappant qu’en dehors de la Chine, l’ordre des pays semble le même quand on classe selon le nombre de tests ou selon le nombre de cas (dans l’ordre décroissant, Corée, Italie, France et Etats-Unis). Et donc la plus grande partie des malades ne le sait pas, guérit sans s’en rendre compte, ou meurt d’autre chose, comme pour les crises caniculaires ou les pics de pollution.
Il est vraisemblable aussi que le taux de létalité est considérablement plus faible que les fourchettes qu’on présente aujourd’hui, entre 1 et 5%, parce que le nombre de malades est considérablement plus élevé et que ce sont les plus gravement atteints qui sont diagnostiqués.
Il est enfin vraisemblable que les autorités chinoises ont suspendu, soit leurs tests, soit leur publication. C’était sans doute leur stratégie initiale, contrariée par les dénonciations de médecins sur les réseaux, et les choses ont depuis été reprises en main.
L’expérience du coronavirus confirme surtout que la gestion des grands risques n’est pas une question scientifique et statistique, mais d’abord une question politique et sociale : un grand risque est ce qu’une collectivité (dans une démocratie) ou ses autorités (dans une dictature) considèrent être un grand risque. Une donnée statistique « objective » comme le nombre de morts n’a pas grand-chose à voir là-dedans : aucun scénario des conséquences du virus n’approche par exemple le chiffre des 48.000 Français tués chaque année par la pollution de l’air dans une certaine indifférence collective.
- La cigale et la cigale ou comment nous avons plus besoin d’un Assureur central que d’une Banque centrale - 1 octobre 2020
- Présentation du livre « Le Triomphe de l’Injustice », d’Emmanuel Saez et Gabriel Zucman - 4 septembre 2020
- Breaking the climate-finance doom loop – Casser le cercle vicieux du financement et du climat - 24 juin 2020

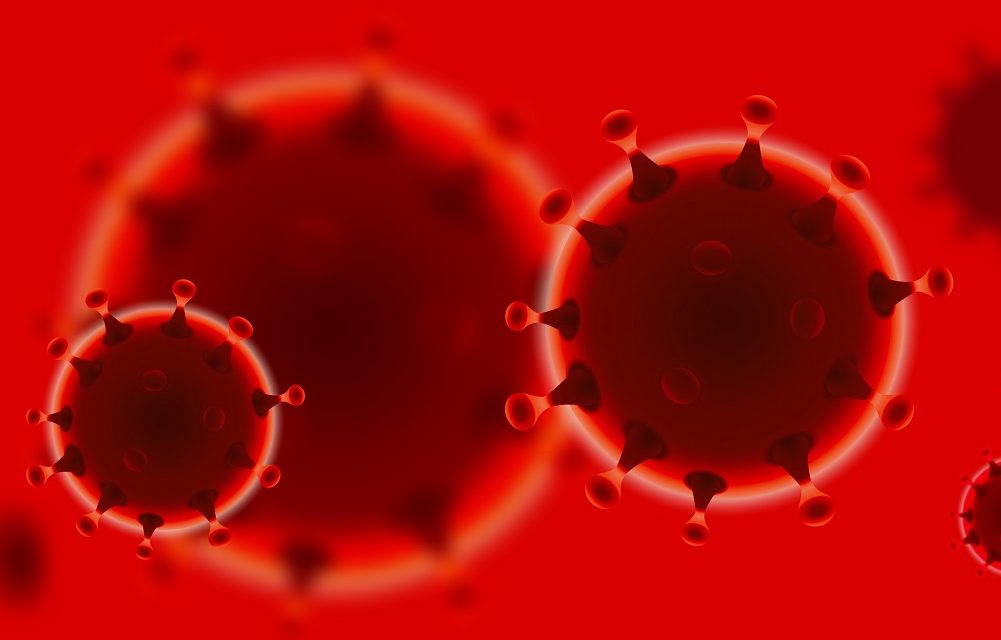
Tout à fait d’accord, sauf pour la citation des 48 000 victimes de la pollution qui, m’a-t-on dit, est un chiffre probablement aussi contestable…
Le chiffre de 48.000 est sûrement en effet un chiffre contestable. Mais le fait qu’il n’ait pas été remplacé par d’autres plus fiables ne confirme-t-il pas le point défendu ici, d’une certaine indifférence collective ?
interessant.Le virus soulève une question économique et politique qui est celle du « bien commun ».Est ce que la santé comme l’environnement n’est pas aussi en partie un bien commun? je vis aux US ou le gouvernement ouvre a peine les yeux sur le besoin universel de couverture médicale et de couverture sociale et la prise en compte d’un lien invisible entre la santé des uns et des autres.
Absolument. Le développement de l’épidémie illustre quand même que chaque collectivité finit par atteindre « sa » définition du bien commun, quand la la crise s’aggrave.
Malheureusement, les nouvelles d’Italie confirment les estimations les plus pessimistes : de l’ordre de 1% de décès dans les communes où (au mieux) il ne reste plus personne encore à toucher par le virus. https://www-corriere-it.cdn.ampproject.org/c/s/www.corriere.it/politica/20_marzo_26/the-real-death-toll-for-covid-19-is-at-least-4-times-the-official-numbers-b5af0edc-6eeb-11ea-925b-a0c3cdbe1130_amp.html
Oui, le temps passant, les données s’amélioreront forcément, mais au 2 avril il me semble qu’on est presqu’aussi loin d’un consensus sur ce taux qu’il y a 15 jours.
La dernière phrase me semble erronée (et l’ensemble du billet s’en ressent). « aucun scénario des conséquences du virus n’approche par exemple le chiffre des 48.000 Français tués chaque année par la pollution de l’air dans une certaine indifférence collective. »
Mais si ; les premières projections publiques du nombre de morts possible étaient de 400000, nombre déclaré « possible » le 13 février par Neil Ferguson (Imperial College) sur Channel 4 (pour le Royaume-Uni, on peut appliquer à la France). Elles découlaient directement des lois de l’épidémiologie bien connues, avec des paramètres qui étaient établis dès le 25 janvier. https://www.linkedin.com/pulse/ne-pouvait-pas-prévoir-ou-personne-navait-prévu-lefebvre-naré/
C’est encore l’estimation actuelle :
* % de la population atteint à l’équilibre de l’épidémie : environ 2/3
* taux de personnes avec symptômes parmi celles atteintes : environ 1/2 (résultat des tests à grande échelle en Islande)
* taux de létalité parmi les cas symptômatiques (détectés ou non), en situation de saturation des hôpitaux (Wuhan) : 1,4% selon https://www.nature.com/articles/s41591-020-0822-7 ; traduire en 2,2% pour la France au regard de la pyramide des âges ;
soit pour la France 67 Mn * 2/3 * 1/2 * 2,2% = 500000.
C’est vrai, j’aurais du dire « aucun scénario officiel au moment où j’écris… »,
Et ajouter que la gestion des scénarios obéit aussi à deux lois de communication :
-pour être entendu des journalistes, il faut crier fort, et ce professeur anglais parlait en son nom propre, comme le virologue allemand qui a dit à peu près la même chose à la même époque pour l’Allemagne,
-pour limiter les retombées après coup, il vaut mieux prévoir le pire, et c’est la nouvelle stratégie de communication du Président Trump.
Ce qui reste vrai au 2 avril en France, c’est qu’aucun scénario officiel n’approche les 38.000 morts. Et surtout que « la gestion des grands risques n’est pas une question scientifique et statistique, mais d’abord une question politique et sociale ».
« la gestion des grands risques n’est pas une question scientifique et statistique, mais d’abord une question politique et sociale ». Tout à fait ! Les scientifiques et statisticiens ne sont pas (et sans doute heureusement) les politiques ni la société. Ils ne peuvent qu’essayer d’informer, de dévoiler, d’alerter. De mettre la lumière (avec leur petite lampe de téléphone) sur les faits durs, et essayer d’éviter à la société et aux politiques la confusion de dires contradictoires ; de lever le « brouillard de guerre ». Que la chicaya ait envahi le milieu scientifique lui-même est ma plus forte déception de cette pandémie.